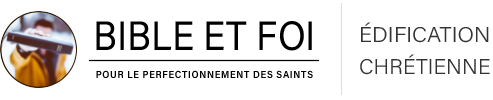Étude de la Bible
Images - Comparaisons - Symboles Bibliques

Le NT est caché dans l’Ancien ; l’AT est ouvert dans le Nouveau
Ce glossaire est régulièrement mis à jour !
Le Nouveau Testament n’est pas seul à rendre témoignage de Christ, l’Ancien Testament le fait aussi, toutes les Ecritures de l’Ancien Testament rendent témoignage de Christ et de son œuvre. L’interprétation du langage figuré de la parole de Dieu n’est pas toujours simple. Un principe important s’impose lorsque nous sommes occupés des types de l’Ancien Testament: n’allons jamais, dans leur interprétation, au-delà des révélations du Nouveau Testament. Ce sont justement des figures qui nous sont données pour illustrer la doctrine du Nouveau Testament d’une manière appropriée en partant de la pratique et pour la pratique : « Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints (1 Corinthiens 10 v. 11) ».
De plus, nous désirons nous occuper d’une catégorie également imagée d’enseignements de l’Écriture, les paraboles du Seigneur dans les évangiles, car il semble que les enfants de Dieu ne tirent que trop peu profit de cette partie de la parole de Dieu. Pourtant, quand le Seigneur Jésus était sur cette terre, Il a mis une grande partie de Ses enseignements sous forme de paraboles. Cela ressort clairement à la fois de la phrase remarquable de Marc 4 v. 2 : « Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles », et aussi plus généralement de la lecture et de l’étude attentives des paroles du Rédempteur.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• AARON - Premier souverain sacrificateur d’Israël.
Le frère de Moïse a été le premier souverain sacrificateur d’Israël et il est un type du Seigneur Jésus (cf. Hébreux 5 v. 1 à 5). Lors de la consécration des sacrificateurs, l’onction a précédé l’aspersion de sang pour Aaron, alors que pour ses deux fils, il a d’abord été fait aspersion du sang du sacrifice, puis seulement ensuite ils ont été oints de l’huile sainte (Exode 29, 7, 20, 21). Ainsi, au Jourdain, avant de commencer son service, Christ pouvait, lui qui était sans péché, être « oint » de l’Esprit (Luc 3 v. 22 ; 4, 18 ; Actes 10 v. 38), alors que pour nous la foi au sang de Christ précède l’onction ou le sceau du Saint Esprit (2 Corinthiens 1 v. 21 et 22 ; Éphésiens 1 v. 13).
Tandis que la sacrificature d’Aaron a pour objet que des pécheurs soient réconciliés avec Dieu et que les rachetés puissent s’approcher de lui, la sacrificature de Melchisédec parle de la bénédiction de Dieu envers les hommes, ce qui trouvera sa réalisation particulièrement dans le règne millénaire.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ABRAHAM - Le patriarche et ancêtre du peuple d’Israël.
Le patriarche et ancêtre du peuple d’Israël n’est pas seulement le plus bel exemple de foi pratique dans l’Ancien Testament, mais il présente aussi des traits typiques. En Hébreux 11 v. 8 à 19, son obéissance de la foi est particulièrement mise en évidence. Le mot croire apparaît pour la première fois dans la Bible en Genèse 15 v. 6 : « Et il crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice ». Alors que dans la première phase de sa vie (Genèse 12 v. 14), sa marche extérieure ainsi que son témoignage sont davantage présentés et, dans la deuxième (Genèse 15 v. 21), ses relations personnelles avec Dieu, la troisième phase donne un aperçu prophétique: au chapitre 22, sa disposition à obéir quand Dieu lui demande d’offrir son fils Isaac en sacrifice fait allusion au don du Fils de Dieu par le Père (ici apparaît pour la première fois au verset 2 le verbe aimer (cf. Romains 8 v. 32 ; Hébreux 11 v. 17 à 19) ; au chapitre 23, la mort de sa femme Sara est une image de la mise de côté temporaire du peuple d’Israël (cf. Romains 11 v. 25) ; au chapitre 24, nous voyons l’appel de l’épouse (l’Assemblée) pour le Fils et au chapitre 25, la bénédiction des nations dans le Millénium.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ADAM - Adam et Ève, le premier couple humain, et Christ et son épouse.
Les comparaisons en Romains 5 v. 12 et suivants (v. 14 : la figure de celui qui devait venir), et 1 Corinthiens 15 v. 20, 21 et 45 mettent en lumière la relation typique entre Adam, le chef de la première création tombée dans le péché, et Christ, le chef de la nouvelle création. Le premier homme avait été établi par Dieu comme chef de la création et devait dominer sur toutes les autres créatures (Genèse 1 v. 28). Le premier Adam ayant perdu tous les droits par sa désobéissance, le second homme, le dernier Adam, a été fait par Dieu Chef sur toutes choses en vertu de son œuvre à la croix, parce qu’il s’était acquis tous ces droits par son abaissement profond et sa parfaite obéissance (cf. 1 Corinthiens 15 v. 45 à 49 ; Hébreux 2 v. 6 et suivants). Adam est vu ici davantage en contraste avec Christ.
En Éphésiens 5 v. 30 à 32, un parallèle est toutefois établi entre Adam et Ève, le premier couple humain, et Christ et son épouse, parallèle qui nous autorise à voir en Adam et Ève un type de Christ et de son Assemblée. Comme Ève a été formée du côté d’Adam pendant qu’il était dans un profond sommeil, ainsi Christ, par sa mort à la croix, a posé le fondement pour son Assemblée qu’il aime et à laquelle il sera uni éternellement (Éphésiens 5 v. 25).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ADULTÈRE, FORNICATION, PROSTITUTION - Idolâtrie des Cananéens.
À l’encontre des conceptions modernes de la morale et d’une opinion largement répandue, les relations sexuelles entre deux personnes non mariées constituent selon la parole de Dieu le péché de la fornication (1 Corinthiens 5 v. 1), et cela, ainsi qu’il ressort de Genèse 34 (cf. plus particulièrement v. 31), même si un mariage est imminent ou désiré. Si l’une des personnes du couple est déjà mariée, il s’agit alors d’un adultère (Lévitique 20 v. 10). Ces deux formes d’union sont aux yeux de Dieu un péché contre le mariage qu’il a institué pour la vie entière (Genèse 2 v. 18 à 24 ; Romains 7 v. 2 et 3). Dieu a ces péchés en horreur et il nous met en garde contre eux avec insistance, aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau. Les rachetés ne doivent même pas les avoir à la bouche et encore moins les commettre (Éphésiens 5 v. 3 ; Hébreu 13 v. 4).
Ces péchés jouaient un rôle particulièrement rebutant dans l’idolâtrie des Cananéens (Genèse 38 v. 21 ; Deutéronome 23 v. 17 ; 1 Rois 14 v. 23 et 24 ; cf. Apocalypse 2 v. 14 à 20). Cependant ce n’est pas la seule raison pour laquelle la prostitution est souvent assimilée, dans l’Ancien Testament, particulièrement dans les livres prophétiques, à l’idolâtrie, mais c’est avant tout parce l’Éternel considérait le peuple d’Israël comme sa femme avec laquelle il s’était marié (Jérémie 2 v. 2 ; 3 v. 1 v. 10 ; Ézéchiel 16). En se détournant de Lui pour se tourner vers les idoles des peuples voisins, son peuple se livrait spirituellement à la prostitution. Dans le Nouveau Testament, cette fornication au sens figuré est nommée particulièrement en relation avec Babylone, la grande prostituée (Apocalypse 14 v. 8 ; 17 v. 2).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AGNEAU - Le Fils de Dieu, comme le vrai holocauste.
Dans la Bible, l’agneau (de la chèvre ou de la brebis) est une figure d’un être sans défense et dépendant d’autrui (Ésaïe 11 v. 6 ; 40 v. 11 ; Luc 10 v. 3). Il est l’animal le plus souvent prescrit pour les sacrifices dans l’Ancien Testament. Deux agneaux âgés d’un an, sans défaut, devaient être offerts chaque jour en holocauste continuel, deux également le jour du sabbat, sept au commencement des mois et pareillement lors de toutes les fêtes de l’Éternel, à l’exception de la fête des tabernacles au cours de laquelle quatorze agneaux étaient présentés chaque jour, pendant sept jours, et sept agneaux le huitième jour (Nombres 28 ; 29).
Ésaïe 53 v. 7 fait allusion prophétiquement au Rédempteur comme l’Agneau de Dieu : « Il a été opprimé et affligé, et il n’a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie ». « Commençant par cette écriture », Philippe l’évangéliste a pu annoncer Jésus à l’eunuque de Candace (Actes 8 v. 32 à 35). Dans le Nouveau Testament (à l’exception du passage déjà cité de Luc 10 v. 3 où le mot est cependant employé à la forme du pluriel) nous ne trouvons l’agneau (en grec deux mots différents : amnos et arnion) que comme nom ou titre du Seigneur Jésus. Par l’exclamation : « Voilà l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! (Jean 1 v. 29, 36) », Jean le Baptiseur salue le Fils de Dieu qui, comme le vrai holocauste, allait pleinement résoudre la question du péché selon les saintes exigences de Dieu.
Pierre l’appelle « l’agneau sans défaut et sans tache » dont le sang précieux nous a rachetés (1 Pierre 1 v. 19) ; enfin nous voyons le Seigneur glorifié au milieu du trône de Dieu dans le ciel comme l’Agneau : devant lui, les 24 anciens tombent sur leurs faces et l’adorent ainsi qu’il en est digne (Apocalypse 5 v. 6). Cet agneau, apparemment si petit et si faible, autrefois immolé pour nous, occupe maintenant la place de la puissance et de la gloire suprêmes. Les sept cornes et les sept yeux nous parlent de sa pleine puissance et de son parfait discernement. L’une des 28 mentions du mot « agneau » dans l’Apocalypse se rapporte pourtant au futur adversaire de Christ, soit l’Antichrist.
Au chapitre 13 (v. 11), il est dit de cet homme de péché, le fils de perdition (2 Thessaloniciens 2 v. 3) : « Et je vis une autre bête montant de la terre ; et elle avait deux cornes semblables à un agneau ; et elle parlait comme un dragon ». La ruse et le caractère dangereux de cet homme ne pourraient pas être mis en évidence plus clairement que par ces deux marques opposées. D’une certaine manière il ressemblera extérieurement à l’Agneau véritable, mais en même temps sa vraie nature sera révélée en ce que sa bouche proférera des paroles sataniques lorsqu’il s’assiéra au temple de Dieu et se présentera lui-même comme étant Dieu.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AIGLE - Les aigles sont l’expression des jugements de Dieu.
Le mot hébreu nescher, traduit le plus souvent par « aigle », signifie vraisemblablement « vautour », ainsi qu’il est rendu en Michée 1 v. 16. En 2 Samuel 1 v. 23 et dans d’autres passages, sa rapidité et sa force sont citées comme principales caractéristiques (Psaume 103 v. 5 ; Ésaïe 40 v. 31). L’envergure et la force de ses ailes sont une figure des soins de Dieu en faveur des siens (Exode 19 v. 4 ; Deutéronome 32 v. 11). Déjà en Deutéronome 28 v. 49, l’aigle est mis en relation avec le jugement, ce qui semble être la signification de ce symbole dans beaucoup de passages (Proverbes 30 v. 17 ; Osée 8 v. 1). En Matthieu 24 v. 28, où le peuple spirituellement mort d’Israël, qui s’est soumis volontairement à l’Antichrist, est appelé d’une manière figurée un corps mort (bête morte), les aigles sont l’expression des jugements de Dieu venant du ciel et consumant toutes choses. La ressemblance du quatrième animal d’Apocalypse 4 v. 7 (cf. Ézéchiel 1 v. 10) avec un aigle volant indique la venue subite des jugements de Dieu dans ses voies gouvernementales sur la création.
Source : « « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AIRAIN, CUIVRE - Les aigles sont l’expression des jugements de Dieu.
Lorsqu’il est parlé dans la Bible de l’airain, il faut certainement comprendre le cuivre (ou le bronze). Dans l’Antiquité, l’un des principaux lieux où l’on trouvait le cuivre était l’île de Chypre (latin : Cyprus) qui aussi a donné son nom au métal. Déjà en Genèse 4 v. 22, il est fait mention pour la première fois de l’airain comme métal pour la fabrication des outils tranchants. Puis nous le rencontrons de nouveau en Exode 25 v. 3 lors de la construction de la tente d’assignation et de ses ustensiles, construction pour laquelle il a été utilisé 70 talents et 2400 sicles d’airain, soit environ 2500 kg (chap. 38 v. 29).
Dans la parole de Dieu, l’airain est souvent mis en relation avec le feu. Sur l’autel d’airain, les sacrifices étaient consumés par le feu (Exode 27 v. 1 à 8). En Apocalypse 1 v. 15, les pieds du Fils de l’homme sont « semblables à de l’airain brillant, comme embrasés dans une fournaise ». L’airain est toutefois retiré intact du feu.
L’airain est une image de la justice manifestée dans le jugement. Comme Homme, seul le Seigneur Jésus possédait une justice intrinsèque, intérieure, qui pouvait supporter le feu du jugement de Dieu. La figure du serpent d’airain en est l’expression (Nombres 21 v. 4 à 9 ; Jean 3 v. 14 ; 2 Corinthiens 5 v. 21). Comme hommes, nous ne possédons aucune justice qui pourrait subsister devant Dieu. « Toutes nos justices [sont] comme un vêtement souillé (Ésaïe 64 v. 6) ». Mais celui qui croit au Fils de Dieu n’est pas jugé, il est justifié. Dieu est juste quand il condamne le péché, mais il montre aussi sa justice en justifiant celui qui croit en son Fils (Romains 3 v. 26).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AMALEK - Amalek est une image de Satan.
Le nom Amalek peut être traduit par : « peuple pillard » ou : « qui dépouille le peuple ». Amalek était le fils d’Éliphaz et de Thimna (Genèse 36 v. 12 à 16), donc un petit-fils d’Ésaü. Le fait que la contrée des Amalékites est déjà mentionnée en Genèse 14 v. 7 n’est pas en contradiction avec ce qui précède, les lieux de la Bible étant souvent nommés longtemps à l’avance par leurs noms futurs (cf. le nom de Béthel en Genèse 12 v. 8 ; 28 v. 19). Les lieux d’habitation de ce peuple apparenté à Israël étaient situés au sud de la Palestine, c’est-à-dire près de l’Égypte (Nombres 13 v. 29 ; 1 Samuel 15 v. 7 ; 27 v. 8).
Les Amalékites se sont constamment révélés être les oppresseurs d’Israël. Ils étaient des pécheurs et ne craignaient pas Dieu (Deutéronome 25 v. 17 ; Juges 10 v. 22 ; 1Samuel 15 v. 18). Après être sorti d’Égypte, Israël rencontra aussitôt Amalek (Ex. 17 v. 8 ; Nombres 14 v. 43 à 45), et même dans le pays de Canaan, Amalek ne laissa pas le peuple de Dieu en paix. Amalek y est presque toujours vu en relation avec les autres habitants du pays, lesquels sont une figure de la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes (Juges 3 v. 13 ; 6 v. 3 ; Éphésiens 6 v. 12). L’inimitié des Amalékites est cruelle et rusée. Ils attaquent les faibles, détruisent la récolte du pays, et là où ils passent, ils brûlent les villes et pillent tout (Deutéronome 25 v. 17 ; 1 Samuel 30 v. 1 et 2).
Amalek est une image de Satan qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer (1 Pierre 5 v. 8). En vérité, il est un ennemi vaincu, car son jugement est déjà prononcé : « Sa fin sera la destruction (Nombres 24 v. 20) ». De même que Dieu a dit d’Amalek : « L’Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération (Exode 17 v. 16) », de même le croyant doit résister aux attaques de Satan (Jacques 4 v. 7 ; 1 Pierre 5 v. 9). Ce combat dure aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Mais à la fin s’accomplira la parole de Romains 16 v. 20 : « Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÂNE - L’âne est une bête de somme et une monture modeste.
Aujourd’hui encore il est apprécié dans le Proche-Orient. Il peut porter des charges étonnantes et c’est sans doute pour cette raison qu’il est parfois une figure de l’humilité (Genèse 49 v. 14 et 15). Lors de sa première venue, quand le Seigneur Jésus a séjourné sur la terre dans l’abaissement profond, il est entré dans Jérusalem sur un âne. Mais lorsqu’il apparaîtra pour la seconde fois en gloire comme Fils de l’homme, il sera assis sur un cheval blanc (Zacharie 9 v. 9 ; Matthieu 21 v. 5 ; Apocalypse 19 v. 11).
L’âne, spécialement l’âne sauvage, est comparé dans la Bible à l’homme. Au sujet d’Ismaël, l’Ange de l’Éternel prophétise à Agar, servante d’Abraham : « Lui, sera un âne sauvage d’homme », et Job dit : « Et l’homme stupide s’enhardit, quoique l’homme naisse comme le poulain de l’âne sauvage » (Genèse 16 v. 12 ; Job 11 v. 12). Un des premiers commandements que le peuple d’Israël a reçu de Dieu après sa délivrance d’Égypte prescrivait : « Et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau ; et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras (Exode 13 v. 13 ; 34 v. 20) ». Là aussi nous voyons une certaine assimilation à l’âne comme figure de l’homme naturel qui a besoin de rédemption. C’est ainsi que doit être également interprété le commandement défendant le joug mal assorti, selon lequel l’Israélite ne devait jamais atteler ensemble un bœuf et un âne devant une charrue (Deutéronome 22 v. 10). Ce commandement est appliqué, dans le Nouveau Testament, à la relation (dans le mariage, l’amitié, la profession, les associations, etc.) d’un croyant avec un incrédule (2 Corinthiens 6 v. 14 et suiv.). Selon la loi, le bœuf était un animal pur, l’âne un animal impur ; en outre, ces deux animaux ont des caractères totalement différents qui ne s’accordent en aucun cas. Une leçon simple mais sérieuse et importante pour chaque enfant de Dieu !
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ANIMAUX (symboliques), cherubin, seraphin.
Les quatre animaux sont décrits pour la première fois en Ézéchiel 1 v. 5 à 14. Dans le Nouveau Testament, ils se trouvent dans le livre de l’Apocalypse (Apocalypse 4 v. 6 à 9). Ils se tiennent au milieu et à l’entour du trône de Dieu, et ils symbolisent les caractères de son gouvernement et de ses jugements sur le monde (Ézéchiel 1 v. 26). Les faces des animaux en Ézéchiel 1 correspondent à celles d’Apocalypse 4. Le lion parle de la force, le veau de la constance, l’homme de la sagesse et l’aigle de la soudaineté et de la rapidité des jugements à venir. En Ézéchiel chacun des quatre animaux porte les quatre caractères, tandis qu’en Apocalypse chaque animal n’en présente qu’un des quatre. Alors qu’en Ézéchiel 1 v. 18 les jantes des roues des quatre animaux sont pleines d’yeux tout autour, il est dit en Apocalypse 4 v. 6 et 8 qu’ils sont « pleins d’yeux devant et derrière », et qu’ils sont « tout autour et au-dedans, pleins d’yeux ». Aussi bien en Ézéchiel 1 v. 28 qu’en Apocalypse 4 v. 3, il y a un arc-en-ciel autour du trône.
Les animaux sont reconnus par Ézéchiel comme étant des chérubins (Ézéchiel 10 v. 20). La signification du nom Cherub (hébr. Keruv, pl. Keruvim) n’est pas certaine. Il a pour interprétation : « celui qui combat », « celui qui saisit », « le serviteur fidèle » ou « celui qui est grand, qui est puissant ». Les chérubins ou les animaux avaient quatre ailes (Ézéchiel 1 v. 6).
Quand le prophète Ésaïe décrit le trône de Dieu, il voit au-dessus du trône les séraphins, dont le nom signifie « les ardents (Ésaïe 6 v. 1 à 4) ». Les séraphins ont six ailes comme les quatre animaux d’Apocalypse 4, et comme ceux-ci ils ne cessent de dire « Saint, saint, saint (Ésaïe 6 v. 3 ; Apocalypse 4 v. 8) ».
Une comparaison des deux descriptions de l’Ancien Testament avec celle du Nouveau nous amène à la conclusion qu’Ézéchiel et Ésaïe n’ont vu chacun pour soi qu’une partie de l’immense gloire du trône de Dieu, alors que Jean, pour ainsi dire, a pu contempler à face découverte toute la gloire du Seigneur. À la vue de l’image de la gloire de l’Éternel, Ézéchiel est tombé sur sa face et Ésaïe s’est écrié : « Malheur à moi ! car je suis perdu ; car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d’un peuple aux lèvres impures ; car mes yeux ont vu le roi, l’Éternel des armées (Ézéchiel 1 v. 28 ; Ésaïe 6 v. 5) ». Cependant Jean peut dire : « Je vis : et voici, une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j’avais ouïe, comme d’une trompette parlant avec moi (c’est-à-dire la voix du Seigneur Jésus), disant : Monte ici (Apocalypse 4 v. 1) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ANNEAU, BAGUE - Image de l’alliance et de la communion.
L’anneau, spécialement la bague, est une image de l’alliance et de la communion ; sa forme sans commencement ni fin évoque l’éternité. Dans l’Antiquité, le port d’un anneau était un privilège particulier, et son octroi était l’expression de la considération ; l’anneau parle en outre de puissance et d’autorité (Genèse 41 v. 42 ; Jacques 2 v. 2). La pensée de la communion intime dans l’amour apparaît particulièrement dans le Cantique des cantiques 8 v. 6, où la fiancée dit : « Mets-moi comme un cachet (ou une bague à cachet) sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras » (cf. Aggée 2 v. 23). Lors de son retour vers son père, le fils prodigue a reçu non seulement la plus belle robe (cf. Apocalypse 7 v. 14) et des sandales pour « marcher d’une manière digne » (cf. Éphésiens 4 v. 1), mais aussi un anneau comme marque de l’amour, de la communion et de l’estime du père (Luc 15 v. 22).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARBRE - L’arbre produit du fruit.
Souvent la première mention d’un concept donne déjà une clé quant à son sens figuré et spirituel. L’arbre est mentionné pour la première fois en Genèse 1 v. 11 et 12 : «…et la terre produisit l’herbe… et l’arbre produisant du fruit ».
Dans le jardin d’Eden, il y avait deux arbres particuliers : l’arbre de vie, au milieu du jardin, ainsi que l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Genèse 2 v. 9). La défense de manger du fruit de ce dernier amena le péché et la mort dans le monde ; l’accès à l’arbre de vie fut fermé à l’homme (Genèse 3). Cependant, il est prophétiquement de nouveau question de l’arbre de vie, avec ses douze fruits, dans le paradis de Dieu ; il servira de nourriture aux vainqueurs (Apocalypse 2 v. 7) et, dans le règne millénaire, ses feuilles seront pour la guérison des nations (Apocalypse 22 v. 2). C’est une image de Christ qui seul peut donner la vie éternelle et qui, pour l’éternité, est la source de toute bénédiction pour les siens.
Dans la Bible, l’arbre est souvent le symbole d’une grande puissance. L’Assyrien (Ézéchiel 31 v. 3) et Nebucadnetsar (Daniel 4 v. 10) sont comparés à de grands arbres. L’arbre qui a crû à partir d’un petit grain de moutarde, en Matthieu 13 v. 31 et 32, est une image semblable mais négative. Le royaume des cieux, qui doit porter un caractère céleste, devient une puissance terrestre. Ce n’est pas la croissance du royaume des cieux voulue de Dieu, mais son développement consécutif au rejet du roi. Les oiseaux, qui demeurent dans ses branches, symbolisent les démons.
En revanche, l’homme bienheureux du psaume 1 est semblable à un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARC-EN-CIEL - La fidélité immuable de Dieu.
Un arc-en-ciel se forme dans la partie du ciel opposée au soleil, par la réfraction de la lumière du soleil dans les gouttes d’eau. Il est mentionné pour la première fois en Genèse 9 v. 13 à 17 après le déluge, et cela parce qu’il n’avait jamais plu auparavant (Genèse 2 v. 5 à 6). Dieu a donné à Noé ce signe de son alliance avec la terre qui ne devait plus être de nouveau jugée par un déluge (cf. 2 Pierre 3 v. 5 à 13). Lorsque le jugement de Dieu viendra, toute l’ancienne création « embrasée sera dissoute ». Cependant jusque-là, Dieu agit avec patience et en grâce.
Comme symbole de la fidélité de Dieu à ses promesses quant à la terre, et cela en dépit de tous les péchés de l’homme, l’arc-en-ciel est un signe des voies gouvernementales de Dieu envers le monde (Ézéchiel 1 v. 28 ; Apocalypse 4 v. 3 ; 10 v. 1). La beauté de cet arc dans la nuée doit toujours nous rappeler la fidélité immuable de Dieu.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARCHE (de Noé) - Une figure du baptême d’eau.
Avant le déluge, Noé, sur l’ordre de Dieu, a dû construire pour lui et sa famille une arche dans laquelle ils échapperaient au jugement de Dieu sur l’humanité pécheresse (Genèse 6). En Hébreux 11 v. 7, cette arche est désignée comme moyen « pour la conservation de sa maison », et Pierre interprète l’ensemble de cet événement comme étant une figure du baptême : l’eau du jugement a porté en même temps l’arche salvatrice (1 Pierre 3 v. 19 à 21). Que nous pensions à la délivrance éternelle ou à la signification temporelle du baptême, dans les deux cas le refuge en Christ est notre protection pour la traversée des eaux de la mort. Christ est notre « arche », notre délivrance. Il a été pour nous dans le jugement, et nous sommes cachés en lui pour le temps et pour l’éternité.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARCHE (de l’alliance) - Une figure du baptême d’eau.
L’arche de l’alliance (hébr. ‘aron), dont la description est donnée en Exode 25 v. 10 à 22, avait différentes appellations : l’arche de l’alliance (Deutéronome 31 v. 26), l’arche de l’alliance de Dieu ou de l’Éternel (Juges 20 v. 27 ; Nombres 10 v. 33), l’arche de l’Éternel (Josué 3 v. 13), l’arche de Dieu (1 Samuel 4 v. 11) et enfin, durant la marche d’Israël dans le désert, l’arche du témoignage (la première fois en Exode 25 v. 22, la dernière en Josué 4 v. 16). Elle était de bois de sittim (bois) et entièrement plaquée d’or pur. Elle renfermait les deux tables de la loi avec les dix commandements, puis plus tard la verge d’Aaron, qui avait bourgeonné, et la cruche avec la manne (Exode 25 v. 21 ; 1 Rois 8 v. 9 ; Hébreux 9 v. 4).
L’arche était couverte par le propitiatoire (le substantif hébreu kapporeth est dérivé d’un verbe qui signifie étymologiquement « couvrir », mais veut dire usuellement « expier, pardonner »). Celui-ci était fait entièrement d’or pur et il était couronné de deux chérubins, tirés de lui, dont les ailes s’étendaient en haut. Deux barres, reliées à l’arche par quatre anneaux, servaient à la transporter. L’arche était le seul objet qui se trouvait dans le lieu très saint de la tente d’assignation et du temple, la sainte habitation de Dieu, et elle était le trône de Dieu sur la terre; Il siégeait entre les chérubins (1 Samuel 4 v. 4 ; Psaume 80 v. 1). Une fois l’an, au grand jour des propitiations (Lévitique 16), le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour y faire aspersion du sang du sacrifice sur le propitiatoire et pour faire propitiation pour le peuple.
L’arche de l’alliance est un type de Christ, du Fils de Dieu devenu homme (cf. Jean 1 v. 14). Lui seul pouvait dire avec raison : « C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles » (Psaume 40 v. 8 ; Hébreux 10 v. 5 et suiv.). Le propitiatoire est en revanche un type de la gloire et de la justice de Dieu révélées en vertu de l’œuvre accomplie de la rédemption (cf. Romains 3 v. 25). L’Homme glorifié dans le ciel, qui a accompli la grande œuvre de la rédemption, est le fondement de la relation de Dieu avec ses rachetés. Les barres symbolisent le fait que la vérité, dont l’arche et le propitiatoire nous parlent, est confiée au peuple de Dieu pour qu’il en rende témoignage.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARGENT - Le plus souvent moyen de paiement.
Comme l’or, l’argent compte parmi les métaux précieux qui sont convoités à cause de leur rareté, de leur valeur et de leur éclat. Il est mentionné dans la Bible le plus souvent comme moyen de paiement. Déjà avant l’apparition des monnaies frappées, on pesait l’argent lorsqu’on avait quelque chose à payer (cf. Genèse 23 v. 16). En hébreu et en grec, ainsi que dans quelques langues modernes, le mot argent désigne aussi bien le métal précieux que la monnaie. En Job 28 v. 15 il est dit de la sagesse : « L’argent ne se pèse pas pour l’acheter ».
Selon Exode 30 v. 11 à 16 et 38 v. 25 à 28, chaque Israélite depuis l’âge de vingt ans, qu’il soit riche ou pauvre, devait donner un demi-sicle d’argent comme rançon de son âme. Cette rançon remplissait un double but. Premièrement elle préservait chaque Israélite de la plaie, du jugement de Dieu, secondement elle servait de matériau pour la construction de la tente d’assignation. Les ais du tabernacle étaient fixés sur des bases d’argent (Exode 26 v. 19).
L’argent est une figure du prix que le Seigneur Jésus a payé pour le rachat des pécheurs. En 1 Pierre 1 v. 18 et 19 il est dit que nous avons été rachetés non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par le sang précieux de Christ. Ainsi tous les rachetés du temps actuel constituent ensemble l’Assemblée du Dieu vivant qu’il s’est acquise par le sang de son propre Fils (Actes 20 v. 28).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARGILE, POTIER - Le plus souvent moyen de paiement.
Dans l’Antiquité, les vases d’argile, très fragiles, étaient les récipients les plus répandus dans les maisons. Ils étaient façonnés avec de l’argile molle sur le tour du potier et finalement cuits au four, comme les briques fabriquées avec la même matière (Genèse 11 v. 3 ; Jérémie 18 v. 2 à 4). Dans la Bible, l’argile et les vases de terre cuite faits ainsi sont assez souvent employés comme figure de l’homme (Job 10 v. 9 ; 33 v. 6 ; Ésaïe 45 v. 9), figure qui parle de la faiblesse et de la fragilité du corps humain et de la vie (Lamentations 4 v. 2 ; 2 Corinthiens 4 v. 7). Le pouvoir du potier de former des vases comme il lui plaît est comparé à la souveraineté de Dieu dans ses voies envers les hommes (Ésaïe 64 v. 8 ; Jérémie 18 v. 6 ; Romains 9 v. 21).
Aussi bien le pétrissage de l’argile que le brisement des vases qui en ont été faits sont parfois des figures du châtiment et du jugement (Psaume 2 v. 9 ; Ésaïe 30 v. 14 ; 41 v. 25 ; Jérémie 19 v. 11 ; Apocalypse 2 v. 27).
En tant que matière provenant de la terre, l’argile est aussi un symbole de l’insignifiance et du caractère passager, c’est-à-dire de quelque chose qui n’a pas de durée devant Dieu (Daniel 2 v. 33 ; 2 Timothée 2 v. 20 et 21).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ARME - Nous pouvons combattre le bon combat de la foi.
Alors que dans le Nouveau Testament les armes comme instruments de guerre sont mentionnées presque uniquement au sens figuré, dans l’Ancien Testament il en est parlé avant tout au sens concret ; le prophète Jérémie parle une fois des « armes de l’indignation de l’Éternel (Jérémie 50 v. 25) ». L’ensemble de nos armes spirituelles constitue « l’armure complète de Dieu (Éphésiens 6 v. 11) » ; dans d’autres passages il est question des « armes de la lumière » et des « armes de justice (Romains 13 v. 12 ; 2 Corinthiens 6 v. 7) ». Le combat chrétien de la foi n’a pas lieu contre le sang et la chair, et par conséquent les armes de notre guerre ne sont pas charnelles (2 Corinthiens 10 v. 4). Elles sont le plus souvent des moyens de protection, tels la cuirasse de la justice ou de la foi (Éphésiens 6 v. 14 ; 1 Thessaloniciens 5 v. 8), le casque du salut (Éphésiens 6 v. 17 ; 1 Thessaloniciens 5 v. 8) et le bouclier de la foi (Éphésiens 6 v. 16). La seule véritable arme défensive et offensive est l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu (Éphésiens 6 v. 17). Pourvus de ces armes, nous pouvons combattre le bon combat de la foi comme de « bons soldats de Jésus Christ (2 Timothée 2 v. 3) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AROMATE - Pour réjouir Dieu par une odeur agréable.
L’huile de l’onction sainte consistait en plusieurs aromates : la myrrhe, le cinnamome, le roseau aromatique, la casse et l’huile d’olive ; l’encens composé saint était fait de stacte, de coquille odorante, de galbanum et d’encens (Exode 30 v. 22 à 38). Dans l’acte de Marie de Béthanie qui oignit la tête et les pieds du Seigneur Jésus avec du nard de grand prix, de sorte que la maison fut remplie de l’odeur du parfum, nous discernons aisément une image de l’adoration (Marc 14 v. 3 et suiv. ; Jean 12 v. 3). Lorsque, comme rachetés, nous adorons notre Dieu et Père en esprit et en vérité, une odeur agréable qui le réjouit monte vers lui.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AUTEL - Le lieu de rencontre et de communion de l’homme avec Dieu.
Un autel est une sorte de table, sur laquelle des sacrifices étaient offerts et brûlés au feu. L’autel est le lieu de rencontre de l’homme avec Dieu et, par conséquent aussi, de la communion avec lui (1 Corinthiens 10 v. 18). Le premier autel mentionné dans la Bible fut bâti par Noé après le déluge (Genèse 8 v. 20). Les faux dieux des païens, derrière lesquels se tiennent les démons, avaient également leurs autels sur lesquels des sacrifices leur étaient offerts (1 Corinthiens 10 v. 20).
Dans la tente d’assignation, il y avait deux autels : l’autel d’airain ou autel de l’holocauste qui se trouvait dans le parvis, et l’autel de l’encens ou autel d’or placé dans le lieu saint. L’autel de l’holocauste était fait de bois de sittim et plaqué d’airain (Exode 27 v. 1 à 8 ; 38 v. 1 à 7). Cet autel est un type de la croix de Golgotha et du Seigneur Jésus lui-même qui a accompli l’œuvre de l’expiation. Là le jugement de Dieu a frappé l’Homme Christ Jésus, là le Juste a souffert pour les injustes, afin de nous amener à Dieu (1 Pierre 3 v. 18). De même que chaque Israélite devait venir à cet autel lorsqu’il s’approchait de Dieu, ainsi aujourd’hui nul homme ne vient à Dieu sinon par le Rédempteur Jésus Christ. En Malachie 1, l’autel de l’holocauste est appelé la table de l’Éternel au verset 7, et la table du Seigneur au verset 12 (cf. Ézéchiel 41 v. 22). De même que l’autel était le lieu de la communion de l’Israélite avec l’Éternel, de même aujourd’hui le Seigneur Jésus, par son œuvre, est le fondement de la communion de l’enfant de Dieu avec lui et avec le Père (1 Corinthiens 10 v. 16 à 22 ; Hébreux 13 v. 10).
Comme le chandelier et la table des pains de proposition, l’autel de l’encens ou l’autel d’or se trouvait dans le lieu saint; il est vu toutefois en étroite relation avec le lieu très saint (1 Rois 6 v. 19 à 22 ; Hébreux 9 v. 4). Il était aussi de bois de sittim, mais il était plaqué d’or pur. Seul l’encens y était offert (Exode 30 v. 1). L’autel de l’encens est un type du lieu de la prière et de l’adoration des croyants (cf. Apocalypse 5 v. 8 ; 8 v. 3).
Au temps de l’ancienne alliance, seuls quelques hommes appelés à cela, les sacrificateurs, pouvaient pénétrer dans le lieu saint. Mais maintenant, en conséquence de l’œuvre expiatoire de Christ, l’accès des lieux saints célestes est ouvert à tous les rachetés, puisque, selon leur position, ils sont tous devenus des sacrificateurs (cf. Nombres 4 v. 19 et 20 ; Hébreux 4 v. 16 ; 9 v. 6 ; 10 v. 19 à 22 ; 1 Pierre 2 v. 5).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• AVEUGLE - Infirmité corporelle, mais aussi comme châtiment de Dieu.
La cécité est souvent mentionnée dans la Bible, et cela non seulement en tant qu’infirmité corporelle congénitale ou héréditaire, mais aussi comme châtiment de Dieu (Genèse 19 v. 11 ; 2 Rois 6 v. 18). Beaucoup d’aveugles ont recouvré la vue par le Seigneur Jésus (Matthieu 9 v. 27 et suiv. ; 11 v. 5 ; 12 v. 22 ; 15 v. 30 et 31 ; 20 v. 30 et suiv. ; 21 v. 14 ; Jean 9).
Au sens figuré, la cécité est une figure de l’insensibilité spirituelle, c’est-à-dire de l’incapacité de discerner la volonté de Dieu ou quoi que ce soit « dans la vraie lumière ». Les chefs des Juifs sont appelés par le Seigneur Jésus des aveugles, conducteurs d’aveugles (Matthieu 15 v. 14). Mais des croyants peuvent aussi tomber dans un état de cécité qui les rend incapables de parvenir à une vraie connaissance (2 Pierre 1 v. 9 ; Apocalypse 3 v. 17). Satan « a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ qui est l’image de Dieu ne resplendît pas pour eux (2 Corinthiens 4 v. 4) », bien qu’il eût fait miroiter au premier couple que leurs yeux seraient ouverts (Genèse 3 v. 5) ! Cependant, lorsqu’ils eurent cédé à sa séduction et qu’ils eurent mangé le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux ne furent ouverts que pour connaître « qu’ils étaient nus » (v. 7). Plus tard, il est parlé à plusieurs reprises des yeux ouverts sur la grandeur et la grâce de Dieu (Genèse 21 v. 19 ; Nombres 22 v. 31 ; 2 Rois 6 v. 17 ; Luc 24 v. 31 ; cf. Psaume 119 v. 18).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• A.D.N - La signification du terme : A.D.N !
Les scientifiques ont appelé ce qui constitue notre individualité au cœur de nos cellules : L'acide désoxyribonucléique, soit l'acronyme ADN ou DNA en anglais ! Je ne pense pas qu'ils ont compris qu'en nommant ce brin d'acides aminés ainsi, ils lui ont donné le nom de « Seigneur » ! En effet, en hébreu Adon veut dire seigneur et s'écris ainsi « אדון », et la racine primaire de ce nom est « aleph », « א », « daleth », « ד » et « noun », « נ », soit ADN en français !
D'un point de vue spirituel, chaque être humain a le mot « Seigneur » dans chacune de ses cellules !
Source : « LA BIBLE D'APRÈS LES TEXTES HÉBREU » - par Philippe Dehoux.
• ALLÉLUIA - « הללויה » en hébreu, veut dire « Loué soit Dieu !
Ce mot vient de deux racines. La première « Halel », « הלל », veut dire : Gloire à, louer, adorer, prier. La seconde « Yah », « יה » est la contraction du Tétragramme « יהוה », généralement traduit par « l’Eternel » ou « Seigneur ».
Je voudrais, ici, nous mettre en garde sur une mauvaise prononciation du mot « Alléluia », qu’il m’est arrivé d’entendre. Parfois, à la place de ALLéluia en prononçant « ALL », certaines personnes, disent « RALLéluia », prononçant « RALL ». Cela revient à dire en hébreu « חללויה », « ralléluia », qui veut dire « que l’Eternel s’éloigne » ! Voyez-vous l’importance de savoir ce que l'on dit, et d’une bonne prononciation dans nos prières ? Au lieu de dire, « que l’Eternel soit loué », nous pouvons dire « que l’Eternel s’éloigne ! ».
Source : « LA BIBLE D'APRÈS LES TEXTES HÉBREU » - par Philippe Dehoux.
• AMEN - Amen « אמן », a donné le mot « Emouna », « אמונה » !
« Emouna » veut dire la « foi »
La foi qui n’est pas une simple croyance. La racine de « amen » signifie quelque chose sur laquelle nous pouvons placer notre confiance, c’est quelque chose de sûr et de certain, c’est croire en quelque chose de fondé, de certain.
En français, le mot « croire » a perdu de sa signification. En effet, lorsque nous demandons par exemple : « Papa a-t-il acheté du pain ? » et que l’on nous répond : « Je crois ! », cela n’induit pas une certitude, mais une possibilité ! Il nous faut vérifier la réponse pour savoir si le père a acheté du pain ou non. Souvent nous rétorquons à ce genre de réponse : « Tu crois ou tu es sûr ? ». Dans le mot croire en français, il n’y a pas de certitude comme dans « emouna » en hébreu !
Lorsque nous disons « Amen » à une prière, ou à une affirmation, nous disons en substance : « Je reconnais ce qui vient d’être dit, comme véritable, certain et sûr, et je place toute ma foi et mon être dans cette prière, ou affirmation, en la reconnaissant comme quelque chose de véritable ! »
Lorsque Jésus voulait dire à ceux qui l’écoutaient, quelque chose d’important, sur laquelle ils pouvaient placer leur foi, dans nos traductions il est dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis… ». En hébreu cette expression se dit : « Amen vé amen » ! C’est la vérité, cela est véritable et sûr !
Frères et sœurs, ne disons pas amen de manière légère à toutes sortes de prières ou de paroles, car ce faisant, nous nous engageons pleinement en elles. Lorsque nous disons « amen » à la Parole de Dieu, nous proclamons : Cela est véritable et nous plaçons toute notre confiance dans cette Parole, nous la prenons pour fondement de notre foi (Emouna) !
Cependant, la racine « amen » donne un autre mot, ce mot c’est « mammon » ! « Mammon » est une chose que nous nous fabriquons nous même et sur laquelle nous plaçons notre confiance, notre foi !
C’est pour cela que Jésus disait à ses disciples que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et mammon, c’est-à-dire la richesse. Lorsque nous avons des richesses, celles-ci nous placent dans un certain confort et nous rassurent. Nous ne craignons pas l’avenir car nous les possédons. Notre foi et notre confiance sont placées dans ces richesses, que nous nous sommes accumulées. Si Dieu nous demande de les abandonner, alors bien souvent cela nous effraie, voire, nous terrorise, et nous sommes comme le jeune homme riche, nous repartons tout triste !
Cependant, nos richesses, ne sont pas forcément matérielles ! Ce peut être notre vie, notre situation, nos affections, nos réussites, notre bonheur, tout ce sur quoi nous plaçons notre foi et notre confiance !
Abandonner notre vie pour placer notre « foi », notre « emouna », sur Dieu seul et sa Parole, n’est pas chose aisé pour des êtres charnels tels que nous ! Mais c’est le seul chemin d’une vraie vie épanouie ! Nous ne pouvons trouver la plénitude d’une vie accomplie que dans un abandon total à Dieu, en Jésus-Christ, et en plaçant notre « emouna » sur ce qu’Il dit et fait !
Nous avons tendance à penser que nous devons « fabriquer » nous même l’objet de notre foi et de notre confiance, et parfois cela peut être même nos activités spirituelles ! Mais nous lorsque nous nous abandonnons entre les mains de notre Seigneur dans une foi véritable, en acceptant de « perdre » notre vie, nous sommes surpris de constater que ce chemin nous rempli de satisfaction, de paix et de repos !
Source : « LA BIBLE D'APRÈS LES TEXTES HÉBREU » - par Philippe Dehoux.
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• ABSENCE (du Seigneur) - En l’attendant, il faut veiller et tenir sa lampe allumée, être prêt pour son retour.
Dans beaucoup de paraboles, le Seigneur est absent. Dans celle de la croissance (Marc 4 v. 27) il est loin jusqu’à la moisson ; pendant son absence, il s’agit de porter du fruit. Dans la parabole des noces, le roi n’apparaît pas avant que les invités soient rassemblés. Pendant tout le temps où les esclaves vont et viennent et réunissent ceux qui doivent participer aux noces, le roi est absent. Il en est de même en Luc 14, dans les paraboles des conviés (v. 8 et 16). Pendant son absence, il faut prendre la place de l’humilité, inviter aux noces, chacun pour soi répondre à son invitation.
Dans le récit de Luc 10, après avoir amené le blessé dans l’hôtellerie, le Samaritain s’en va ; mais il reviendra bientôt : il n’a laissé que deux deniers pour pourvoir aux besoins de son protégé. En l’absence du Seigneur, les siens ne doivent-ils pas soigner les blessés et, conduits par le Saint Esprit (divin hôtelier), s’occuper de ceux qui sont dans l’hôtellerie ? En Marc 13 v. 34, l’homme qui s’en va hors du pays, laisse sa maison à ses esclaves et confie à chacun son ouvrage. Pendant qu’il est loin, il importe, comme en Luc 12, de veiller et de nourrir ceux de sa maison.
Dans la parabole des dix vierges, l’Époux n’est pas encore venu. En l’attendant, il faut veiller et tenir sa lampe allumée, être prêt pour son retour. Enfin, dans la parabole des talents, ce n’est que longtemps après que le maître revient régler compte avec ses serviteurs. En son absence, il importait de faire valoir ce qu’il avait confié.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMIS (les trois) (1) - Nous perdons trop vite des yeux qu’il y différentes manières de voir la prière.
Luc 11 v. 5 à 8. Les paraboles du Seigneur sont riches en enseignements pratiques. Dans quelques-unes d’entre elles, le Seigneur prend le sujet de la prière, et met l’accent sur son importance vue sous différents aspects. Certaines paraboles ont été prononcées pour montrer aux gens comment et quand ils devaient prier. D’autres donnent des exemples de prières, des bonnes et des mauvaises, des prières pressantes et des prières qui viennent trop tard. La parabole du juge inique avec la veuve qui l’importune est introduite par cette parole : « Et il leur dit aussi une parabole, pour (montrer) qu’ils devaient toujours prier et ne pas se lasser (Luc 18 v. 1) ».
Parfois, Dieu nous laisse prier longtemps pour une seule et même chose, pour éprouver notre foi et notre persévérance. D’autres fois, il exauce notre prière immédiatement et directement. Lorsque Daniel s’humiliait devant Dieu, la réponse est venue aussitôt, pendant qu’il priait encore (Daniel 9 v. 21). Mais dans une autre circonstance, nous voyons Daniel mener deuil « trois semaines entières » avant de recevoir une réponse (Daniel 10 v. 2). Dans ce cas, Dieu voulait lui donner l’occasion de s’unir à Ses intérêts et Ses pensées. Et c’est ainsi que le prophète a eu trois semaines entières pour prier et attendre avant que Dieu lui accorde ce qu’il avait demandé au bord du fleuve Hiddékel. Mais c’était certainement un temps de communion précieuse avec Dieu. Car la persévérance dans la prière rend plus profondes la communion avec Dieu et la conscience de notre dépendance de Lui.
Il y a des cas où nous sommes exhortés à demander avec persévérance et même avec ténacité, alors que dans d’autres, pour telle prière précise, nous sommes invités à cesser de prier. C’est ce dernier cas qu’a vécu l’apôtre Paul. Après que le Seigneur lui ait montré clairement qu’Il ne donnerait pas suite à sa demande de lui retirer son « écharde pour la chair », Il lui a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité (2 Corinthiens 12 v. 9) ». De même, Moïse, après avoir supplié l’Éternel instamment et à plusieurs reprises de lui permettre quand même de passer dans le pays promis, reçut finalement la réponse : « C’est assez, ne me parle plus de cette affaire (Deutéronome 3 v. 26) ».
Ces contrastes dans la manière dont Dieu répond à nos prières peuvent être un sujet de difficultés pour nous. Cependant nous avons besoin de la foi dans tous les cas, soit que Dieu nous exauce immédiatement, soit qu’il nous fasse attendre « trois semaines entières ». Nous ne supporterions certainement guère si Dieu nous répondait toujours de cette manière. La foi est autant nécessaire pour persévérer dans la prière, que pour cesser de prier pour telle chose particulière et laisser Dieu agir selon Ses voies à notre égard. La paisible soumission à la volonté de Dieu, même si ce que nous avons demandé ne peut pas nous être accordé, ne peut être réalisée que dans une pleine confiance en Sa bonté et en Sa sagesse.
Une telle opposition entre différents côtés d’une seule et même vérité, ici en rapport avec la prière, me paraît toujours particulièrement à sa place lorsque nous voulons ne nous occuper que d’un côté particulier, et que nous voulons en forcer l’application. Nous perdons trop vite des yeux qu’il y aussi d’autres manières de voir. Seul cet équilibre intérieur nous gardera d’un point de vue exclusif, ou pire, du fanatisme.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMIS (les trois) (2) - La connexion avec le comportement humain est caractéristique de l’évangile que Dieu nous a donné par Luc.
Deux paraboles nous enseignent la valeur de la prière instante et persévérante : celle des trois amis en Luc 11 et celle de la veuve et du juge inique en Luc 18. Il est désirable de faire une comparaison entre les deux, mais nous ne voulons le faire que plus tard, quand nous aurons considéré de plus près la parabole de Luc 11. Nous la désignons par le titre des trois amis parce que nous y voyons trois amis : l’ami qui a faim, l’ami qui demande, et l’ami auquel la demande est faite.
« Et il leur dit : Qui sera celui d’entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui présenter ? Et celui qui est dedans, répondant, dira : Ne m’importune pas ; la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi ; je ne puis me lever et t’en donner. Je vous dis que, bien qu’il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin (Luc 11 v. 5 à 8) ».
Au début du chapitre 11, juste avant cette parabole, Luc nous rapporte un autre exemple de cela, celui du Seigneur, comme homme dépendant, priant Son Dieu. Stimulés par l’exemple de leur Maître, les disciples paraissent avoir reconnu la nécessité de la prière, en sorte que l’un d’eux demande au Seigneur : « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Là-dessus, le Seigneur leur donne la prière qu’on appelle le Notre Père, une prière merveilleuse qui était parfaitement adaptée à la situation et à l’époque où se trouvaient les disciples. Ceux-ci ne se trouvaient pas encore dans la position chrétienne, car le Seigneur n’était pas encore passé par la mort et la résurrection. À quoi cela aurait-il servi, si le Seigneur leur avait imposé des demandes (chrétiennes) qu’ils n’auraient absolument pas été en mesure de comprendre en tant que Juifs à ce moment-là ? Même si cette « prière du Seigneur », comme on l’appelle souvent, a eu une grande importance pour le résidu juif de l’époque, et en aura aussi une grande pour le résidu juif futur, elle n’en contient pas moins des principes moraux que nous ne devons pas non plus méconnaître aujourd’hui.
Pour approfondir chez Ses disciples la conscience de l’importance de la prière, le Seigneur ajoute cette parabole des trois amis. Les traits en sont particulièrement vifs, et il vaut la peine d’en considérer à la fois les parallèles et les contrastes. En partant du comportement typique d’un homme, des conclusions sont tirées sur le comportement de Dieu. La connexion avec le comportement humain est caractéristique de l’évangile que Dieu nous a donné par Luc.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMIS (les trois) (3) - Ne négligeons pas la prière pour les autres.
La parabole nous présente d’abord l’ami qui fait une requête. Il ne demande pas pour lui-même, mais pour un autre ; il se charge de son cas et s’emploie en sa faveur. Nous pouvons aussi certainement faire ces deux choses : prier pour nous-mêmes et prier pour les autres. Tous les deux sont justes et nécessaires. Sachons voir au-delà de nos propres intérêts et ne négligeons pas la prière pour les autres, pour tous les saints (Éphésiens 6 v. 18) et pour tous les hommes et tous ceux qui sont haut placés (1 Timothée 2 v. 1 à 2). C’est sur la première catégorie que nous avons à apprendre ici. Ce qui nous frappe, c’est la concision de la requête. Le demandeur ne fait pas un long exposé à son ami, mais il formule au contraire sa demande d’une manière claire et précise : « Ami, prête-moi trois pains ». Il n’a pas besoin de deux, ni de quatre pains, mais de trois, et c’est ce qu’il dit à son ami.
Combien nous avons à apprendre de cet exemple ! Spécialement quand nous prions en public, efforçons-nous de prier de façon précise et concrète, et ne nous perdons pas en considérations interminables. Faire un exposé à Dieu quand nous sommes à genoux, c’est le contraire de ce que le Seigneur nous enseigne ici. On ne peut pas toujours éviter les prières ayant un contenu général ; mais des demandes concrètes dévoilent un intérêt profond pour la personne ou la chose dont il s’agit.
Le caractère pressant de la demande est encore souligné dans la parabole par le fait que celui qui adresse la requête se présente à la porte de son ami à une heure tout à fait indue. Il est lui-même trop pauvre, ou il n’est momentanément pas en mesure de nourrir son ami arrivé de voyage. Il va donc en confiance chez son ami qui est dans l’aisance, et il frappe à sa porte à l’heure où l’on dort. Il ne se laisse pas plus impressionner par son refus (« Ne m’importune pas »), que par toutes ses explications sur l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’aider sur le champ. Quand bien même la porte est déjà fermée, il continue à frapper jusqu’à ce qu’il ait en main ce qu’il demande.
Dieu prend plaisir à ce que ses enfants manifestent une certaine insistance dans leurs prières, voire même de la ténacité. Nous trouvons cette pensée chez les prophètes : « Vous qui faites se ressouvenir l’Éternel, ne gardez pas le silence, et ne lui laissez pas de repos… (Ésaïe 62 v. 6 et 7) ». Abraham n’a-t-il pas déjà manifesté cette ténacité lorsqu’il intercédait devant l’Éternel en faveur de la ville de Sodome, et qu’il diminuait progressivement le nombre possible des justes qui s’y trouvaient (Genèse 18 v. 22 à 33) ? N’en a-t-on pas un peu le souffle coupé quand on lit cette histoire dans Genèse 18 ?
Une telle persévérance dans la prière honore le Dieu Tout-puissant : « Car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que (Dieu) est, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent (Hébreux 11 v. 6) ».
L’humble confession de notre propre indigence est une condition supplémentaire importante pour que la prière soit agréable à Dieu. L’ami qui venait demander était conscient de son dénuement et de son incapacité à venir en aide à son ami affamé ; c’est pourquoi il s’adresse à son ami manifestement mieux pourvu que lui. Nous aussi, nous sommes entièrement incapables de nourrir à l’aide de nos propres ressources les personnes affamées qui nous entourent, qu’il s’agisse des besoins des pécheurs perdus ou de ceux des enfants de Dieu manquant du nécessaire. Pourtant nous connaissons Celui qui est riche, riche aussi en miséricorde : c’est notre Dieu et Père. Allons à Lui lorsque nous avons besoin de pain, tant pour nous-mêmes que pour les autres !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMIS (les trois) (4) - Si nous venons à Dieu pour prier, nous ne prions pas un ami, mais Dieu Lui-même.
Dans l’application de la parabole, il y a des parallèles évidents entre l’ami qui demande et l’attitude qui nous est recommandée. Il en est autrement avec l’ami riche auquel est adressée la requête. Si on fait l’application à Dieu, on trouve plus de contrastes que de parallèles. Souvent ce sont justement les contrastes qui nous offrent les leçons à apprendre. Tel est le cas ici. Le Seigneur Jésus n’a pas honte de nous nommer Ses « frères » ou Ses « amis ». (Hébreux 2 v. 11 et 12 ; Jean 15 v. 14 et 15). Or si nous venons à Lui pour prier, nous ne prions pas un ami, mais Dieu Lui-même. C’est le premier contraste, et nous devons toujours être conscients de qui est la personne à qui nous nous adressons en prière. Le Seigneur Jésus à qui nous adressons notre prière, est Dieu ; notre Père à qui nous adressons notre prière, est Dieu. Un ami se tient sur un pied d’égalité, mais Dieu est infiniment élevé au-dessus de nous. Il est Souverain absolu.
Est-il concevable que nous puissions venir à Lui à un moment qui Le dérange ? Est-il pensable qu’Il nous dise : « Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée » ? Est-il possible qu’Il allègue une quelconque excuse pour nous renvoyer ? Mille fois non ! « Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas (Psaume 121 v. 4) ». Il aime à donner, Il donne plus que ce que nous lui demandons, et Il est toujours bien disposé. Nous n’avons jamais à craindre de troubler Son repos, ni de Le fatiguer. Si nous pouvons nous servir encore une fois de l’image de l’ami, et l’appliquer au Seigneur, nous apprenons alors du livre des Proverbes cet encouragement consolant : « L’ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse (Proverbes 17 v. 17) ».
Le motif pour lequel celui qui demande obtient ce qu’il demande, fait aussi ressortir clairement une grande différence entre la manière d’agir de Dieu et celle de l’ami à qui est adressée la demande dans notre parabole. Ce dernier se voit non seulement dérangé dans son repos, mais il nourrit aussi des sentiments égoïstes et peu aimables envers son prochain. C’est pour cela qu’il commence par lui opposer un refus. Ce n’est que lorsqu’il est amené à craindre d’être incommodé plus longtemps par son insistance, qu’il se lève, cela est devenu subitement possible malgré les enfants au lit, et qu’il lui donne ce dont il a besoin. Il le lui donne, non pas parce qu’il est son ami, mais à cause de son culot.
Dieu donne-t-Il pour de tels motifs et de cette manière ? Non, bien sûr ! Notre Père est l’amour parfait et la bonté parfaite. Il aime à nous bénir, et Il bénit surabondamment ceux qui, en toute confiance, viennent à Lui avec leurs besoins. Il s’ensuit que la leçon essentielle de notre parabole est la suivante : Si la persévérance conduit déjà au but de la part d’un homme qui n’y voit que de l’importunité, combien plus Dieu répondra-t-Il aux appels persévérants de Ses enfants qui se confient fermement en Lui !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMIS (les trois) (5) - Comparaison sommaire avec la parabole de « la veuve ».
Nous sommes impressionnés par la manière dont notre Seigneur et Sauveur nous enseigne aussi dans cette parabole. Or le Seigneur y rajoute le principe divin suivant : « Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera ouvert (Luc 11 v. 9 et 10) ». Ces paroles ne sont-elles pas propres à conférer à nos requêtes ce caractère d’urgence, auquel Dieu aime tant répondre ? Mais faisons bien attention à ceci : l’urgence et la persévérance, c’est à nous de les avoir, non pas à Dieu.
Nous n’avons pas encore considéré la parabole du juge inique et de la veuve en Luc 18. Faisons quand même ici une comparaison entre l’ami et la veuve. Dans les deux paraboles il y a un contraste duquel nous avons à apprendre, le contraste entre ce qu’est l’homme et ce qu’est Dieu. Il ne peut pas être plus immense. Un juge inique se voit contraint de donner suite à la demande de la pauvre veuve, mais il le fait parce qu’il est tourmenté par ses cris incessants. Un ami malveillant se voit contraint de se lever au milieu de la nuit pour répondre aux besoins de son voisin, mais il ne le fait qu’à cause de son importunité.
Or ce que Le grand Maître qui enseigne veut faire savoir, c’est que, si la ténacité arrive à ses fins même de la part de gens mal disposés, et qu’elle permet d’obtenir le bienfait, combien plus le Dieu de bonté laissera-t-Il se déverser Sa bénédiction sur vous quand vous lui demandez avec sérieux, avec persévérance et avec foi. La veuve est allée vers le juge pour lui exposer sa propre cause. L’ami, par contre, est intervenu en faveur de son frère affamé. Ainsi le Seigneur nous enseigne dans ces deux paraboles que nous devons prier pour nous-mêmes et pour les autres, jusqu’à ce que nous soyons exaucés. L’une de ces paraboles illustre l’exhortation : « Demandez, et il vous sera donné » ; et l’autre, l’exhortation « Frappez, et il vous sera ouvert ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMOUR du PÈRE (pour son Fils) - C’est pour Jésus que Dieu cherche une épouse.
En Matthieu 22 v. 2, un roi fit des noces « pour son fils ». Nous lisons souvent cette parabole en pensant aux conviés, à leurs excuses ; nous voyons les invités de plus en plus nombreux entrer dans la salle des noces ; nous considérons les esclaves persévérant dans leur tâche ; mais Dieu veut, en première ligne, attirer notre attention sur son Fils. C’est pour Lui qu’il cherche une épouse (Genèse 24) ; c’est à Lui que doit revenir toute gloire.
En Marc 12:6, après le rejet renouvelé des esclaves, le père « ayant encore un unique fils bien aimé, le leur envoya ». L’Éternel dit à Abraham en Genèse 22 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac .. ». Quatre fois dans l’évangile de Jean, il nous sera répété que le Père aime le Fils : avant la fondation du monde, dans sa vie sur la terre, alors qu’il laisse sa vie, et en mettant toutes choses entre ses mains.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMOUR du PÈRE (pour le pécheur) - Les hommes seront jugés selon leurs œuvres, chacun recevra la rétribution que mérite sa conduite.
La parabole du fils prodigue en Luc 15, en est le merveilleux tableau. C’est l’amour qui reçoit, qui accueille, l’amour parfait qui chasse la crainte (1 Jean 4 v. 18). Quoi de plus normal qu’après l’inconduite du fils, le père, avec tout son désir de bien l’accueillir, l’eût laissé venir tremblant frapper à la porte. Mais tel n’est pas le cœur de Dieu : « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers ! »
Donner des vêtements au prodigue couvert de haillons et lui offrir un bon repas pour marquer son retour aurait pu suffire. Mais le père fait amener dehors la plus belle robe ; il ne se contente pas de dire : mange et rassasie-toi ; il dit : « Mangeons et faisons bonne chère » ; il invite le fils à sa propre table, et toute la maison doit se réjouir parce que celui qui était mort est revenu à la vie. « Le Père lui-même vous aime ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AMOUR du FILS - Du champ du monde, Jésus tire Son trésor, composé de tous Ses rachetés.
Le trésor et la perle (Matthieu 13 v. 44 à 46).
Ces deux paraboles ne nous présentent pas, comme on le dit parfois, le pécheur qui trouve le trésor du salut ou découvre en Jésus la perle de grand prix. En effet, le pécheur n’est pas appelé à vendre tout ce qu’il a et à acheter le salut ; la grâce est offerte gratuitement à qui l’accepte. Mais ces deux récits nous présentent le Seigneur Jésus lui-même qui, sachant quel trésor il allait tirer de ce monde, a tout donné pour l’acquérir. « Il s’en va ! » Cela ne rappelle-t-il pas peut-être le bouc azazel qui s’en allait chargé des péchés d’Israël (Lévitique 16 v. 8 ; 21 et 22) ? Au moment où il démasque Judas, le Seigneur Jésus dira : « Le fils de l’homme s’en va (Matthieu 26 v. 24) ». « Il vend tout ce qu’il a » : pensons à tout ce que le Seigneur a laissé : il s’est anéanti lui-même ; comme homme, il s’est abaissé ; il a renoncé à tous ses droits de Messie, à toute la considération qui lui était due de la part des hommes, même à la sympathie de ses disciples ; il s’est livré lui-même.
Du champ du monde, il tire ce trésor, composé de tous ses rachetés ; autant de joyaux précieux dont chacun d’eux a été acquis, et qui, tous ensemble, forment le trésor (Galates 2 v. 20 ; Éphésiens 5 v. 2). Il est aussi ce marchand qui cherche de belles perles et en a trouvé une de très grand prix ; pour elle aussi il vend tout ce qu’il a et l’achète. Perle qui nous parle de son épouse, de l’Église pour laquelle aussi il s’est livré lui-même (Éphésiens 5 v. 25).
Le Samaritain (Luc 10 v. 30 à 37).
Pourquoi, dans cette parabole, le Seigneur Jésus a-t-il choisi de se dépeindre sous les traits d’un Samaritain ? N’était-il pas lui-même un homme méprisé (Jean 8 v. 48), celui que la nation abhorre ? (Ésaïe 49 v. 7). « Allant son chemin », en parfaite grâce, il descendait du lieu de la bénédiction (Jérusalem) vers celui de la malédiction et de la mort (Jéricho). Ému de compassion, il s’approche (cf. Luc 15 v. 20) ; il bande les plaies ; il met le blessé sur sa propre bête et le mène dans l’hôtellerie ; il a soin de lui, et pourvoit ensuite à tous ses besoins pour le temps de Son absence.
Le bon berger.
En Luc 15 v. 4 à 7, nous contemplons l’amour qui cherche jusqu’à ce qu’il ait trouvé ; l’amour qui porte sa brebis sur ses propres épaules. Il est allé après elle quand elle était perdue ; mais en Jean 10, il va devant celles qui le suivent, belle image de l’amour qui conduit. Cinq fois dans ce dernier chapitre, il nous est répété qu’il met sa vie pour les brebis.
Le grain de blé (Jean 12 v. 24).
Le Samaritain allait son chemin ; le Berger cherchait jusqu’à ce qu’il ait trouvé ; mais le grain doit mourir : « Tu nous aimas jusqu’à la mort, Sauveur plein de tendresse…».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• AVEUGLE (conducteurs d'aveugles) (1) - Besoin de nouvelle naissance, pas seulement d’amélioration de nos vies.
En Matthieu 15 v. 14 le Seigneur emploie une image des scribes et des pharisiens que nous appellerions à peine une parabole à cause de sa brièveté. Mais dans le passage parallèle de l’évangile selon Luc, il est dit expressément : « Et il leur disait aussi une parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse ? (Luc 6 v. 39) ».
Certes, c’est une très petite parabole mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne contient pas de précieux enseignements pour nous. Comme Matthieu nous le montre, le Seigneur Jésus prononce ces paroles à la suite du reproche des pharisiens aux disciples de Jésus qui mangeaient le pain sans s’être lavé les mains. Le Seigneur les dénonce comme hypocrites, car eux-mêmes transgressaient le commandement de Dieu à cause de leur tradition, et ainsi l’annulaient (Matthieu 15 v. 1 à 6). Les doctrines qu’ils enseignaient au peuple n’étaient rien d’autre que des commandements d’hommes, comme le Seigneur le dit clairement à l’aide d’une citation d’Ésaïe (Matthieu 15 v. 9). Ils commettaient l’erreur habituelle de croire qu’on peut plaire à Dieu par des choses extérieures, et ils oubliaient que même Satan peut se servir d’un système religieux (comme le leur ou le notre) pour atteindre son but de faire du mal. Leur formalisme creux ne les menait pas seulement à l’hypocrisie, comme on l’observe de manière générale ; mais en rajoutant leurs règlements humains à la parole de Dieu, ils enlevaient la force à Sa sainte parole.
Tout à coup, le Seigneur se détourne d’eux et appelle la foule. C’est à celle-ci, et non aux pharisiens, qu’Il enseigne que ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme, mais ce qui en sort. Le problème n’était pas le fait de manger avec des mains non lavées. Il se trouvait beaucoup plus dans le cœur méchant de l’homme et dans tout ce qui découle de cette source (Matthieu 15 v. 19 et 20). Entendre cela était une pierre d’achoppement pour les pharisiens de l’époque, et il en est encore ainsi de nos jours pour l’homme religieux. On ne veut pas admettre que l’homme a une nature corrompue et que, pour cette raison, ce n’est pas d’amélioration qu’il a besoin, mais de nouvelle naissance (Jean 3 v. 3 à 5). Il n’y a que l’implantation d’une vie nouvelle et divine qui peut apporter remède et salut. Ceux qui possèdent cette vie, le Seigneur les compare aux « plantes » que Son Père céleste a plantées. Les pharisiens n’en faisaient pas partie. Toutes les plantes que le Père n’avait pas plantées seraient déracinées, une image sérieuse du jugement à venir (Matthieu 15 v. 13).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• AVEUGLE (abandonnés à leurs propres voies) (2) - Pour ceux qui sont des adversaires déclarés de la vérité.
Après cette déclaration assez générale du verset 13, le Seigneur recommence à parler directement des pharisiens, et dit ceci aux disciples à leur sujet : « Laissez-les ; ce sont des aveugles, conducteurs d’aveugles : et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse (Matthieu 15 v. 14) ». Cette expression « Laissez-les » est extrêmement sérieuse. Ces hommes n’avaient rien d’autre à attendre que le jugement, aussi les disciples devaient les laisser, les laisser faire. Ils ne devaient pas discuter avec eux dans l’espoir d’arriver finalement à les convaincre. De façon similaire, l’apôtre Paul met le jeune Timothée en garde contre Alexandre, l’ouvrier en cuivre, qui lui avait fait beaucoup de mal : « Garde-toi aussi de lui, car il s’est fort opposé à nos paroles (2 Timothée 4 v. 14 et 15) ». Qu’y a-t-il de plus sérieux que Dieu abandonnant un homme et le laissant poursuivre ses propres voies ? Certes, Il rend témoignage de Lui-même à chaque homme, et cela plusieurs fois (voir Job 33 v. 29 et 30). Mais si celui-ci ne veut définitivement pas revenir, Dieu le laisse finalement aller. Ces paroles « Laissez-les ! » s’adressent également à nous aujourd’hui à l’égard de ceux qui sont des adversaires déclarés de la vérité.
À quoi sert-il de discuter sur des questions de doctrine avec quelqu’un qui est encore spirituellement mort, et qui est peut-être un opposant déclaré à la vérité ? Ce n’est pas seulement inutile, mais c’est même dangereux. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus avertit Ses disciples de ne pas donner ce qui est saint aux chiens, ni de jeter les perles aux pourceaux, « de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent (Matthieu 7 v. 6) ». Il ne faut pas tendre la main à un mauvais usage de la grâce.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• AVEUGLE (état d'aveuglement) (3) - Ne venir à Christ montre une incomprehension des Écritures, c'est être aveugle aveugle.
Avant de nous occuper des conducteurs religieux d’Israël, nous aimerions jeter un coup d’œil sur ceux qu’ils enseignaient. Le Seigneur jugeait que, dans l’ensemble, les Juifs étaient des « aveugles », aveugles quant à eux-mêmes et aveugles quant aux pensées de Dieu. C’est vraiment un jugement sérieux ! Comme nous le verrons plus tard, cela n’implique rien moins, pour ces Juifs, que de partager plus tard le sort terrible de ceux qui les enseignaient. Le jugement des pharisiens sur leur propre peuple était pourtant méprisant : « cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite (Jean 7 v. 49) ». Quel orgueil émane de ces paroles !
Outre la propre justice, cet orgueil était l’un des caractères principaux des conducteurs religieux. Dans la parabole du « pharisien et du publicain », le Seigneur place ces deux caractères l’un à côté de l’autre : ces gens mettaient leur confiance en eux-mêmes, se croyant justes ; et ils méprisaient les autres (Luc 18 v. 9). Ils avaient pourtant pris parmi le peuple d’Israël la position de docteurs (enseignants), et selon l’expression du Seigneur, ils s’étaient « assis dans la chaire de Moïse (Matthieu 23 v. 2) ». Ils se croyaient compétents et seuls autorisés à prendre des décisions quant à toutes les questions religieuses. Cette prétention venait de ce qu’ils possédaient les rouleaux de la Loi, et qu’ensemble avec les scribes, ils prenaient soin du texte sacré et veillaient à son respect et à son maintien. Étant instruits dans la loi, ils osaient se faire conducteurs d’aveugles (Romains 2 v. 19). Dans les synagogues, ils enseignaient le peuple, et exposaient en détails les dispositions de la loi.
Cela ne veut pas dire qu’ils les avaient comprises. Certes ils pensaient les avoir comprises, mais le Seigneur Jésus dit qu’ils étaient des aveugles conducteurs d’aveugles. Celui qui comprenait réellement les Écritures, devait reconnaître qu’elles rendent témoignage de Lui, et venir à Lui pour avoir la vie éternelle (Jean 5 v. 39 et 40). Mais ils ne venaient pas à Lui, et cela montre qu’ils n’avaient pas compris les Écritures, qu’ils étaient aveugles.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• AVEUGLE (origine) (4) - Notre grande responsabilité de ne pas déformer la parole de Dieu.
Cet aveuglement spirituel n’était pas seulement un simple hasard malheureux ; ce n’était pas non plus seulement l’aveuglement naturel de l’homme à cause de son état de péché. Non, c’est parce qu’ils croyaient voir, qu’ils étaient véritablement aveugles (Jean 9 v. 39 à 41). Nous traiterons ces versets de manière plus détaillée quand nous nous occuperons de la parabole de « la porte des brebis » en Jean 10. En tout cas, les pharisiens avaient refusé de « voir », et pour cela, eux qui voyaient (c’est-à-dire qui croyaient voir), ils allaient devenir aveugles. C’était un jugement de la part du Seigneur. Ils préféraient les ténèbres à la lumière (Jean 3 v. 19), et ainsi s’accomplissait en eux la prophétie de Sophonie 1 (1 v. 17) : « Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles ; car ils ont péché contre l’Éternel ; et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiente ». Être condamné à l’aveuglement, quel jugement sérieux ! Il commence déjà au temps actuel, et a des conséquences éternelles.
Il est presque effrayant de constater le nombre de fois, et la manière dont le Seigneur Jésus qualifie d’aveugles ces conducteurs spirituels dans Son discours de Matthieu 23. « Malheur à vous, guides aveugles ! (23 v. 16) » ; « fous et aveugles ! (23 v. 17) » ; « aveugles ! (23 v. 19) » ; « guides aveugles ! (23 v. 24) » ; « pharisiens aveugles ! (23 v. 26) ». S’ils avaient eu des yeux oints par l’Esprit, ils auraient été gardés de tomber dans la fosse. Mais comme ils croyaient voir, ils étaient en réalité aveugles, et ce sort tomberait justement sur eux. « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse ». Ainsi cette petite parabole se termine par cette allusion au jugement à venir qui porterait aussi bien sur les conducteurs que sur ceux qui étaient conduits.
Ne pouvons-nous pas appliquer cette parabole au temps actuel et aux différents états dans la chrétienté ? Très certainement ! Aujourd’hui comme autrefois, le « dieu de ce siècle », Satan, aveugle « les pensées des incrédules pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ ne resplendît pas pour eux (2 Corinthiens 4 v. 4) ». Mais quel jugement tombera sur ceux qu’il peut utiliser comme conducteurs spirituels pour opérer cet aveuglement ! Ceci ne place-t-il pas sur nous cette grande responsabilité de ne pas déformer la parole de Dieu, mais de présenter simplement la vérité devant les consciences des gens ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• AVEUGLE (triomphe de la grâce) (5) - Malgré l’aveuglement moral croissant des hommes, ce triomphe de la grâce se poursuit encore de nos jours.
Nous ne voulons cependant pas terminer le commentaire sur cette petite parabole sans présenter la grâce de Dieu qui peut agir malgré tout. Saul de Tarse était aussi un pharisien, et même un persécuteur de l’assemblée. Pourtant Dieu lui a ouvert les yeux, les yeux du corps comme les yeux spirituels (Actes 9 v. 12 à 18). Et non seulement cela, mais le Seigneur qui lui était apparu l’envoya vers d’autres, vers les nations, « pour ouvrir leurs yeux, pour qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière (Actes 26 v. 17 et 18) ».
Tandis que dans notre parabole les aveugles sont égarés par des aveugles, et finissent ensemble dans la fosse, les esclaves de la parabole du « grand souper », sur l’ordre du maître de la maison, amènent entre autres des aveugles trouvés dans les rues et les ruelles de la ville (Luc 14 v. 21). Eux aussi conduisent des aveugles, mais ils ne sont pas des aveugles conducteurs d’aveugles. Et où finit leur chemin commun ? Dans la salle de fêtes du Maître ou, selon la présentation correspondante de Matthieu 22, dans la salle des noces du roi. Si le Seigneur amène à Lui de tels aveugles, ne peut-on pas penser qu’Il leur a d’abord ouvert les yeux avant qu’ils prennent place à Sa table ? Le prophète Élisée nous en donne un bel exemple. Quand il accompagna à Samarie les Syriens ennemis frappés d’aveuglement, il pria : « Éternel, ouvre les yeux à ces hommes, afin qu’ils voient. Et l’Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent… » Et alors un grand repas leur fut préparé (2 Rois 6 v. 19 à 23) ».
Quel triomphe de la grâce de Dieu ! Malgré l’aveuglement moral croissant des hommes, ce triomphe de la grâce se poursuit encore de nos jours.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• ARCHE (du témoignage) - Le seul lieu de rencontre entre l’Éternel et son peuple par l’intermédiaire de Moïse et d’Aaron. Deux figures du double caractère du service de Christ envers nous ; l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession .
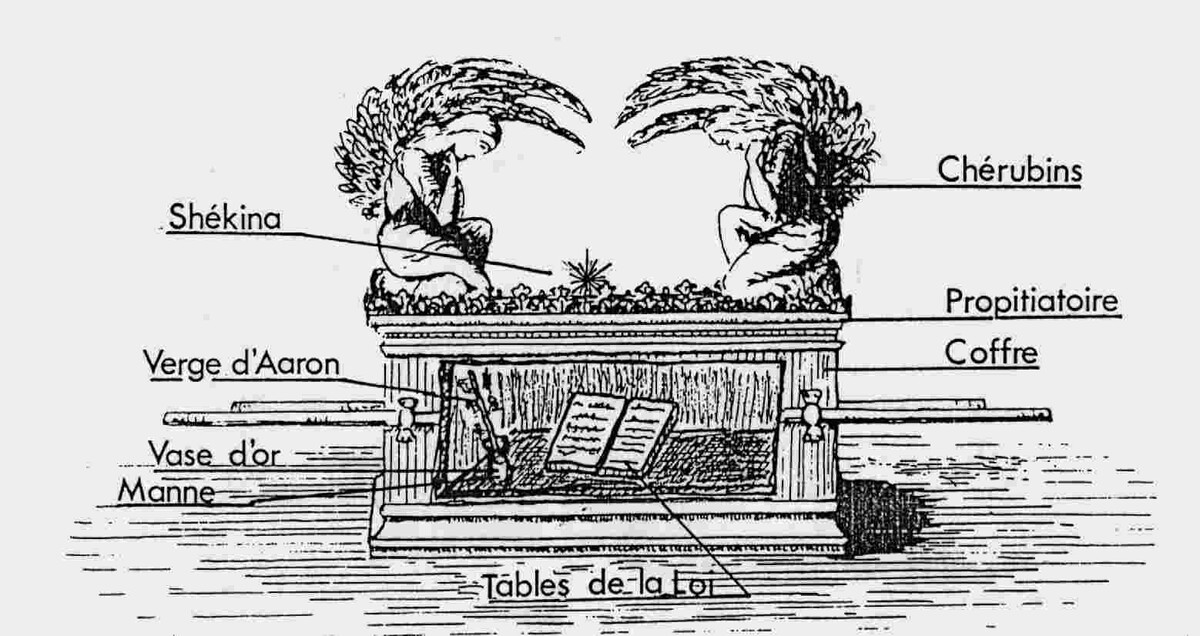 Au-delà du « Voile », dans le « Très Saint », il n'y avait qu'un seul meuble, « l'Arche » ; image de notre acceptation en Christ et devant Dieu « au niveau spirituel », de l’œuvre de la croix et de notre position en Lui. L'arche est une sorte de coffre rectangulaire, fait de bois recouvert d'or, muni d'un couvercle d'or pur, appelé le « Propitiatoire ». Par dessus (et tirés de la même masse) étaient deux chérubins en or battu. Dans cette « Arche » (sous le Propitiatoire) étaient placés le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les deux Tables de la Loi. (Hébreux 9 v. 4). Une lumière surnaturelle apparaissait sur le Propitiatoire et brillait entre les chérubins, représentant la présence divine. C'était la seule lumière du « Très Saint ».
Au-delà du « Voile », dans le « Très Saint », il n'y avait qu'un seul meuble, « l'Arche » ; image de notre acceptation en Christ et devant Dieu « au niveau spirituel », de l’œuvre de la croix et de notre position en Lui. L'arche est une sorte de coffre rectangulaire, fait de bois recouvert d'or, muni d'un couvercle d'or pur, appelé le « Propitiatoire ». Par dessus (et tirés de la même masse) étaient deux chérubins en or battu. Dans cette « Arche » (sous le Propitiatoire) étaient placés le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les deux Tables de la Loi. (Hébreux 9 v. 4). Une lumière surnaturelle apparaissait sur le Propitiatoire et brillait entre les chérubins, représentant la présence divine. C'était la seule lumière du « Très Saint ».
- L'arche était composée de bois de Sittim (acacia réputépour sa résistance et son caractère imputrescible) ; image de l’incarnation de Christ et de sa vie d’homme sur la terre « saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs » (Hébreux 7 v. 26).
- Elle était plaquée d’or pur ; « symbole de la gloire intrinsèque de Dieu dans sa justice, sa sainteté, sa vérité, sa sagesse, sa puissance et son amour » (Apocalypse 21 v. 11 à 18) ». Tous les éléments qui parlent du Seigneur Jésus sont d’or pur, alors que ce qui parle des rachetés est simplement d’or (les ais, les traverses, les piliers du rideau). Nous sommes revêtus de Christ.
Signification spirituelle de « porter l’arche ».
Moralement, c’est notre précieux privilège, de porter dans nos cœurs Christ lui-même, et garder tout ce qui est de Lui, pour notre propre joie et aussi en témoignage devant le monde. Si nous portons sur nous le sceau céleste (le drap de bleu) de notre vie cachée en Christ (Colossiens 3 v. 3), nous rendrons témoignage à un Christ glorifié (le couronnement d’or) assis dans le ciel. L’Arche et le propitiatoire forment un tout : le trône de Dieu est devenu pour les rachetés un trône de grâce duquel nous pouvons nous approcher avec confiance en vertu du sang, et pour avoir du secours au moment opportun (Hébreux 4 v. 16). C’était le seul lieu de rencontre entre l’Éternel et son peuple par l’intermédiaire de Moïse et d’Aaron. Deux figures du double caractère du service de Christ envers nous ; l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession (Hébreux 3 v. 1).
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• AUTEL (des parfums) - La nature du feu est en rapport avec le culte rendu en esprit et en vérité ; la nature de l’encens est en rapport avec l’objet du culte, présenter Christ à Dieu.

Tout près du « Voile », se trouvait un petit autel de bois recouvert d'or, appelé « l'Autel d'or » ou « l'Autel des parfums ». Là, il n'y avait pas de feu, sauf lorsque le sacrificateur en apportait dans les encensoirs qui étaient placés au sommet de cet « Autel d'or », et qu'il émiettait l'encens dessus, Il se produisait alors une fumée odoriférante ou parfum qui, remplissant le « Saint », pénétrait aussi au-delà du « second voile », dans le « Très-Saint » ou « Saint des Saints ».
Cet autel est petit mais dépasse en hauteur d’1/2 coudée la grille de l’autel d’airain et la table : cette hauteur signifie que, tirés par l’amour de Christ dans nos âmes, nous nous élevons spirituellement à la hauteur de l’adoration. Combien est-il souhaitable que ce pas supplémentaire vers Dieu soit réalisé, car beaucoup de rachetés précieux au cœur du Seigneur, ne vont pas plus haut que l’autel d’airain ; c’est-à-dire pas plus loin que la jouissance que procure la certitude du salut de leur âme. Mais nous sommes appelés à monter plus haut, jusqu’à l’autel de l’adoration qui est aussi celui de l’intercession.
Pas de feu ni d’encens étranger.
C’était par le feu pris sur l’autel d’airain que le parfum consumé exhalait sa bonne odeur. Utiliser un feu étranger correspondait à faire appel à des ressources charnelles, des moyens humains pour présenter ce qui est de Dieu ; par exemple, un culte organisé à l’avance, qui ne serait pas sous la seule direction de l’Esprit.
Les deux fils d’Aaron, Nadab et Abihu (Lévitique 10), ont offert du feu étranger, et ils en sont morts. Ils n’avaient pas pris le feu où il aurait dû être pris, c’est-à-dire à l’autel d’airain, à la croix de Christ, le seul feu pouvant exhaler le parfum de l’excellence de la victime. Comme il est attristant de voir qu’au moment même où la sacrificature a été instituée, soit survenue cette faute de ces deux sacrificateurs ; Dieu n’a pas permis cela, car il sauvegarde les gloires qui sont dues à son Fils.
Offrir de l’encens étranger, ce serait offrir à Dieu autre chose que l’excellence de Christ, représentée dans la composition de cet encens composé de drogues odoriférantes. Exalter l’homme ou faire ressortir l’homme dans l’adoration n’est qu’un faux encens. Cela montre à nos cœurs et à nos consciences le sérieux qui se rattache au fait de s’approcher de l’autel d’or dans le sanctuaire. La nature du feu est en rapport avec le culte rendu en esprit et en vérité ; la nature de l’encens est en rapport avec l’objet du culte, présenter Christ à Dieu.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
B
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• BABEL, BABYLONE - Type du pouvoir religieux sans crainte de Dieu.
Babylone est la forme grecque de Babel qui, selon Genèse 11 v. 9, veut dire « confusion ». Le premier souverain de Babel mentionné dans la Bible fut Nimrod (Genèse 10 v. 9), « un puissant chasseur devant l’Éternel », c’est-à-dire un homme de pouvoir. En Genèse 11 s’ajoutent la présomption et l’exaltation de soi lors de la construction de la tour de Babel. Ce n’est que vers la fin de l’époque des rois d’Israël et de Juda que nous entendons de nouveau parler d’une manière plus détaillée de Babel. Les nouveaux habitants de la Samarie vinrent de Babel (ou Babylone) pour habiter dans le pays dépeuplé. Il est dit d’eux de manière caractéristique: «Ils craignaient l’Éternel, et ils servaient leurs dieux» (2 Rois 17, 33). Plus tard, le royaume de Juda fut emmené en captivité à Babylone. Les prophètes ont prédit le jugement irrévocable de Dieu sur Babylone (cf. Ésaïe 13 ; 14 ; Apocalypse 17).
Babylone est un type du pouvoir religieux sans crainte de Dieu et sans vie de Dieu, pouvoir qui, en fin de compte, n’est rien d’autre que l’idolâtrie. Ceci devient particulièrement manifeste en Apocalypse 17 où la chrétienté sans Christ, après l’enlèvement des vrais croyants, est jugée en tant que Babylone, la grande prostituée.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BALANCE - Type du pouvoir religieux sans crainte de Dieu.
En tant qu’instrument servant à peser (autrefois aussi l’argent), la balance est connue dès l’Antiquité (Genèse 23 v. 16). Dans la Bible, le pesage exact est assimilé à la droiture et à la justice (Lévitique 19 v. 36). Au sens figuré, Dieu seul peut peser les choses et porter un jugement juste (Proverbes 16 v. 2 à 11 ; 21 v. 2 ; 24 v. 12) ». Dans sa propre justice et sa détresse, Job supplie que sa calamité soit mise dans la balance et invite Dieu à le peser lui-même « dans la balance de justice (Job 6 v. 2 ; 31 v. 6) ». Toutefois, dans la balance de Dieu, les hommes sont pesés selon leur valeur intérieure et non pas extérieure (Psaume 62 v. 9) ; l’exemple le plus connu en est celui du roi babylonien Belshatsar auquel a été adressé le message divin Mené, Mené, Thekel, Upharsin : « compté, compté, pesé et divisé (Daniel 5 v. 27) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BALLE - Brûler la balle au feu ne se trouve que dans le Nouveau Testament.
Autrefois, lors du battage du blé, les déchets constitués par la balle et la paille étaient séparés du précieux grain, soit par le criblage du blé au moyen d’un grand crible, soit par le vannage au moyen d’une pelle. Ils étaient ensuite chassés par le vent ou brûlés au feu (Psaume 1 v. 4). L’image de la balle chassée par le vent nous montre ce qui est éphémère, qu’il s’agisse des hommes vivant loin de Dieu ou des puissants royaumes de ce monde (Job 21 v. 18 ; Ésaïe 29 v. 5 ; Daniel 2 v. 35). En revanche, nous ne trouvons l’action de brûler la balle au feu que dans le Nouveau Testament. Elle nous parle du jugement éternel de Dieu exercé contre les impies. Tandis que le blé (figure des rachetés) est assemblé dans le grenier, la balle (les perdus) est brûlée au feu inextinguible (Matthieu 3 v. 12 ; Luc 3 v. 17).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BAPTÊME - Généralement, le baptême et baptiser signifient l’identification avec une chose ou une personne.
Le baptême étant appelé, en 1 Pierre 3 v. 21, l’« antitype » (grec antitypon) du salut de Noé dans l’arche à travers l’eau du déluge, nous sommes autorisés à le classer au rang des figures et des symboles. Par le baptême chrétien, qui est le plus souvent mentionné dans le Nouveau Testament, le croyant se rattache à un Christ mort et enseveli, exprimant par là que dans ce monde de péché et d’impiété le salut ne peut être trouvé que dans Sa mort.
Sur toute la terre, il n’y a pour ainsi dire qu’une place qui est à l’abri du jugement de Dieu, savoir le tombeau de Christ (cf. Romains 6 v. 3 à 6). À la croix il a porté le juste jugement à l’égard du péché et a pris sur lui le salaire du péché, la mort. Ce n’est donc qu’en lui seul, mort pour nous, que nous sommes en sécurité. De plus, l’ensevelissement de Christ a été la dernière occasion où les hommes ont pu le voir. Après sa résurrection, il n’est apparu qu’aux siens. Ainsi le baptême pour la mort de Christ, le fait d’être enseveli avec lui témoigne que le croyant est mort aux éléments du monde (Colossiens 2 v. 12 à 20). De même qu’Il a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, de même nous pouvons et devons maintenant marcher en nouveauté de vie (Romains 6 v. 4).
Le baptême a aussi une signification en rapport avec la position du chrétien sur la terre. Le Seigneur Jésus dit en Marc 16 v. 16 : « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé ; et celui qui n’aura pas cru sera condamné ». Pour l’éternité, seule est nécessaire la foi en l’œuvre rédemptrice. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas s’en va dans la perdition éternelle. Cependant, quant à notre position sur la terre, le baptême est le signe déterminant du fait que nous sommes du côté de Christ, du Sauveur. C’est pourquoi Pierre dit aux Juifs : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés (Actes 2 v. 38) ». Pour cette raison aussi Ananias a pu dire à Saul : « Lève-toi et sois baptisé, et te lave de tes péchés (Actes 22 v. 16) ». Celui qui est baptisé pour Christ, l’a « revêtu (Galates 3 v. 27) » de façon extérieure, par profession. Ces différentes conséquences liées au baptême ne se rapportent pas à l’éternité mais à notre position sur la terre.
Le baptême chrétien a ainsi un double sens. D’une part il est un symbole de l’ensevelissement du vieil homme pécheur, crucifié avec Christ ; d’autre part, relativement à notre position terrestre, il nous amène hors du monde du côté d’un Christ méprisé et rejeté.
Par le baptême « pour les morts (1 Corinthiens 15 v. 29) », il ne faut pas entendre un baptême ultérieur de croyants pour (ou : à la place) des défunts qui n’étaient pas baptisés. Paul ne fait que réfuter ici l’absurdité de l’assertion que les morts ne ressuscitent pas : en effet, le baptême est la figure de notre ensevelissement avec Christ en vue de la résurrection à venir (cf. Romains 6 v. 4 ; Colossiens 2 v. 12 ; 1 Pierre 3 v. 21). La place des croyants délogés est occupée par ceux qui, après eux, sont baptisés en quelque sorte pour eux. Tout nouveau baptisé ne peut alors que considérer absurde un baptême qui lui fait prendre la place de croyants baptisés et endormis en Christ, mais qui auraient péri (cf. 1 Corinthiens 15 v. 18).
Dans un sens général, le baptême et baptiser signifient l’identification avec une chose ou une personne. Ainsi Paul pouvait écrire que les Israélites, à leur sortie d’Égypte, ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer (1 Corinthiens 10 v. 2). Jean le Baptiseur baptisait les Juifs repentants en vue du royaume de Dieu qui s’était approché (Matthieu 3 v. 2 à 6). Le Seigneur Jésus voyait dans la croix de Golgotha un baptême dont il devait être baptisé avant de pouvoir manifester tout son amour divin (Luc 12 v. 50). Le baptême du Saint Esprit, qui a eu lieu le jour de la Pentecôte (Actes 2) et qui a constitué tous les croyants en un seul corps, le corps de Christ (Actes 1 v. 5 ; 1 Corinthiens 12 v. 13), était l’accomplissement partiel de la prophétie de Jean le Baptiseur qui avait dit du Seigneur Jésus : « Lui vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu (Matthieu 3 v. 11) ». Le baptême du Saint Esprit a déjà eu lieu pour les croyants ; pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, le baptême de feu est le jugement éternel lors duquel, comme Juge, « il brûlera la balle au feu inextinguible (Matthieu 3 v. 12) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BÉLIER - Brûler la balle au feu ne se trouve que dans le Nouveau Testament.
Le bélier est un mouton mâle adulte et une image de la force. Il est mentionné plusieurs fois comme sacrifice (Genèse 15 v. 9 ; 22 v. 13 ; Lévitique 5 v. 15 ; 16 v. 3 ; Nombres 6 v. 17). Le bélier a joué un rôle particulier lors de la consécration du souverain sacrificateur Aaron et de ses fils (Exode 29 ; Lévitique 8). Outre un jeune taureau comme sacrifice pour le péché, deux béliers devaient être offerts, l’un comme holocauste, l’autre comme « bélier de consécration (Exode 29 v. 19 à 35) ». Celui-ci était une figure de l’entier dévouement à Dieu, non seulement dans la vie mais jusque dans la mort, manifesté en perfection par le Seigneur Jésus. Sur la tente d’assignation, il y avait une couverture de peaux de béliers teintes en rouge (Exode 26 v. 14) ; elle place devant nous un type du Seigneur Jésus dans son dévouement jusqu’à la mort sur la croix. À chaque instant de sa vie et de son service, Dieu a trouvé son plaisir dans une telle consécration (cf. Matthieu 3 v. 17 ; 17 v. 5 ; Éphésiens 5 v. 2) et, par Lui, il le trouve dans les croyants, parce qu’ils sont identifiés à lui (Éphésiens 1 v. 6).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BERGER, PASTEUR - Le pasteur est donné comme don par le Seigneur glorifié dans le ciel.
Dans la Bible, le berger (ou pasteur) joue un grand rôle. La richesse d’une société orientée principalement sur l’agriculture est basée sur la possession de bétail; c’est pourquoi le service du berger en Israël était une profession estimée. Parmi les conducteurs d’Israël, Moïse et David avaient été auparavant des bergers, comme aussi le prophète Amos (Exode 3 v. 1 ; 2 Samuel 7 v. 8 ; Amos 1 v. 1).
Dieu est le Berger suprême, et cela aussi bien pour chaque croyant (Psaume 23 v. 1) que pour Israël, son peuple terrestre (Psaume 80 v. 1 ; Ésaïe 40 v. 11 ; Jérémie 31 v. 10). Il prend soin des siens, il rassemble ceux qui sont perdus et leur donne ce qui leur est nécessaire. Le peuple sans conducteur est comparé à des brebis qui n’ont pas de berger (Nombres 27 v. 17 ; 1 Rois 22 v. 17 ; Matthieu 9 v. 36). Déjà dans l’Ancien Testament, le Seigneur Jésus est appelé prophétiquement berger ou pasteur (Genèse 49 v. 25 ; Ézéchiel 34 v. 23) et, dans un des passages les plus connus du Nouveau Testament, il se nomme lui-même « le bon berger (Jean 10 v. 10) ».
Les brebis connaissent sa voix et le suivent parce qu’il a mis sa vie pour elles, il va devant elles, il les connaît, il les appelle par leur nom et leur donne de la pâture. La conclusion de ce passage est merveilleuse : « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un (Jean 10 v. 27 à 29) ». Toutefois le Seigneur Jésus est non seulement le bon berger, mais aussi le grand pasteur des brebis (Hébreux 13 v. 20) et le souverain pasteur (1 Pierre 5 v. 4) qui est au-dessus de tout; rien n’échappe à ses yeux vigilants.
Le dernier passage mentionné nous conduit au service du pasteur envers les âmes des croyants, service exercé par les hommes. Déjà dans l’Ancien Testament, les chefs d’Israël sont appelés des pasteurs, et une distinction est faite entre les bons et les mauvais d’entre eux (Ézéchiel 34 v. 2 à 16). Dans le Nouveau Testament, nous trouvons, d’une part, le don de pasteur donné au corps de Christ, à l’Assemblée, don étroitement lié à celui de docteur (Éphésiens 4 v. 11) et, d’autre part, le service pastoral des anciens ou surveillants dans une assemblée locale (Actes 20 v. 28 ; 1 Pierre 5 v. 1 à 4). Si les services peuvent paraître semblables l’un à l’autre, il existe cependant une différence marquée entre les pasteurs et les surveillants ou anciens.
Le pasteur est donné comme don par le Seigneur glorifié dans le ciel ; il sert tous les membres du corps de Christ pour l’édification et l’avancement spirituels ; le service n’est limité ni à l’assemblée locale ni dans le temps, mais il durera « jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ », c’est-à-dire jusqu’à la venue du Seigneur (Éphésiens 4 v. 7 à 13). Dans le Nouveau Testament, les anciens (grec : presbyteros) ou surveillants (grec : episkopos) n’ont été établis comme tels que par des hommes autorisés à cet effet, pour exercer leur service dans un seul lieu et envers les croyants de cet endroit déterminé ; ils avaient davantage, mais non pas exclusivement, la charge extérieure de veiller. Enfin, aucun passage du Nouveau Testament ne fait mention d’une continuation de cette charge au-delà du temps des apôtres (cf. Actes 14 v. 23 ; 20 v. 17 à 28 ; Tite 1 v. 5 à 7 ; Philippe 1 v. 1 ; 1 Timothée 3 v. 1 à 7). Tous devaient cependant exercer leur service avec un « cœur de berger » et avoir devant les yeux le bien du troupeau.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BÊTE, ANIMAL - Brûler la balle au feu ne se trouve que dans le Nouveau Testament.
Une bête ne peut pas discerner entre le bien et le mal, et elle n’a point de conscience. C’est pourquoi l’appellation « bête » est employée parfois dans la Bible pour désigner l’état de l’homme qui est sans relation avec Dieu (Psaume 73 v. 22 ; 74 v. 19). Comme châtiment de Dieu, le roi Nebucadnetsar a reçu le cœur d’une bête (Daniel 4 v. 16). Les quatre bêtes de Daniel 7 v. 3 à 8 et les deux bêtes d’Apocalypse 13 v. 1 et 11 symbolisent des puissances de ce monde qui n’ont aucune relation morale intérieure avec Dieu.
Les mammifères qui, selon la loi, étaient purs et pouvaient par conséquent être mangés par les Israélites, devaient avoir l’ongle fendu et ruminer (Lévitique 11 v. 3) ; sur le plan spirituel, ces caractéristiques indiquent une marche droite et ferme, et le fait de s’occuper de façon réitérée de la nourriture de l’âme (Psaume 1 v. 2 ; 119 v. 97 ; 139 v. 24). Les poissons qui pouvaient être mangés devaient avoir des nageoires pour avancer et des écailles comme protection extérieure (Lévitique 11 v. 9) ; c’est une figure de l’énergie spirituelle dans la marche et dans la protection contre les dangers (1 Pierre 4 v. 1 et 2 ; 1 Jean 5 v. 18). D’entre les oiseaux, ceux qui se nourrissaient d’autres bêtes ou du corps mort d’une bête ne devaient pas être mangés (Lévitique 11 v. 13 à 19) ; en revanche, les granivores, telle la colombe, qui était aussi prescrite comme sacrifice, et les gallinacés, telles les cailles que Dieu a données à deux reprises à son peuple qui demandait de la chair, pouvaient l’être (Exode 16 v. 13 ; Nombres 11 v. 31).
D’entre tous les animaux plus petits (« d’entre tous les reptiles volants qui marchent sur quatre pieds (Lévitique 11 v. 21 et suiv.) », seules étaient permises différentes espèces de sauterelles (Matthieu 3 v. 4) qui répondaient à la description suivante : « ceux qui ont, au-dessus de leurs pieds, des jambes avec lesquelles ils sautent sur la terre », c’est-à-dire ceux qui peuvent spirituellement s’élever au-dessus de l’impureté de la terre qui gît sous la malédiction du péché. Tous les autres animaux étaient en abomination à Dieu et ne devaient pas être mangés (Lévitique 11, 10, 12 13, 20, 23). Ces ordonnances de la loi s’adressaient au peuple d’Israël et n’ont aucune valeur pour ceux qui, par la foi au Seigneur Jésus, ont été rachetés de la loi et de la malédiction qui s’y rattache (Galates 3 v. 13 ; 4 v. 5). Pierre a dû apprendre cette leçon avant d’être envoyé par Dieu vers Corneille, homme des nations (Actes 10 v. 9 à 16). Toutefois ces ordonnances continuent à avoir pour nous une signification spirituelle (cf. Romains 15 v. 4 ; 1 Corinthien 10 v. 6 à 11).
Dieu, comme Créateur, a soin du monde animal (cf. Psaume 36 v. 6 ; Jonas 4 v. 11). Dans le Millénium, les animaux aussi, affranchis de la malédiction du péché, changeront de comportement et, à leur manière, joindront leurs voix à Sa louange ; ce qui montre jusqu’à quel point la terre sera alors purifiée, quand bien même le serpent continuera à ramper sur le ventre et à manger la poussière (Psaume 148 v. 10 ; Ésaïe 43 v. 20 ; 65 v. 25).
En Ézéchiel 1 v. 5 et suivants et en Apocalypse 4 v. 6 et 7, les quatre « animaux » désignent les êtres symboliques qui caractérisent les principes de la souveraineté et des voies judiciaires de Dieu sur la création. Une traduction plus précise de ce terme serait : « êtres vivants ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BLANC - Le symbole de la pureté immaculée.
La couleur blanche est le symbole de la pureté immaculée, relativement à la position aussi bien qu’à la pratique. Déjà dans l’Ancien Testament cette couleur est vue comme le signe de la sainteté de Dieu, mais également comme le résultat du pardon des péchés. Le vêtement de l’Ancien des jours (une image de Dieu) était blanc comme la neige (Daniel 7 v. 9). Il est dit au psaume 51 v. 7 : « Purifie-moi du péché avec de l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige », et en Ésaïe 1 v. 18 : « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ». Dans le Nouveau Testament, le blanc est aussi la caractéristique du Fils de l’homme (Matthieu 17 v. 2 ; Apocalypse 1 v. 14). Le cheval sur lequel il sera assis lors de son apparition est blanc, et également le trône du jugement dernier devant lequel les incrédules recevront leur condamnation éternelle (Apocalypse 19 v. 11 ; 20 v. 11). Dans le livre de l’Apocalypse, les rachetés sont vus vêtus de longues robes blanches (Apocalypse 3 v. 4 et 5 ; 7 v. 9 ; 19 v. 14).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BLÉ, FROMENT - Le blé représente souvent un type de l’humanité parfaite du Seigneur Jésus.
Dans la Bible, le blé représente la céréale la plus précieuse et est souvent un type de l’humanité parfaite du Seigneur Jésus. Il se nomme lui-même le grain de blé qui devait tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruit (Jean 12 v. 24 ; cf. l’expression « fruit de la terre » en Ésaïe 4 v. 2). L’offrande de gâteau était faite de fleur de farine (farine de froment, Exode 29 v. 2 ; Lévitique 2 v. 1). À la fête des semaines (Pentecôte, fêtes de l’Éternel), selon Lévitique 23, v. 17, une offrande de gâteau nouvelle devait être présentée ; elle se composait de deux pains, en offrande tournoyée, cuits avec du levain ; et nous savons, par Exode 34 v. 22, qu’il s’agissait là des premiers fruits de la moisson du froment. Le blé est donc ici une figure des croyants qui possèdent la même nature que leur Seigneur. Il en est de même en Matthieu 3 v. 12 et 13 v. 24 à 30.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BŒUF, TAUREAU - Patience dans le service et de la fidélité dans le travail.
Le bœuf et le taureau (hébr. par, schor, grec, bous, etc.) sont souvent le symbole de la patience dans le service et de la fidélité dans le travail. En Deutéronome 25 v. 4, il est dit : « Tu n’emmuselleras pas le bœuf, pendant qu’il foule le grain ». 1 Corinthiens 9 v. 9 et 1 Timothée 5 v. 18, appliquent ce verset au serviteur du Seigneur, qui peut aussi s’attendre à une récompense matérielle pour son travail (cf. Galates 6 v. 6). Il est vrai que bien des fois Paul n’a pas usé de ce droit afin de n’être à charge à personne, de ne pas scandaliser et de réaliser le principe que l’Évangile doit être gratuit (Actes 20 v. 33 à 35 ; 1 Corinthiens 9 v. 12 à 19 ; 2 Thessaloniciens 3 v. 8).
Le taureau et le bœuf sont aussi l’image de la force (Genèse 49 v. 6 ; Proverbes 14 v. 4). Les animaux, semblables à un bœuf ou à un veau, qui se tenaient à l’entour du trône de Dieu (Ézéchiel 1 v. 10 ; Apocalypse 4 v. 7) parlent de force dans les voies et dans les actions de Dieu envers les hommes.
Dans l’Ancien Testament, le taureau, en tant qu’animal pur (cf. Lévitique 11 v. 3), représentait un sacrifice d’une valeur particulièrement élevée (Lévitique 1 v. 3 ; 4 v. 3 à 14).
• BOIS - Figure de ce qui provient de la terre et de ce qui est passager.
Le bois est une figure de ce qui provient de la terre et de ce qui est passager, autrement dit : de la nature et de l’état de l’homme comme créature. Le Seigneur Jésus comme Homme se compare lui-même au « bois vert (Luc 23 v. 31) », de sorte que nous pouvons aussi considérer les bois qui, en Exode 15 v. 25 et 2 Rois 6 v. 6, apportent la délivrance, comme des types de Lui-même. Le bois plaqué d’or fut employé pour différentes parties de la tente d’assignation, qui parlent du Fils de Dieu comme Homme (l’arche, l’autel de l’encens, la table des pains de proposition, l’autel de l’holocauste) ou des croyants (les ais du tabernacle). En 1 Corinthiens 3 v. 12 et 2 Timothée 2 v. 20, le bois est une image des pécheurs non rachetés. Dans les deux passages toutefois, les choses qui passent sont mises en contraste avec celles qui demeurent et qui témoignent de la gloire de Dieu, telles que l’or, l’argent et les pierres précieuses, figures de la nouvelle nature des croyants produite par Dieu.
Cependant le bois est aussi une figure de la malédiction que le Seigneur Jésus a prise sur lui à la croix de Golgotha (Deutéronome 21 v. 23 ; Actes 5 v. 30 ; Galates 3 v. 13 ; 1 Pierre 2 v. 24).
Le bois dont sont faites les images taillées (cf. Ésaïe 44 v. 13 à 20) parle de leur caractère vain et éphémère.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BOITEUX, PERCLUS - Pour nous montrer que Jésus seul est en mesure de rendre l’homme capable de marcher à sa gloire !
Un boiteux, de naissance, par suite d’accident ou de maladie, est incapable de se tenir sur ses pieds et de marcher, ou du moins est handicapé dans sa marche et dépend de l’aide de quelqu’un. Mephibosheth, le fils de Jonathan, était perclus des pieds ; alors qu’il était enfant, sa nourrice dans sa fuite l’avait laissé tomber et il était devenu boiteux (2 Samuel 4 v. 4). Même après qu’il eut été estimé digne par David de manger continuellement à la table du roi, son infirmité est encore mentionnée (2 Samuel 9 v. 13 ; 19 v. 26). Cela doit nous rappeler que nous n’avons de force en nous-mêmes ni comme pécheurs, ni comme bénéficiaires de la grâce. « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire », a dit le Seigneur Jésus à ses disciples (Jean 15 v. 5). S’il a guéri de nombreux infirmes, c’est pour nous montrer que lui seul est en mesure de rendre l’homme capable de marcher à sa gloire.
L’exhortation en Hébreux 12 v. 12 et 13 à redresser les mains lassées et les genoux défaillants et à faire des sentiers droits à nos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, concerne les chrétiens dont l’énergie de la foi s’affaiblit. Seul le Seigneur peut fortifier nos mains et nos genoux, mais de faire des sentiers droits à nos pieds incombe à notre propre responsabilité.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BOUC - Pour nous montrer que Jésus seul est en mesure de rendre l’homme capable de marcher à sa gloire !
Dans l’Ancien Testament, le bouc est destiné en premier lieu au sacrifice pour le péché (Lév. 4, 23). Pour le grand jour des propitiations, en Lévitique 16, 5 et suivants, Dieu a prescrit deux boucs pour le sacrifice pour le péché. L’un devait être égorgé et il devait être fait aspersion de son sang dans le lieu très saint de la tente d’assignation sur le propitiatoire et devant le propitiatoire (cf. Héb. 9, 11, 12, 24-26). L’autre était appelé azazel (le bouc qui s’en va); les péchés du peuple d’Israël étaient confessés sur lui, puis il était envoyé vivant au désert afin d’abolir, au sens figuré, les péchés pour toujours (Lév. 16, 20-22). Le premier bouc est une image de la propitiation, le second de la substitution.
L’hébreu employant le plus souvent un seul et même mot pour le péché et le sacrifice pour le péché (hébr.: chattath), le bouc est aussi une figure du pécheur. Il en est ainsi en Matthieu 25, 32 lors du jugement des vivants, quand après l’apparition de Christ en puissance
et en gloire toutes les nations sont assemblées devant son trône: les justes sont comparés à des brebis, mais les iniques à des chèvres (boucs).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BOUCLIER - Le bouclier de la foi est la confiance en Dieu parce qu’on le connaît.
Dans les temps anciens, le bouclier constituait une protection importante dans le combat corps à corps. Il y avait des grands boucliers qui protégeaient tout le corps, mais aussi des plus petits au moyen desquels on parait les coups et les projectiles. Déjà dans l’Ancien Testament, le mot se trouve fréquemment au sens figuré. Dieu lui-même s’y présente souvent comme un bouclier, c’est-à-dire comme un protecteur. Il dit à Abraham : « Abram, ne crains point ; moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense (Genèse 15 v. 1) ».
Si Dieu était autrefois un bouclier sûr à celui qui se confiait en lui, combien plus ne l’est-il pas aujourd’hui à nous qui pouvons dire avec Paul : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (Romains 8 v. 31) ». Un seul passage dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6 v. 16, mentionne, comme pièce de l’armure de Dieu, le bouclier de la foi par lequel nous pouvons « éteindre tous les dards enflammés du méchant ». La foi est ici le bouclier, c’est-à-dire la confiance pratique et quotidienne en notre Dieu et Père comme protection contre les attaques subtiles et puissantes du diable. Chaque doute et chaque mise en question de la bonté de Dieu sont ainsi réduits au silence. Le bouclier de la foi est la confiance en Dieu parce qu’on le connaît.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BRAS - Le « bras étendu » de Dieu est une image de Sa puissance .
Le « bras étendu » de Dieu (Exode 6 v. 6) est une image de la puissance avec laquelle il a racheté son peuple Israël de la servitude en Égypte. Par contre le bras de l’homme, dans l’Ancien Testament, est vu le plus souvent comme une figure de la force de la chair qui sert non pas au bien mais au mal (2 Chroniques 32 v. 8 ; Psaume 10 v. 15 ; Jérémie 17 v. 5). Le mot apparaît rarement dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur Jésus prend des petits enfants dans ses bras (Marc 9 v. 36 ; 10 v. 16), nous y trouvons aussi l’expression de l’amour et de l’intimité réalisés dans sa proximité.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• BREBIS, MOUTON - En tant que l’« agneau, comme immolé », notre Rédempteur se tiendra éternellement devant nos yeux et recevra notre adoration.
Encore aujourd’hui, les troupeaux de moutons caractérisent les paysages du Proche-Orient. Les moutons et les chèvres y sont les animaux domestiques les plus communs. La sobriété des moutons permet de les faire également paître dans des régions de steppes et de hauts plateaux. Il en était déjà ainsi dans les temps bibliques. L’élevage des moutons non seulement assurait le ravitaillement en viande, mais fournissait aussi la laine pour les vêtements, le lait et la graisse. Une brebis était parfois la seule possession des gens pauvres (2 Samuel 12 v. 3).
La nature tranquille, l’incapacité de se défendre et l’instinct grégaire de la brebis sont certes les raisons principales pour lesquelles, aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, elle est souvent choisie comme image du croyant, et les troupeaux de moutons comme figure du peuple de Dieu. Quand il n’y avait pas de véritables conducteurs, Israël était comme des brebis qui n’ont pas de berger (Nombres 27 v. 17 ; Matthieu 9 v. 36). David, qui lui-même avait été berger, appelle l’Éternel au psaume 23 son berger, il se compare en quelque sorte à une brebis qui ne manque de rien sous la protection de son berger; elle est conduite à de verts pâturages et à des eaux paisibles, elle fait l’expérience de son secours dans les circonstances les plus difficiles, elle est richement bénie. Le Seigneur Jésus employait l’image des brebis pour les Juifs qui croyaient en lui; comme le bon berger qui laisse sa vie pour les brebis, il les conduisait hors de l’enceinte du peuple d’Israël pour leur donner de la pâture en abondance. Mais il avait encore d’autres brebis, c’est-à-dire les croyants d’entre les nations, qui seraient réunies avec les brebis d’Israël dans l’Assemblée du Dieu vivant en un seul troupeau avec un seul berger (Jean 10 v. 1 à 16 ; cf. 1 Corinthiens 12 v. 13). Il est le grand pasteur des brebis (Hébreux 13 v. 20). Les croyants, qui se tiendront au début du Millénium devant son trône lors du jugement des vivants, sont appelés des brebis par contraste avec les chèvres qui iront dans la perdition éternelle (Matthieu 25 v. 31 à 46).
Selon la loi du Sinaï, les agneaux et les brebis étaient les animaux le plus fréquemment employés pour les sacrifices, qui sont des types du seul sacrifice expiatoire de Jésus Christ. Il était impossible que le sang de ces sacrifices ôte les péchés, mais les sacrifices servaient à rappeler l’horreur des péchés aux yeux de Dieu. Par son seul sacrifice accompli une fois pour toutes, le Seigneur Jésus a cependant « rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés », de sorte que maintenant, en vertu de son sang versé, nous avons « une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints (Hébreux 10 v. 1 à 25) ». C’est pourquoi Christ est comparé déjà prophétiquement à une brebis muette devant ceux qui la tondent et à un agneau qui est amené à la boucherie (Ésaïe 53 v. 7). En tant que l’« agneau, comme immolé », notre Rédempteur se tiendra éternellement devant nos yeux et recevra notre adoration (Apocalypse 5 v. 6 à 14).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• BLASPHÈME (1) - Contre le Saint - Esprit.
Parce qu’il y a toujours de nouveau des personnes qui pensent avoir commis ce péché et en conséquence, ne pas pouvoir être pardonnées, je voudrais m’arrêter quelques instants sur ce point important. Le diable cherche à ôter la paix même à de vrais enfants de Dieu, en leur suggérant qu’ils ont péché volontairement, et qu’en cela ils ont commis le péché contre le Saint Esprit qui ne peut être pardonné, même si l’on se courbe profondément devant ce qui a été commis. On argumente aussi que David lui-même a finalement prié en disant : « ne m’enlève pas l’Esprit de ta sainteté ! (Psaume 51 v. 11) ». Qui pourrait dès lors soutenir l’irréversibilité de la possession du Saint Esprit, et du salut du croyant qui l’accompagne ? Beaucoup de gens sont jetés dans une profonde détresse par de telles questions qui suscitent le doute ! C’est spécialement à elles que s’adressent les lignes suivantes.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BLASPHÈME (2) (contre le saint Esprit) - Satan chasse-t-il Satan ?
Que s’était-il passé aux jours du Seigneur ? Le Seigneur Jésus avait encore une fois prouvé Son autorité et Sa puissance divines en guérissant un possédé aveugle et muet. Ce possédé était en outre une figure parlante, bien que fort triste, de la nation juive : aveugle vis-à-vis de la personne de Jésus, leur roi, et muette quant à la louange qu’ils avaient à rendre à Dieu. Certes la masse du peuple était dans l’étonnement, et disait « celui-ci serait-Il le Fils de David ? ». Mais cette question elle-même laissait planer le doute sur ce qu’Il était réellement. Les pharisiens, toujours pleins d’envie et de jalousie vis-à-vis du Seigneur, franchirent alors un pas de plus, un pas décisif : ne pouvant nier le miracle, ils l’attribuèrent sans hésiter à Satan, et prétendirent : « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, le chef des démons (Matthieu 12 v. 24) ».
Ce n’était pas la première fois qu’on faisait cette méchante imputation, mais jusque-là, le Seigneur ne s’y était pas arrêté. Mais cette fois-ci le Seigneur prit position de manière infiniment sérieuse contre ce blasphème effrayant et méchant. Il fit d’abord ressortir le contresens complet de leur argument. Comment un système peut-il exister quand il combat contre lui-même ? Et si Satan chasse Satan, c’est qu’il est divisé contre lui-même. Était-ce pensable ? C’était une folie absolue de le croire ! En outre parmi leurs propres fils, il y avait des soi-disant exorcistes, comme le montre d’ailleurs l’exemple d’Actes 19 (v. 13 et suiv.). Par quelle puissance exerçaient-ils alors leur œuvre malencontreuse, si Lui, le Christ, chassait les démons par Béelzébul ? « Je connais Jésus et je sais qui est Paul » leur dit l’esprit malin, « mais vous, qui êtes-vous ? (Actes 19 v. 15) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BLASPHÈME (3) (contre le saint Esprit) - En quoi consiste ce blasphème ?
Le Seigneur Jésus prononce alors une phrase décisive pour notre sujet : « Mais si moi je chasse les démons par l’Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu’à vous (Matthieu 12 v. 28) ». Remarquons ceci : Jésus ne chassait pas les démons simplement par Sa propre puissance, la puissance de l’Éternel, car Il était effectivement l’Éternel (Yahweh). Mais comme homme, Il était assujetti en tout à Son Père, et le Père faisait les œuvres (Jean 14 v. 10 et 11). Ici, nous apprenons qu’Il accomplissait aussi Ses miracles dans la puissance de l’Esprit de Dieu. Ils étaient l’expression visible de ce que le Saint Esprit habitait et agissait en Lui : Il chassait les démons par le doigt de Dieu (Luc 11 v. 20).
Il est bien vrai que l’Esprit de Dieu habite et agit aussi en nous les rachetés, mais combien nous pouvons facilement L’attrister, ou Le « contrister » (Éphésiens 4 v. 30), voire même « L’éteindre » dans Son activité (1 Thessaloniciens 5 v. 19) ! C’est pourquoi une accusation de la sorte à l’encontre du Saint Esprit ne peut pas nous toucher de la même manière, car Il ne peut se manifester en nous qu’imparfaitement. Bien des choses à cause desquelles on nous outrage correspondent même à la vérité. Mais dans le Seigneur Jésus, notre Rédempteur, tout était parfait, et le Saint Esprit pouvait agir en Lui sans entrave. Et si Christ chassait les démons, alors Il le faisait sans restriction par l’Esprit de Dieu. Dès lors, prétendre qu’Il le faisait par le chef des démons, c’était directement le « blasphème contre l’Esprit », c’était « parler contre le Saint Esprit ». Le Seigneur dit que ce péché ne serait pardonné ni dans « ce siècle » (c’est-à-dire le temps où le Seigneur Jésus séjournait sur la terre), « ni dans celui qui est à venir » (c’est-à-dire le règne de mille ans) (Matthieu 12 v. 31 et 32).
Or il est fondamentalement vrai que des gens animés dans leur cœur d’une telle méchanceté contre le Seigneur Jésus sont exclus de tout pardon, tant qu’ils restent dans cet état sans se repentir. Mais ceci est plus une application de cette position, que directement le blasphème lui-même contre le Saint Esprit. Reconnaître une puissance de Dieu agissant dans le Seigneur Jésus et l’attribuer malgré tout à Satan, voilà ce péché effrayant et impardonnable. Il ne pouvait effectivement être commis que quand le Seigneur Jésus séjournait sur cette terre. Les pharisiens s’en étaient rendus coupables.
Ceci est confirmé par une indication qui ressort du passage parallèle de l’évangile de Marc : « En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu’elles soient, par lesquelles ils blasphèment ; mais quiconque proférera des paroles injurieuses (ou blasphèmes) contre l’Esprit Saint n’aura jamais de pardon ; mais il est passible du jugement éternel ». Il y a ensuite une justification qui clarifie parfaitement la circonstance : « C’était parce qu’ils disaient : Il a un esprit immonde (Marc 3 v. 28 à 30) ». C’est cela qui constitue donc ce terrible péché : être en présence du Seigneur et d’un tel miracle de Sa grâce devant les yeux, et prétendre qu’Il avait un esprit impur et qu’Il avait accompli Son miracle dans la puissance de cet esprit impur. Ils qualifiaient de démon le Saint Esprit par lequel Il avait accompli ce miracle. Il n’y avait pas de pardon pour cela.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BLASPHÈME (4) (contre le saint Esprit) - Un péché dispensationnel.
Il s’agissait d’un péché dispensationnel, et redisons-le expressément : il ne peut pas être commis aujourd’hui, et en tout cas pas de la même manière. Ceux qui l’avaient commis fournissaient la preuve qu’ils avaient péché au point que leurs consciences étaient endurcies. Ils étaient arrivés au point où il ne peut plus y avoir de délivrance. Si je parle ainsi de « péché dispensationnel », c’est pour montrer que le Seigneur Jésus a manifestement attribué le blasphème contre le Saint Esprit à des dispensations particulières. L’expression « ni dans ce siècle ni dans celui qui est à venir » ne signifie pas du tout qu’il y ait encore pour certaines personnes, un pardon dans un autre monde, comme on le prétend et l’enseigne dans plusieurs milieux chrétiens.
Nous avons déjà brièvement indiqué que le Seigneur parlait de deux ères (ou siècles) bien précises, celle qui était alors en train de se terminer, et l’autre à venir, le règne de mille ans. Nous chrétiens, notre position est en dehors de ces ères (ou siècles). L’ère chrétienne actuelle n’était alors pas encore révélée, en conséquence de quoi ce n’est pas d’elle que le Seigneur parlait. Pourtant ces paroles du Seigneur peuvent s’appliquer également à ceux qui, dans le temps présent, refusent intentionnellement le témoignage du Saint Esprit au sujet de Christ. De tels gens ne peuvent connaître le pardon ni dans l’ère juive, ni dans l’ère actuelle, ni dans n’importe quelle autre ère. Combien cela est extrêmement sérieux !
C’est justement des enfants de Dieu angoissés et faibles qu’on entend parfois parler de leur inquiétude profonde, de ce qu’ils auraient commis le péché contre le Saint Esprit et seraient ainsi perdus quoi qu’il arrive. Mais leur manière vague de s’exprimer montre déjà à elle seule combien, d’un point de vue général, leur souci est sans fondement. Ils parlent presque toujours, certainement inconsciemment, de péché contre le Saint Esprit, alors que le Seigneur utilise une autre expression : « le blasphème contre le Saint Esprit » ; « celui qui aura proféré des paroles injurieuses (ou blasphémé) contre le Saint Esprit ». Tout péché est finalement contre Dieu, et par là également contre le Saint Esprit (Psaume 51 v. 4). Mais pécher contre Dieu est une chose, et blasphémer le Saint Esprit en est une autre. Les mettre sur le même niveau conduit à des conclusions fatales et fausses.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BLASPHÈME (5) (contre le saint Esprit) - La prière de David.
Quand David pria après son grave péché en disant : « ne m’ôte pas l’esprit de ta sainteté », une telle prière était tout à fait appropriée en ce temps-là. À cette époque l’œuvre de la rédemption n’était pas encore accomplie. Néanmoins, il a plu à l’Esprit de Dieu de venir sur, ou de saisir quelqu’un à de certaines occasions, même des incrédules, pour se révéler sous une forme ou sous une autre. Pensons simplement à l’exemple de Saül, qui fut saisi par l’Esprit de Dieu en sorte qu’il se mit à prophétiser et que ceci passa en proverbe : « Qu’est-il donc arrivé au fils de Kis ? Saül aussi est-il parmi les prophètes ? (1 Samuel 10 v. 10 et 11) ».
Cependant, aujourd’hui, l’Esprit de Dieu habite dans le croyant sur la base de la rédemption accomplie, et son corps est le temple du Saint Esprit (1 Corinthiens 6 v. 19). Le Seigneur Jésus avait également dit à ses disciples à Son sujet, que cet autre Consolateur ne les laisserait pas, comme Lui-même, mais qu’Il serait avec eux éternellement. Il demeurerait avec eux et serait en eux (Jean 14 v. 16 et 17). C’est pour cela que la requête de David serait tout à fait inappropriée pour nous, et nulle part dans le Nouveau Testament on ne trouve mention de ce genre de prière. Dieu se plait certainement à nous entendre Lui demander que le Saint Esprit nous remplisse davantage ou que nous ne L’attristions pas. Mais prier qu’Il ne nous soit pas ôté, cela reviendrait à rabaisser l’œuvre de notre Seigneur ; car le Saint Esprit est bien le sceau de la rédemption et les arrhes de notre héritage futur (2 Corinthiens 1 v. 21 et 22 ; Éphésiens 1 v. 13 et 14).
L’exemple de notre Seigneur nous fait également comprendre clairement que nous posséderons l’Esprit Saint aussi dans la résurrection. Quoiqu’il eût traversé la mort, c’est « par l’Esprit Saint » que le Seigneur « a donné », en tant que ressuscité, des ordres aux apôtres » (Actes 1 v. 2) : Il ne L’avait pas perdu. Et nous non plus, nous ne Le perdrons jamais.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BREBIS (et les chèvres) - Le premier service n’est-il pas de penser à ceux qui sont dans le besoin ?
Matthieu 25 v. 35 et 36). Cette parabole nous montre le Seigneur juge des nations à l’entrée du royaume. Elle contient pour nous un simple enseignement pratique : le premier service, à la portée de tous, frère ou sœur, n’est-il pas de penser à ceux qui sont dans le besoin : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais nu et vous m’avez vêtu » . C’est la leçon de Jacques 2 v. 16. Puis il y a les malades à visiter ou à soigner, les prisonniers auprès desquels le Seigneur engage à aller. Il y a les étrangers, ces jeunes qui sont peut-être dans notre ville aux études ou en apprentissage, que l’on doit inviter, entourer, encourager. « En tant que vous l’avez fait à l’un des plus petits de ceux-ci, qui sont mes frères, vous me l’avez fait à moi ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• BREBIS (égarée) - Le bon Berger veut bien plutôt souligner toute l’importance qu’a pour Lui chacune de Ses brebis individuellement.
« Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf sur les montagnes, pour s’en aller chercher celle qui s’est égarée ? Et s’il arrive qu’il la trouve, en vérité, je vous dis qu’il a plus de joie de celle-là que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Ainsi, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu’un seul de ces petits périsse (Matthieu 18 v. 12 à 14) ».
Il est montré ici une nouvelle raison de ne pas mépriser ces petits ou ces insignifiants : Le berger et le Père en prennent soin. La première raison était que leurs anges voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux. C’est-à-dire qu’au cas où ils mourraient ici-bas, ils continueraient à vivre en présence du Père céleste dans des conditions incomparablement meilleures. Mais maintenant nous apprenons un autre côté précieux : Chacun individuellement est précieux pour le bon Berger ; et aussi ce n’est pas la volonté du Père céleste qu’un seul de ces petits périsse. Quelle sécurité leur est ainsi donnée !
Il en va autrement dans la parabole. Son application s’étend à toute brebis égarée, qu’elle soit jeune ou âgée. Cependant, si dans la parabole de la brebis perdue en Luc 15, il est question de pécheurs, la parabole de la brebis égarée fait plutôt penser à des croyants. C’est le contexte qui le montre clairement comme nous l’avons déjà vu : Les disciples du Seigneur devaient avoir des sentiments corrects vis-à-vis de ceux qui appartenaient au royaume des cieux.
Si donc une brebis s’égare dans les montagnes, le désir qu’Il a de son rétablissement est tel qu’Il laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour s’en aller vers l’égarée, jusqu’à ce qu’Il la trouve. Et quand Il la trouve, Il a plus de joie du rétablissement de celle-là que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Cela ne veut certainement pas dire que, par principe, Il a plus de joie des brebis égarées que de celles qui sont restées sur le chemin. Cela mettrait tout sens dessus dessous. Le « bon Berger » veut bien plutôt souligner toute l’importance qu’a pour Lui chacune de Ses brebis individuellement. Si une brebis s’égare, Ses soins, Sa peine pour celle-là sont si grands qu’Il fera tout pour son rétablissement et qu’Il laisse les autres brebis de côté pour un moment. Son amour pour cette seule brebis ne sera cependant jamais aux dépens de tout le troupeau ; car c’est Son désir que le troupeau ne perde aucune des siennes.
Si nous comparons les images du berger et de ses brebis en Matthieu 18 et Jean 10 nous sommes frappés par des différences remarquables. Dans l’une le bon Berger va après la brebis égarée, dans l’autre Il marche devant les brebis. Si une de Ses brebis ne veut pas Le suivre dans la vie pratique journalière, Il se voit contraint d’aller après elle, de la suivre. L’un ou l’autre de ces deux cas sera toujours le nôtre. Mais combien il est beaucoup plus béni que ce soit nous qui Le suivions, plutôt que Lui nous suive ! Si nous Le suivons, nous sommes en sécurité ; si c’est Lui qui nous suit, c’est que nous sommes en danger. Ainsi ces deux images se complètent. En Matthieu le Berger cherche Sa brebis ; en Jean 10, Il meurt pour les brebis. Mais les deux fois c’est Son amour pour elles qui en est la source.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BREBIS (perdue) (1) - Quand une brebis du troupeau s’égare, le berger ne met-il pas toute son énergie à la retrouver, ne concentre-t-il pas là-dessus toutes ses pensées ?
Les pharisiens et les scribes avaient raison quand ils disaient de Jésus : Il reçoit les pécheurs et mange avec eux. Bien sûr eux-mêmes n’auraient fait ni l’un ni l’autre. Mais Lui faisait les deux. Sans le vouloir et sans en avoir l’intention, ils devenaient des propagateurs de Sa grâce illimitée. Le Seigneur Jésus répond à leur objection par trois tableaux tirés de la vie journalière. Le premier provient de la vie d’un berger, le deuxième de la vie à la maison, et le troisième de la vie familiale.
« Et il leur dit cette parabole, disant : Quel est l’homme d’entre vous, qui, ayant cent brebis et en ayant perdu une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne s’en aille après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ? et l’ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux ; et, étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis, qu’ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance (Luc 15 v. 3 à 7) ».
Cette parabole est empreinte d’une grande simplicité. Le Seigneur dit à ces pharisiens et scribes orgueilleux et propre justes, qui continuaient à mépriser la bonté de Dieu, qu’en définitive ils feraient la même chose que Lui faisait. À partir du plus petit, Il conclut sur le plus grand, à partir de la brebis, Il conclut au sujet de l’homme. Si même l’un d’entre eux ferait ce qui est esquissé ici pour une brebis perdue, le Seigneur ne devait-Il pas agir de manière analogue pour un homme perdu ? Cette question à laquelle, intérieurement, ils ne pouvaient répondre que positivement, ce tableau tout simple, suffisait au Seigneur pour les désarmer et pour trancher la question en Sa faveur. Les questions sont dans Sa main des outils puissants ; Il s’en sert pour viser et atteindre directement les cœurs et les consciences de Ses auditeurs. Elles manifestent une sagesse infiniment plus qu’humaine. Le Seigneur n’a besoin pour ainsi dire que de lever le doigt, et voilà ses contradicteurs qui tombent, et qui tombent sous leur propre jugement. Quelle personne grandiose est Celui à qui nous avons affaire !
Pour comprendre correctement cette parabole et les deux qui suivent, il faut garder à l’esprit que le Seigneur répond par leur moyen au reproche des conducteurs religieux du peuple juif. Il les compare ici avec les 99 brebis au désert, tandis qu’Il présente les publicains et les pécheurs sous l’image de la brebis perdue. Ils étaient tous des « brebis », les uns comme les autres. Même si les pharisiens et les scribes regardaient de haut les publicains et les pécheurs, et les méprisaient, ils étaient tous des brebis du même troupeau. Car le peuple d’Israël est souvent considéré dans l’Ancien Testament comme un « troupeau » (voir Psaume 77 v. 20 ; 78 v. 52 ; 95 v. 7 ; Ésaïe 40 v. 11 ; 63 v. 11 ; Jérémie 13 v. 17, 20).
Ni dans cette parabole ni dans les deux suivantes du même chapitre, il n’est fait référence aux différences, comme celles qui distinguaient les Juifs d’avec les nations selon les pensées de Dieu. Au sens national, les publicains et les pécheurs étaient sur le même terrain de privilèges extérieurs que les pharisiens et les scribes. Si le Seigneur avait reçu des « païens » et avait mangé avec eux, il est vrai que les pharisiens et les scribes auraient eu en un certain sens un motif valable d’accusation contre Lui. Mais il n’en était pas ainsi.
Comme nous allons le voir, le Seigneur, en Jean 10, parle aussi de brebis, mais non pas dans un sens national, seulement dans un sens moral. Sous ce point de vue, les pharisiens n’étaient pas de Ses brebis (Jean 10 v. 26). Seuls ceux d’Israël qui croyaient en Lui et Le suivaient, étaient en vérité Ses brebis. Il leur donnait la vie éternelle. Il est important de se rendre compte de ces différences. Or si une brebis du troupeau d’Israël s’égarait, si des gens attirés par le Seigneur étaient effectivement des pécheurs, quelle raison pouvait-on donner pour ne pas s’en occuper ? Car quand une brebis du troupeau s’égare, le berger ne met-il pas toute son énergie à la retrouver, ne concentre-t-il pas là-dessus toutes ses pensées ? C’est ce que le Seigneur présente dans cette parabole.
Naturellement l’image de la brebis perdue est applicable à n’importe quel pécheur. Nous le savons bien : si une brebis s’égare, c’est selon sa nature de ne pas être capable de retrouver le chemin. Il faut aller à sa recherche si on ne veut pas qu’elle périsse. Par nature il en est ainsi de tout homme, si on veut bien en convenir tant soit peu. Mais le Seigneur Jésus, le bon Berger, est prêt à chercher et sauver ce qui est perdu.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BREBIS (perdue) (2) - En Jean 10, le bon Berger meurt pour les brebis, en Luc 15 Il cherche la brebis.
Certaines particularités méritent qu’on y regarde de plus près. Dans cette parabole, il y a un pour cent de perdu, et la valeur en est vue proportionnellement. Dans la parabole suivante, il y a un sur dix de perdu, et la valeur croit proportionnellement. Et finalement le perdu représente un sur deux, et la valeur atteint son maximum. Mais même s’il n’y a qu’un pour cent des brebis qui s’égare, le berger part à sa recherche. Pour Lui, ça vaut toujours la peine.
Parce que le Seigneur répond à Ses contradicteurs religieux, et qu’Il compare Sa manière d’agir, avec ce qu’eux feraient, en définitive, en pareil cas, Il ne dit pas dans Sa sagesse : « Si J’avais cent brebis… ». Il évite même d’utiliser le mot de « berger ». C’est nous qui utilisons ce terme quand nous parlons de cette parabole, et nous avons raison de le faire ; mais Lui ne se nomme pas ainsi ici, bien qu’Il soit naturellement le bon Berger et qu’Il parle de Lui-même. Le bon Berger va devant les brebis, et les brebis le suivent (Jean 10 v. 4). Mais quand la brebis ne veut pas Le suivre, il faut qu’Il aille après elle. Quelle immense différence entre les brebis de Jean 10 et celles de Luc 15 ! En Jean 10 elles sont en sécurité, et en Luc 15 il y a un grand danger. En Jean 10, le bon Berger meurt pour les brebis, en Luc 15 Il cherche la brebis. Les deux tableaux se complètent de manière admirable.
Bien sûr, les brebis appartiennent au berger, comme les drachmes à la femme. Mais le Seigneur ne fait pas ressortir ce point dans ces paraboles. Il montre avant tout le caractère de la grâce et de l’amour insurpassables de Dieu. Quand une de Ses brebis se perd par sa propre folie, le Berger va après la brebis pour la chercher. Quel qu’en soit le coût pour Lui, honte, mépris, moquerie, opprobre, travail, peine, renoncement à soi-même et abnégation, Il a à cœur les objets de Son amour, et Il fait tout pour les chercher et les sauver. Que cela inclue aussi la mort du Bon Berger, nous l’avons déjà dit. Cependant, ce n’était pas les brebis des pharisiens, mais c’était Ses propres brebis. Nous devons d’abord penser, comme déjà vu, que cette expression se réfère aux brebis perdues de la maison d’Israël. Mais Il a aussi « d’autres brebis », celles des nations (Matthieu 10 v. 6 ; Jean 10 v. 16).
Oui, l’amour de Dieu cherche. C’est son caractère dans cette parabole et dans la suivante. Il reçoit aussi : c’est la troisième parabole qui le présente.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• BREBIS (perdue) (3) - L’attention est attirée seulement et uniquement sur la joie du Berger.
Tout parle ici de l’activité et de l’œuvre du Berger, notre Seigneur. C’est Lui qui laisse les 99 brebis au désert ; c’est Lui qui va après la perdue jusqu’à ce que Lui la trouve. Et quand Lui l’a trouvée, c’est Lui qui la met sur Ses épaules, tout joyeux, et la ramène à la maison. La brebis ne fait pas un seul pas en direction du Berger ; tout ce qui est fait n’est fait que par Lui. Au sujet de la brebis, il nous est seulement dit qu’elle s’était égarée et s’était perdue. Il ne nous est pas dit un seul mot sur ce qu’elle a éprouvé quand elle a été trouvée. Ce n’est pas le sujet que le Seigneur veut nous présenter. L’attention est attirée seulement et uniquement sur la joie du Berger. C’est aussi une joie qui se communique et qui ne cesse jamais, du moins dans le cadre de la parabole. Car quand Il rentre à la maison, Il appelle Ses voisins et Ses amis et les invite à se réjouir avec Lui « car j’ai trouvé ma brebis perdue (Luc 15 v. 6) ».
N’est-ce pas une pensée impressionnante que le Seigneur Jésus se réjouisse du salut des perdus ? À chaque « brebis » qu’Il a pu arracher à la perdition, Il éprouve de la joie. Elle fait partie de la joie dont parle l’épître aux Hébreux (12 v. 2) : « À cause de la joie qui était devant Lui, Il a enduré la croix, ayant méprisé la honte ». Les pharisiens murmuraient tandis que le Seigneur Jésus se réjouissait. « Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait (Ésaïe 53 v. 11) » ; « Il se reposera dans son amour, il s’égayera en toi avec chant de triomphe (Sophonie 3 v. 17) ».
Comme on l’a déjà indiqué, le Seigneur fait participer d’autres à Sa joie, et Il la leur communique. Ce que représentent les « amis » et les « voisins » se voit clairement par les paroles finales de cette parabole et de la suivante : ce sont les saints anges qui demeurent dans la présence de Dieu. Ils respirent l’atmosphère de la présence de Dieu et entrent dans Sa joie. C’est ainsi que s’exprime ici le Seigneur : « Je vous dis, qu’ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance (Luc 15 v. 7) ». Méditons cela : Si un pécheur se repent sur la terre, se juge devant Dieu, alors les anges dans le ciel s’en réjouissent ! Y avons-nous pensé ? Pourtant c’est là la manière de voir du ciel, l’état d’esprit du ciel. Le ciel prend part au fait que, sur la terre, un seul homme donne à Dieu la place qui Lui revient, et prend lui-même la place qu’il mérite. Voilà le sujet de joie du ciel. Il n’y a pas de murmures là. Nous apprenons plus loin dans le Nouveau Testament (Éphésiens 3 v. 10) que l’assemblée de Dieu sur la terre est le « livre d’instruction » des anges, où ils peuvent apprendre la sagesse si diverse de Dieu. Les paroles du Seigneur ici nous préparent à l’avance pour cette grande vérité.
Pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que, sous l’image des « amis » et des « voisins », nous les rachetés du Seigneur sommes aussi inclus. Il arrive souvent que dans Son explication, le Seigneur dépasse le cadre strict des termes de la parabole. Nous l’avons déjà vu à plusieurs reprises. Or Christ n’est-Il pas notre vie ? N’appartenons-nous pas déjà au ciel, même si nous sommes encore sur la terre ? La manière de voir du ciel n’est-elle pas la nôtre ? Ne nous réjouissons-nous pas quand un pécheur se repent ? Oui, nous sommes rendus dignes d’avoir communion déjà maintenant avec Sa joie. Et cette communion nous conduira nécessairement à l’adoration de Celui dont l’amour qui cherche nous est déjà connu par expérience.
Mais il y a alors un rajout particulier : « … plus que 99 justes qui n’ont pas besoin de repentance (Luc 15 v. 7) ». Eux, les pharisiens et les scribes, qui se tenaient pour justes, et estimaient donc ne pas avoir besoin de repentance, ils n’avaient pas encore donné au ciel de sujet de se réjouir ! Si mon lecteur pensait encore qu’il peut se tenir devant Dieu avec sa propre justice, qu’il réfléchisse un moment à ceci : pas un seul ange, parmi les myriades d’anges saints qui demeurent dans le ciel, ne s’est jamais réjoui au sujet d’un pareil « juste ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• BÉLIER (holocauste) - Le terrain de notre acceptation devant Dieu.
« Puis tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier ; et tu égorgeras le bélier, et tu prendras son sang, et tu en feras aspersion sur l'autel, tout autour. Et tu couperas le bélier en morceaux ; et tu laveras son intérieur et ses jambes, et tu les mettras sur ses morceaux et sur sa tête; et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel: c'est un holocauste à l'Éternel, une odeur agréable ; c'est un sacrifice par feu à l'Éternel (Exode 29 v. 15 à 18) ».
Vient « le bélier de l'holocauste » qui exprime la maturité et l'énergie de Christ et toutes Ses perfections intérieures, la bonne odeur qui s'est exhalée quand Il s'est donné Lui-même pour nous. Non seulement, ce qui était offensant a été ôté, mais tout ce en quoi Dieu pouvait trouver plaisir a été introduit. Sa volonté a été établie sur un fondement impérissable (voyez Psaume 40 ; Hébreux 10). Dans son amour, Christ a été obéissant là où étaient le péché et la mort, afin de nous procurer un terrain sur lequel nous soyons acceptés.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• BÉLIER (consécration) - Christ a aimé l'assemblée et S'est livré Lui-même pour elle.
Le « bélier de consécration », qui typifie Christ dans le dévouement de Son amour comme étant ce qui doit caractériser la compagnie consacrée; car de son sang est mis sur le lobe de l'oreille, sur le pouce et sur l'orteil de chacun d'eux (Exode 29 v. 20), et ils doivent également manger la chair du bélier (Exode 29 v. 31 à 33). Christ était caractérisé par un dévouement entier. Quel plaisir c'était pour Dieu d'avoir cette oreille attentive et de se faire entendre à elle, sachant que quand Il parlait, Christ était disposé à faire à tout prix Sa volonté (Esaïe 50 v. 4 et 5).
Chaque acte dans Son service et chaque pas dans Son chemin exprimaient ce même caractère de dévouement qui Le conduisit à la mort. A tous égards, nous le voyons dévoué, sans restriction.
Nous devons maintenant nous trouver sous cette influence afin que la marque du dévouement de Christ soit sur l'oreille, la main et le pied de chacun. Nous devrions être disposés à tout moment à nous demander : « Christ prêterait-il l'oreille à cela ou le ferait-il ? » « Est-ce ainsi qu'il agirait ? » Quel caractère cela donnerait à la sacrificature ! Je comprends que ce qui est montré dans « le bélier de consécration » se rapproche de : « ceci est mon corps qui est pour vous (1 Corinthiens 11 v. 24) », autant qu'aucun autre des types de l'Exode ou du Lévitique.
Christ a aimé l'assemblée et S'est livré Lui-même pour elle. Il est allé à la mort afin que toutes les précieuses pensées de l'amour de Dieu et de Son propre amour aient leur effet, qu'il ait les saints entièrement pour Lui-même et pour le service de Dieu. Il voudrait les voir caractérisés par cet amour et s'en nourrir pour qu'ils soient capables d'accomplir, dans des affections intelligentes, le service sacerdotal.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
C
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• CADAVRE, CORPS MORT - Cela nous incite à une marche soigneuse.
Selon la loi du Sinaï, le cadavre d’une personne ou le corps mort d’une bête étaient impurs; cette souillure était également transmise par le contact (Lévitique 11 v. 31 ; Nombres 19 v. 11 ; Aggée 2 v. 13). Aussi le nazaréen ne devait s’approcher d’aucune personne morte, et le sacrificateur n’osait toucher que le corps mort de ses proches parents (Lévitique 21 v. 1 à 3 ; Nombres 6 v. 6). Celui qui s’était souillé par le contact avec un cadavre devait se purifier avec l’eau de séparation (Nombres 19). La purification durait sept jours, ce qui signifie pour nous que l’activité pour le Seigneur est paralysée ou entravée par la souillure spirituelle, même si la purification, c’est-à-dire une sincère confession, a eu lieu. Cela devrait nous inciter à une marche soigneuse.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CANAAN, CANANEEN - Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et Dieu nous y fait déjà asseoir en Lui.
Canaan (« terrain bas ») est la plus ancienne appellation de la terre située entre le Jourdain et la Méditerranée (Genèse 11 v. 31 ; 12 v. 5) ; au sens étroit, Canaan englobe les plaines nord et sud de la côte méditerranéenne et la vallée du Jourdain (Genèse 10 v. 19 ; Nombres 13 v. 29). Le nom remonte à l’un des fils de Cham (Genèse 9 v. 18), dont la descendance a donné son nom au pays. Sidon, Heth, le Jébusien, l’Amoréen, le Guirgasien, le Hévien, l’Arkien, le Sinien, l’Arvadien, le Tsemarien et le Hamathien sont nommés, en Genèse 10 v. 15 à 18, comme fils de Canaan. En Deutéronome 7 v. 1, les sept nations ci-après sont mentionnées comme habitants de Canaan que Dieu chasserait de devant le peuple d’Israël: le Héthien, le Guirgasien, l’Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. La religion des Cananéens était un culte de la fertilité et de la volupté, auquel étaient liés la prostitution religieuse (fornication) et les sacrifices humains (Psaume 106 v. 38 ; Ésaïe 57 v. 5). Les principaux dieux étaient Baal et Ashtoreth (Astarté).
Le pays « ruisselant de lait et de miel » joue un rôle important dans la Bible comme pays promis par Dieu pour son peuple terrestre, Israël. À la différence de beaucoup d’autres pays voisins, il est présenté, en Deutéronome 8 v. 7 à 10 et 11 v. 8 à 12, comme un pays extrêmement fertile, avec des sources d’eau en abondance mais également la pluie en sa saison, un pays qui possède des ressources minières comme aussi des bonnes terres pour la culture du blé, des fruits et de la vigne, un pays sur lequel Dieu porte continuellement un regard bienveillant. Si les Israélites s’en étaient tenus aux commandements de leur Dieu, ils auraient vécu des jours « comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre (Deutéronome 11 v. 21) ».
Canaan est ainsi la figure des richesses spirituelles dans les lieux célestes qui ont été données par Dieu à celui qui croit au Seigneur Jésus (cf. Éphésiens 1 v. 3). Ces bénédictions ne sont toutefois pas destinées à l’homme naturel, mais sont réservées à ceux qui, par la foi à l’évangile de la grâce et du salut en Christ, sont identifiés avec lui dans sa mort et dans sa résurrection (Éphésiens 2 v. 4 à 6). Pour prendre possession des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, le vieil homme doit être dépouillé et le nouvel homme revêtu (cf. Éphésiens 4 v. 22 à 24).
Cela est montré en figure dans le peuple d’Israël, délivré d’Égypte, qui est parvenu dans le pays de Canaan en traversant la mer Rouge et le Jourdain. Le désert, entre les deux, ne faisait pas partie du plan de Dieu pour son peuple, mais il a servi à le châtier et à l’éprouver. Lorsque les Israélites sont entrés en Canaan, tout lieu que foulait la plante de leur pied devait leur appartenir; il fallait toutefois qu’ils combattent pour prendre possession de tout le pays. À cause de leur terrible idolâtrie, les Cananéens étaient non seulement destinés depuis longtemps déjà au châtiment de Dieu (Genèse 15 v. 16), mais ils représentaient aussi un danger menaçant pour le peuple de Dieu mis à part pour lui. C’est pourquoi Dieu a ordonné à son peuple de n’adopter en aucun cas les coutumes et les lois des Cananéens (Lévitique 18 v. 3), mais de déposséder tous les habitants et de détruire leurs lieux de culte des idoles (Nombres 33 v. 51 et 52). Cependant Israël n’a pas observé ces ordonnances (Juges 1 v. 29 et suiv.), mais il a adopté un grand nombre des abominations des Cananéens, de sorte que Dieu a fait qu’Israël d’abord, puis plus tard Juda soient emmenés hors du pays.
L’apparente contradiction entre la bénédiction promise, d’une part, et les Cananéens ennemis et idolâtres, d’autre part, s’explique si nous considérons que Canaan n’est pas une figure des bénédictions futures de la maison du Père, mais qu’il trouve son équivalent spirituel dans la période actuelle. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et Dieu nous y fait déjà asseoir en lui (Éphésiens 1 v. 3 ; 2 à 6). Toutefois il y a dans les lieux célestes « la puissance spirituelle de méchanceté » contre laquelle il faut combattre (Éphésiens 6 v. 10 à 18). De même qu’autrefois les Cananéens ont disputé la possession du pays promis à Israël et l’ont incité au péché, de même Satan essaie aujourd’hui, par tous les moyens possibles, de ravir aux enfants de Dieu la joie et la jouissance des richesses spirituelles de Dieu. Mais nous avons à disposition « l’armure complète de Dieu » au moyen de laquelle nous pouvons résister aux artifices du diable.
L’histoire des patriarches Abraham, Isaac et Jacob nous présente un autre aspect. Comme Hébreux 11 v. 9 le dit, ils demeurèrent dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, sous des tentes. Ils n’avaient aucune communion avec les habitants du pays (Genèse 12 v. 6 et 7 ; 13 v. 7), et ni Isaac ni Jacob ne devaient épouser une femme d’entre les filles des Cananéens (Genèse 24 v. 3 ; 28 v. 1). Ils représentent en type le côté terrestre de l’appel céleste des chrétiens.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CASQUE - Ne pas négliger cette pièce de l’armure de Dieu.
Le casque et le bouclier étaient autrefois des protections importantes pour les soldats au combat, protections qui sont mentionnées assez souvent conjointement dans la Bible (Ézéchiel 23 v. 24 ; 27 v. 10 ; 38 v. 5). Ce n’était donc pas des armes au sens propre du mot. Le casque devait protéger des blessures la tête, partie la plus importante du corps. Dans le Nouveau Testament, le casque est mentionné deux fois au sens figuré : en Éphésiens 6 v. 17, comme « le casque du salut » et en 1 Thessaloniciens 5 v. 8, comme le casque de « l’espérance du salut ». Ces deux passages nous montrent que les attaques de l’ennemi visent en particulier la certitude du salut et l’espérance vivante des croyants. Grâces à Dieu, il ne peut ravir personne de la main du Fils de Dieu et de celle du Père (Jean 10 v. 28 et 29). Celui qui croit en l’œuvre rédemptrice parfaite du Seigneur Jésus est sauvé pour toujours. Il peut désormais vivre « en pleine assurance de foi » et dans « la pleine assurance de l’espérance jusqu’au bout (Hébreux 10 v. 22 ; 6 v. 11) ». Mais cette certitude de la foi et du salut est précisément l’objectif des attaques de Satan. C’est pourquoi il est si important, pour tous ceux qui sont découragés et dans le doute, de ne pas négliger cette pièce de l’armure de Dieu, mais « d’avoir toujours sur la tête » le casque du salut et l’espérance vivante qui lui est liée du retour de notre Seigneur pour l’enlèvement de tous les croyants, et de se protéger ainsi des attaques du diable.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CÈDRE, (bois) - Dieu ne peut utiliser ni la grandeur de l’homme ni sa faiblesse.
Le cèdre est un conifère qui peut atteindre la hauteur prodigieuse de 40 m. Il se trouvait autrefois en grande quantité sur les montagnes du Liban. En raison de sa grandeur majestueuse, il est considéré dans la Bible comme l’arbre le plus noble (1 Rois 4 v. 33) et est une figure de la puissance, mais aussi de l’orgueil (Psaume 92 v. 12 ; Ésaïe 2 v. 13), en un mot de la grandeur de l’homme. Pour montrer qu’il s’agit là d’une attitude mauvaise aux yeux de Dieu, l’utilisation du bois de cèdre et de l’hysope était ordonnée pour la purification du lépreux et pour l’eau de séparation (Lévitique 14 v. 4 ; Nombres 19 v. 6). Dieu ne peut utiliser ni la grandeur de l’homme ni sa faiblesse, il peut se servir uniquement des cœurs purifiés par le sang de Christ et par la parole de Dieu.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CEINTURE, CEINDRE - Les « reins ceints » sont la figure de la fermeté.
Dans l’Antiquité, la ceinture était une partie importante de l’habillement, puisqu’elle maintenait ensemble les vêtements flottants qui, le plus souvent, ne consistaient qu’en une grande pièce d’étoffe. En rapport avec les vêtements du sacrificateur, la ceinture est particulièrement mise en évidence (Exode 28 v. 4). Pour la guerre, les soldats ceignaient l’épée sur leur hanche (voir reins). Les « reins ceints » sont par conséquent la figure de la fermeté et de la détermination, aussi bien dans la marche que dans le service et dans le combat spirituel (cf. Éphésiens 6 v. 14 ; 1 Pierre 1 v. 13).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHAIR - La chair est certes encore présente dans le croyant, mais elle n’est plus la seule force active dans sa vie. La « nouvelle nature », fortifiée et guidée par le Saint Esprit et par la parole de Dieu, est maintenant la vraie nature du croyant.
Le mot « chair » rencontré si souvent dans la Bible a différentes acceptions dont les plus importantes sont les suivantes :
1. la substance dont le corps humain est formé en grande partie (Genèse 17 v. 11 ; 1 Corinthiens 15 v. 39) ;
2. le corps humain ou la condition de ce corps sur la terre dans sa faiblesse et son caractère passager (Psaume 16 v. 9 ; Ésaïe 40 v. 6 ; Romains 2 v. 28 ; Philippiens 1 v. 24) ;
3. la nature humaine en tant que telle (Jean 1 v. 13 ; Galates 2 v. 16) ;
4. la nature pécheresse de l’homme, aussi du croyant (Romains 8 v. 3 ; Galates 5 v. 13) ;
5. le corps comme instrument du péché (Romains 7 v. 18 à 25) ;
6. l’état du pécheur non régénéré devant Dieu = le vieil homme (Romains 7 v. 5 ; Galates 5 v. 24 ; Éphésiens 2 v. 3 ; Romains 6 v. 6 ; Éphésiens 4 v. 22 ; Colossiens 3 v. 9).
La propension au péché de la chair et son incorrigibilité n’étaient pas encore pleinement révélées aux hommes de l’Ancien Testament. Toute la corruption de la nature humaine n’a été manifestée que lorsque les hommes ont condamné le seul juste à la mort de la croix comme un malfaiteur. Pourtant c’est précisément à la croix, en Christ, que le péché dans la chair a été condamné et qu’ainsi le chemin de la pleine délivrance a été frayé pour tous ceux qui croient en lui et en son œuvre. Il n’a pas seulement pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés, mais il a aussi porté le jugement de Dieu contre le péché dans la chair (notre « vieille nature »). Par conséquent, Dieu voit le croyant non plus dans sa vieille nature pécheresse, mais comme son enfant avec une nouvelle nature qui Lui correspond parfaitement. La chair est certes encore présente dans le croyant, mais elle n’est plus la seule force active dans sa vie. La « nouvelle nature », fortifiée et guidée par le Saint Esprit et par la parole de Dieu, est maintenant la vraie nature du croyant. Toutefois ce n’est qu’à l’enlèvement de l’Église que nous serons définitivement débarrassés de la chair liée à notre corps terrestre.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHAMEAU - Bête de somme, moins répandue en Israël que dans les autres nations.
Le chameau servait déjà aux patriarches de bête de somme et de monture, bien que plus tard il ne soit plus si fréquemment mentionné en rapport avec le peuple d’Israël (Genèse 12 v. 16 ; 31 v. 17). Il est vrai que le roi David possédait des chameaux, mais la surveillance en incombait à un Ismaélite (1 Chroniques 27 v. 30). Comme bête impure, le chameau ne devait pas être mangé par les Israélites, toutefois Jean le Baptiseur avait un vêtement de poil de chameau semblablement à son précurseur Élie (Lévitique 11 v. 4 ; Matthieu 3 v. 4 ; cf. 2 Rois 1 v. 8). La plupart des passages de l’Ancien Testament parlent du chameau comme d’une simple bête de somme, moins répandue en Israël que dans les autres nations. Comme le chameau était le plus grand animal domestique connu en Israël, le Seigneur Jésus se sert de lui à deux reprises comme figure dans des comparaisons. Il dit qu’« il est plus facile qu’un chameau entre par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu » et il reproche aux Juifs de couler le moucheron, c’est-à-dire de le filtrer, et d’avaler le chameau (Matthieu 19 v. 24 ; 23 v. 24). Dans ces deux cas il n’est question que de la grandeur de ces animaux.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHAMP, CAMPAGNE - Le champ est à l’origine une source de subsistance pour l’homme.
Le champ est à l’origine une source de subsistance pour l’homme. Adam avait reçu, de la part de Dieu, le devoir de cultiver et de garder le jardin d’Eden (Genèse 2 v. 15). En raison de la chute de l’homme, Dieu maudit le sol (Genèse 3 v. 17 à 19). Il devait dorénavant produire des épines et des ronces, et l’homme mangerait son pain à la sueur de son visage, c’est-à-dire avec beaucoup de peine. Depuis lors, le champ, la campagne et le sol sont fréquemment des symboles de la création qui doit souffrir sous les conséquences du péché et qui en porte les marques. Dans la parabole de l’ivraie parmi le froment, le Seigneur Jésus dit expressément : « Le champ, c’est le monde (Matthieu 13 v. 38) ».
Toutefois le cultivateur et le champ sont aussi employés comme figures de la prédication de la parole de Dieu et de ses conséquences dans le cœur des hommes. Le Seigneur Jésus compare le cœur humain au « champ » dans lequel la semence de la parole de Dieu est semée, et Paul appelle l’assemblée à Corinthe « le labourage de Dieu » qu’il avait planté et qu’Apollos avait arrosé (Matthieu 13 v. 3 à 9 ; 18 à 23 ; 1 Corinthiens 3 v. 7 à 9).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHAR, CHARIOT - Il est une figure de l’indépendance de l’homme.
Dans les temps bibliques, le char tiré par des chevaux servait avant tout de char de combat pour la guerre et comme signe représentatif du souverain (Genèse 41 v. 43 ; Exode 14 v. 6 et 7) ; toutefois les chars étaient aussi utilisés comme moyens de transport à la place des ânes et des chameaux habituellement employés (Genèse 45 v. 19 ; 1 Samuel 6 v. 7 ; Amos 2 v. 13). Le char est un moyen imaginé par l’homme pour faciliter son travail, pour appuyer son agressivité et pour se mettre en évidence ; en un mot il est une figure de l’indépendance de l’homme (cf. Psaume 20 v. 7 : « Ceux-ci font gloire de leurs chars, et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l’Éternel, notre Dieu ». Il était défendu aux Lévites de la famille de Kehath de transporter sur des chars, comme leurs frères, les ustensiles saints de la tente d’assignation; ils devaient les porter sur l’épaule (Nombres 7 v. 3 à 9). Ils n’étaient pas autorisés à recourir à des moyens humains pour leur sainte activité, si pratiques ceux-là pouvaient-ils paraître. Le roi David a dû l’apprendre d’une manière douloureuse (1 Chroniques 13 et 15).
Les chars sont cependant aussi vus comme attributs de la puissance de Dieu : Élie fut séparé de son serviteur et successeur Élisée par un char de feu et des chevaux de feu lorsqu’il monta aux cieux dans un tourbillon (2 Rois 2 v. 11). Un jour, Élisée a été protégé contre les Syriens par une armée de chevaux et de chars de feu (2 Rois 6 v. 17). Au psaume 68 v. 17, la majesté et la grandeur de Dieu sont comparées à des milliers de chars.
Dans la prophétie, les quatre empires sont comparés, en Zacharie 6 v. 1 à 8, à des chars et à des chevaux.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHEF, TÊTE - La place de Christ comme Chef sur toutes choses, lui le second homme, le dernier Adam, il l’a reçue de Dieu en vertu de son œuvre à la croix comme expression d’honneur suprême.
La tête (le chef) est la partie la plus noble de l’homme, le siège d’importants organes des sens et de l’intelligence. Il est dès lors compréhensible qu’au sens figuré aussi le mot tête (ou chef) soit synonyme d’autorité, de domination, de direction. L’homme le plus distingué d’une famille est appelé dans la Bible le « chef de sa maison de père (Exode 6 v. 14) », et les Israélites, selon Nombres 14 v. 4, voulaient établir un chef sur eux et retourner en Égypte.
Le chef tient une place importante dans les pensées de Dieu, ce qui n’est pleinement révélé que dans le Nouveau Testament. Le Fils de l’homme glorifié est maintenant « chef sur toutes choses (Éphésiens 1 v. 22) ». Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est désigné comme « Chef » à différents égards. Par là, il ne faut pas entendre la position du Dieu Souverain, que David déjà exprimait par ces paroles : « À toi, Éternel, est le royaume et l’élévation, comme Chef sur toutes choses (1 Chroniques 29 v. 11) », mais sa position actuelle comme Homme glorifié. Sa place comme Chef sur toutes choses, lui le second homme, le dernier Adam, il l’a reçue de Dieu en vertu de son œuvre à la croix comme expression d’honneur suprême ; cela parce que, par son abaissement profond et son entière obéissance, il s’est acquis tous les droits que le premier Adam avait perdus par la désobéissance (cf. Romains 5 v. 12 et suiv. ; 1 Corinthiens 15 v. 45 à 49 ; Colossiens 2 v. 10 ; Hébreux 2 v. 6 et suiv.).
Il possède maintenant toute autorité, mais en même temps il a soin de tout ce qui lui est confié. Son autorité comme Chef est étroitement liée à son autorité comme Seigneur, toutefois elle en est distincte. Il est le Chef sur toutes choses, le Chef de tout homme et le Chef de l’Assemblée, mais le Seigneur de chaque croyant individuellement, et un jour tous les hommes le confesseront comme Seigneur. Dans le Millénium, Dieu réunira merveilleusement en un toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre (Éphésiens 1 v. 10). Le Seigneur Jésus régnera alors en justice et en paix sur une création purifiée, et nous avec lui. Sous un autre rapport, le Seigneur Jésus est aussi le Chef de tout homme dans le monde (1 Corinthiens 11 v. 3).
Selon l’ordre de la création, l’homme est le chef de la femme, car il est « l’image et la gloire de Dieu (1 Corinthiens 11 v. 3 à 7; Éphésiens 5 v. 23) ». Une autorité s’est toutefois interposée dans la personne de Christ, le second Homme et le dernier Adam, qui est l’image parfaite de Dieu et qui l’a glorifié là où le premier homme l’a déshonoré. Comme Homme glorifié, Christ est maintenant le Chef de l’homme et, dans cette «hiérarchie», Dieu est le Chef de Christ.
Enfin Christ est aussi le Chef de l’Assemblée. Il s’agit là de la relation de loin la plus précieuse de toutes celles dans lesquelles il est le Chef. Seule l’Assemblée est son corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous, et elle seule est appelée son épouse qu’il a aimée et pour laquelle il s’est livré. Rien n’est aussi inséparable que la tête et le corps, et rien ne pourrait mieux décrire le véritable amour que la relation entre mari et femme dans le mariage. Pour nous permettre de comprendre ces merveilleuses relations spirituelles, dans sa sagesse et dans sa bonté, Dieu nous en a donné des images dans la création. Comme Chef, le Seigneur Jésus est spirituellement pour l’Assemblée non seulement ce que la tête est pour notre corps (Colossiens 1 v. 18), mais aussi ce que le mari doit être pour sa femme quant à sa position et dans la vie pratique (Éphésiens 5 v. 23).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHEMIN, VOIE - Le vrai chemin ne peut être indiqué que par Dieu.
Au sens figuré, le chemin parle souvent de l’orientation de notre vie. Le vrai chemin ne peut être indiqué que par Dieu (Genèse 18 v. 19 ; 24 v. 48 ; Nombres 18 à 20 ; Psaume 139 v. 24), et lui seul peut garder l’homme sur ce chemin (Genèse 28 v. 20 ; Psaume 91 v. 11). Particulièrement dans les Psaumes et dans les Proverbes, il est beaucoup question du bon mais aussi du mauvais chemin. Le chemin de la foi et de l’obéissance est un chemin droit (Psaume 107 v. 7 ; 2 Pierre 2 v. 15), tandis que les chemins de propre volonté sont tortueux et mauvais (Proverbes 21 v. 8 ; 28 v. 10).
Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples qu’il n’y a pour l’homme que deux chemins: le chemin spacieux qui mène à la perdition, et le chemin resserré qui mène à la vie (Matthieu 7 v. 13). En Actes 16 v. 17, la foi chrétienne est appelée « la voie du salut », et elle est nommée simplement « la voie » aux chapitres 9 (v. 2 ); 18 (v. 26) ; 19 (v. 9, 23) ; 22 (v. 4) ; 24 (v.22).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHEVAL - L’image du cheval sert à montrer la puissance de Dieu.
En raison de sa grandeur, de sa force et de sa rapidité, le cheval a toujours joué un rôle particulier pour les hommes. Toutefois dans l’Antiquité, il était utilisé presque exclusivement comme monture ou bête de trait pour la guerre, et aussi pour la représentation (Deutéronome 20 v. 1 ; 2 Samuel 15 v. 1). Au début de l’histoire du peuple d’Israël, la possession de chevaux n’était certes pas une chose usuelle ; cependant David et surtout Salomon commencèrent à posséder des chevaux, malgré le commandement de Dieu selon lequel un roi ne devait pas avoir « une multitude de chevaux (Deutéronome 17 v. 16 ; 2 Samuel 8 v. 4 ; 1 Rois 4 v. 26) ». L’engagement de chevaux dans le combat était de la part du peuple de Dieu un signe de manque de confiance en l’Éternel (Psaume 20 v. 7 ; 33 v. 17 ; 147 v. 10 ; Ésaïe 31 v. 1 ; Osée 14 v. 3).
D’un autre côté, le Saint Esprit utilise dans la Bible l’image du cheval pour montrer la puissance de Dieu. L’enlèvement d’Élie fut accompagné de chevaux, d’un char et de cavaliers de feu (2 Rois 2 v. 11 et 12), et le serviteur d’Élisée a fait l’expérience du puissant secours de Dieu contre les Syriens en voyant une armée de chevaux et de chars de feu (2 Rois 6 v. 17).
Dans le langage prophétique aussi, les chevaux sont le symbole de la puissance de Dieu dans son gouvernement par le moyen des quatre grands empires universels (Zacharie 1 v. 8 ; 6 v. 1 à 8), mais aussi lors de la visitation de la terre par le jugement pendant la grande tribulation (Apocalypse 6 v. 1 à 8). Lors de son apparition en gloire pour exercer le jugement sur le monde et pour l’établissement de son règne de paix, le Seigneur Jésus sera assis sur un cheval blanc (Apocalypse 19 v. 11).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHEVEU, POIL - L’homme porte les cheveux courts, la femme les cheveux longs.
La chevelure est une parure naturelle de l’homme, et la calvitie est fréquemment dans la Bible une figure du deuil et de la honte (Ésaïe 3 v. 17 ; Jérémie 41 v. 5). Les cheveux sont aussi une marque distinctive de la position de l’homme et de la femme dans la création. Selon l’ordre de la création voulu par Dieu, la femme doit avoir une longue chevelure, alors que celle-ci est un déshonneur pour l’homme. Aussi est-il déshonnête pour la femme d’avoir les cheveux coupés. L’homme porte les cheveux courts, la femme les cheveux longs (1 Corinthiens 11 v. 6, 14, 15 ; cf. Ézéchiel 44 v. 20 ; Apocalypse 9 v. 8). Dans l’Ancien Testament, la loi du nazaréen contient une exception remarquable : pendant sa séparation pour Dieu, le nazaréen devait ne rien manger de la vigne, ne toucher aucune personne morte et ne pas couper ses cheveux, exprimant par là sa pleine soumission à la volonté de Dieu (Nombres 6 v. 4 et suiv.).
Le poil peut aussi être une figure des excès de la chair qui doivent être rejetés, c’est-à-dire jugés, par exemple lors de la purification de la plaie de lèpre (Lévitique 13 v. 3 et suiv. ; 14 v. 8). Les cheveux blancs du vieillard parlent de la dignité et de la sagesse (Proverbes 16 v. 31 ; Apocalypse 1 v. 14).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHÈVRE (bouc) - La chèvre est l’animal le plus fréquemment ordonné et employé pour le sacrifice pour le péché.
Les chèvres sont des animaux peu exigeants qui trouvent de la nourriture même dans les fourrés les plus maigres. Ce sont, encore aujourd’hui, des animaux domestiques appréciés dans le Proche-Orient. Leurs longs poils bruns foncés sont utilisés par les bédouins pour la fabrication des bâches de tentes et autres tissus ménagers (cf. Nombres 31 v. 20 ; 1 Samuel 19 v. 16 ; Cantique 1 v. 5). Les tapis, qui formaient la véritable « tente par-dessus le tabernacle » de la tente d’assignation, étaient faits de poil de chèvre (Exode 26 v. 7 ; 35 v. 26 ; 36 v. 14).
Dans maints passages de l’Ecriture, la chèvre est en relation avec le péché. Rebecca et Jacob ont trompé Isaac, un vieillard presque aveugle, avec deux chevreaux bien apprêtés et leurs peaux (Genèse 27 v. 9 à 16). Plus tard, Jacob lui-même a été trompé par ses fils, lorsqu’ils ont plongé dans le sang d’un bouc la tunique de son fils Joseph qu’ils avaient vendu, et ont fait croire à leur père qu’il avait été tué par une bête sauvage (Genèse 37 v. 31 et suiv.). En Matthieu 25 v. 32 et suivants, les chèvres désignent les incrédules.
En hébreu, un seul et même mot est employé généralement pour le péché et le sacrifice pour le péché (hébr. chattath). De manière caractéristique, la chèvre est l’animal le plus fréquemment ordonné et employé pour le sacrifice pour le péché (Lévitique 4 v. 23 à 28 ; 5 v. 6 ; 16 v. 5 ; Nombres 28 v. 15). La tente de poil de chèvre, qui était posée par-dessus le tabernacle, est par conséquent aussi une figure appropriée du fait que, par son sacrifice accompli une fois pour toutes pour les péchés (Hébreux 10 v. 12), le Seigneur Jésus, le seul homme sans péché (2 Corinthiens 5 v. 21 ; Hébreux 7 v. 26 ; 1 Pierre 2 v. 22 ; 1 Jean 3 v. 5), est la sûre protection de tous les siens.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CHIEN - L’image du chien décrit les hommes impurs, méchants et détestables.
Selon la loi du Sinaï, les chiens étaient considérés comme des bêtes impures. Le prix d’un chien ne devait pas être apporté dans la maison de l’Éternel (Deutéronome 23 v. 18). Dans l’Antiquité, les chiens n’étaient généralement pas les animaux domestiques que nous connaissons aujourd’hui, mais des bêtes à moitié sauvages, vivant plus ou moins en liberté. Ils étaient le symbole de l’impureté et de la voracité.
Dans la parole de Dieu, l’image du chien décrit les hommes impurs, méchants et détestables (cf. Psaume 22 v. 16 ; Ésaïe 56 v. 11 ; Philippiens 3 v. 2 ; Apocalypse 22 v. 15). En rapport avec ceux qui ont appris à connaître le christianisme et qui s’en sont détournés, Pierre cite ce proverbe: «Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi lui-même, et la truie lavée, à se vautrer au bourbier» (2 Pierre 2 v. 22). Le chien représente ici l’homme naturel qui ne change pas, même s’il a acquis une connaissance extérieure de la grâce de Dieu. Quelle différence présente, par contre, la brebis docile, paisible et dépendante des soins du berger, qui est si souvent employée, dans la parole de Dieu, comme figure du croyant (cf. Psaume 23 ; Jean 10) !
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CIRCONCISION - À la croix, Dieu a condamné le péché dans la chair.
La circoncision, qui consiste dans l’ablation du prépuce, était le signe de l’alliance que Dieu a conclue avec Abraham et sa descendance (Genèse 17 v. 10 et 11). Le caractère symbolique de la circoncision a déjà été montré au peuple d’Israël lorsque Dieu a dit : « Circoncisez donc votre cœur, et ne roidissez plus votre cou ! (Deutéronome 10 v. 16) ». Le prépuce est un symbole de l’impureté et de la méchanceté de la chair non jugée de l’homme. Dans le Nouveau Testament, l’incirconcision est une désignation métaphorique des nations païennes, de même que la « circoncision » l’est des Juifs (Galates 2 v. 7 à 9 ; Éphésiens 2 v. 11).
La signification spirituelle de la circoncision n’est toutefois donnée que dans le Nouveau Testament. Comme symboliquement lors de la circoncision un morceau de chair était coupé, ainsi Christ, comme substitut, a laissé s’exécuter sur lui le jugement du Dieu saint contre la chair de péché, la vieille nature de l’homme. À la croix, Dieu « a condamné le péché dans la chair (Romains 8 v. 3) ». La « circoncision du Christ », c’est-à-dire la mort de Christ à la croix, est en même temps la fin du vieil homme (Colossiens 2 v. 11). Celui qui croit en Lui peut maintenant savoir que le vieil homme est crucifié avec Lui, et que de ce fait le corps (c’est-à-dire le mécanisme, le principe) du péché est annulé (Romains 6 v. 6). Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sont en lui « circoncis d’une circoncision qui n’a pas été faite de main… par la circoncision du Christ ». Ils ont discerné par la foi le jugement de Dieu sur le vieil homme et ils sont, contrairement à ceux qui restent encore attachés à la loi et à la circoncision extérieure, la vraie circoncision (Philippiens 3 v. 3).
La circoncision du peuple d’Israël à Guilgal (Josué 5) est là pour nous montrer que le jugement de la chair doit être non pas seulement une doctrine, mais une réalité pratique dans notre vie de foi.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CŒUR - Le cœur pécheur est purifié par la foi, et du cœur on croit à justice.
Le cœur est le plus souvent mentionné dans l’Ecriture sainte au sens figuré comme le siège des affections et de l’intelligence, mais avant tout comme le siège de la volonté et des décisions (1 Rois 3 v. 12 ; Psaume 90 v. 12). Le cœur est le « poste de commande » intérieur de l’homme. En Genèse 6 v. 5, Dieu devait déjà constater « que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que méchanceté en tout temps », et en Jérémie 17 v. 9, il est dit : « le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable ; qui le connaît ? » C’est pourquoi il adresse cet appel à l’homme : « Garde ton cœur plus que tout ce que l’on garde, car de lui sont les issues de la vie », et : « Mon fils, donne-moi ton cœur (Proverbes 4 v. 23 ; 23 v. 26) ». Le cœur pécheur est purifié par la foi et du cœur on croit à justice (Actes 15 v. 9 ; Romains 10 v. 10).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• COLOMBE, PIGEON - La colombe est un symbole approprié de Christ.
La colombe est l’image de la pureté et de l’innocence (cf. Genèse 8 v. 8 ; Matthieu 10 v. 16) et ainsi un symbole approprié de Christ, l’Homme venu du ciel (1 Corinthiens 15 v. 47). Le fiancé dans le Cantique des cantiques appelle sa fiancée sa colombe, sa parfaite (Cantique 5 v. 2 ; 6 v. 9). Le psalmiste, qui voulait s’enfuir loin du méchant et être séparé des pécheurs, demandait : « Oh ! si j’avais des ailes comme une colombe (Psaume 55 v. 6) ». Quand le Seigneur Jésus fut baptisé au Jourdain, le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme visible comme une colombe (Matthieu 3 v. 16). D’entre tous les oiseaux, seuls des jeunes pigeons ou des tourterelles pouvaient être présentés comme sacrifices, c’est-à-dire qu’ils étaient considérés comme purs (par exemple en Lévitique 1 v. 14 à 17 comme holocauste ; en Lévitique 5 v. 7 à 10 comme sacrifice pour le péché).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• COLONNE, PILIER - Des hommes dignes de confiance sont désignés comme des colonnes.
Les colonnes ou les piliers ne jouent pas seulement un rôle dans la construction comme éléments à la fois porteurs et décoratifs, mais ils étaient aussi érigés autrefois comme monuments (2 Samuel 18 v. 18), ou pour signaler un lieu consacré à l’idolâtrie (Deutéronome 12 v. 3 ; Jérémie 10 v. 5). Dans la tente d’assignation, les voiles étaient suspendus à des piliers (Exode 26 v. 32). Dans le temple de Salomon, il y avait des chambres latérales qui reposaient sur des colonnes, et dans le Nouveau Testament, il est fait mention du « portique de Salomon » (1 Rois 7 v. 2 et suiv. ; Jean 10 v. 23). Au sens figuré, il est parlé des « piliers de la terre » (1 Samuel 2 v. 8 ; Job 9 v. 6) et des « colonnes des cieux » (Job 26 v. 11). Des hommes dignes de confiance sont aussi désignés comme des colonnes, c’est-à-dire comme des appuis pour d’autres, tels Jérémie dans l’Ancien Testament et Jacques, Jean et Pierre dans le Nouveau Testament (Jérémie 1 v. 18 ; Galates 2 v. 9). Dans ces cas, il faut comprendre, par colonne, un élément porteur.
Les deux colonnes d’airain, que Salomon a fait dresser devant le temple, n’avaient toutefois aucune fonction porteuse. Elles ont reçu le nom de Boaz (« en lui est la force ») et de Jakin (« il établira, affermira ») et elles témoignaient publiquement que la force et la fermeté ne se trouvent qu’en Dieu (1 Rois 7 v. 15 et 16). Il est remarquable que leur description exacte soit répétée à deux reprises lors de la destruction du temple (2 Rois 25 v. 16 et 17 ; Jérémie 52 v. 21 et 22). C’est comme si le Saint Esprit voulait attirer l’attention sur le fait que la signification symbolique de ces colonnes est particulièrement importante dans des temps de ruine.
Dans le Nouveau Testament, il est aussi question de colonnes qui ne sont pas porteuses, mais qui sont dressées comme témoignage. L’Assemblée de Dieu est appelée en 1 Timothée 3 v. 15, « la colonne et le soutien de la vérité », et le Seigneur adresse au vainqueur à Philadelphie cette parole d’encouragement : «... je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors ; et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem... (Apocalypse 3 v. 12) ». Les souverains de l’Antiquité avaient pour coutume d’ériger des colonnes ou des obélisques taillés et couverts d’inscriptions à la mémoire de leurs exploits. Ces colonnes sont connues aussi bien en Égypte qu’à Rome. C’est vraisemblablement là le symbole placé devant nous dans ces deux passages. L’Assemblée représente sur la terre la vérité de Dieu en sainteté et en grâce, et les croyants qui y sont demeurés attachés dans les difficultés du temps présent en rendront bientôt un témoignage durable dans la gloire.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• COMBAT, GUERRE - Dans la Bible, il est beaucoup question de combats et de guerres.
Plusieurs lecteurs de la Bible rencontrent des difficultés à l’égard des combats du peuple d’Israël dans l’Ancien Testament, ne pouvant pas concilier la cruauté qui y est commise avec l’amour et la grâce de Dieu. Il faut cependant tenir compte de ce qui suit. Lorsque Dieu a promis à Abraham et à sa descendance le pays de Canaan comme possession à toujours, on trouve déjà la mention des péchés des Cananéens. Quand bien même ceux-ci pratiquaient les égarements moraux les plus abominables de l’idolâtrie, Dieu, dans sa grâce, leur a encore accordé un délai : « l’iniquité des Amoréens n’est pas encore venue à son comble (Genèse 15 v. 16) ».
Comme il l’a fait par le déluge ou comme pour Sodome et Gomorrhe, il aurait pu les exterminer sans l’intervention de l’homme ; mais dans ce cas, il s’est servi de son peuple terrestre comme instrument, de même qu’inversement il a utilisé plus tard l’Assyrien pour châtier Israël (Ésaïe 10 v. 5). D’ailleurs les Israélites ne devaient pas forcément tuer les Cananéens mais les chasser du pays. Oui, Dieu lui-même voulait les expulser, si seulement son peuple lui obéissait (Exode 23 v. 28 ; 34 v. 24 et beaucoup d’autres passages). Toutefois Israël devait voir les abominations des premiers habitants de Canaan et apprendre à les tenir en horreur. Cela ne s’est malheureusement pas produit, et il en est résulté les luttes que le peuple a connues pendant des siècles, au cours desquelles Israël était souvent vaincu. Un autre facteur qu’il convient de prendre en considération est que chaque Israélite était responsable des iniquités qu’il commettait.
Les combats d’Israël en Canaan sont un type du combat spirituel contre la puissance de méchanceté (Éphésiens 6 v. 11 et suiv.). Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont en effet exhortés à être prêts pour le combat spirituel. Pour cela le grec emploie différents mots qui sont classés en deux groupes principaux : les expressions qui parlent de la guerre (grec : mache, polemos, strateia), et celles qui se rapportent à la compétition (grec : agon, athlesis, pale). En 2 Timothée 2 v. 3 à 5 nous trouvons les deux figures ensemble : d’abord celle du soldat qui doit se consacrer à un seul devoir, à savoir le combat, puis celle de l’athlète qui ne peut recevoir le prix que s’il a combattu selon les « règles du jeu ».
À la première sorte de combat appartiennent le combat de l’Évangile dans le monde (2 Corinthiens 7 v. 5 ; Philippiens 4 v. 3), dans lequel se font face la lumière et les ténèbres, puis le combat contre la puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes, qui veut nous ravir la jouissance des bénédictions (Éphésiens 6 v. 11 et suiv.), et le combat pour la vérité de Dieu (2 Corinthiens 10 v. 3 et 4). C’est le « bon combat (grec: strateia) » que nous avons à combattre (1 Timothée 1 v. 18 ; 2 Timothée 4 v. 7). Dans chaque cas, Satan est l’ennemi qui cherche à résister, par ses instruments, à l’activité de Dieu. Cependant dans ce combat nos armes ne doivent pas être charnelles, ni les hommes être l’objet de l’attaque, car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair.
Le second groupe d’expressions, qui est issu des compétitions athlétiques si prisées de la Grèce antique, place devant nous la tempérance, les efforts et la détermination du lutteur ou du coureur comme exemples pour notre vie spirituelle (1 Corinthiens 9 v. 24 et suiv. ; Philippiens 1 v. 30 ; 3 v. 13 et 14 ; Colossiens 2 v. 1 ; 1 Thessaloniciens 2 v. 2 ; Hébreux 10 v. 32 ; 12 v. 1). Là aussi nous avons affaire au « bon combat (grec : agon) de la foi » (1 Timothée 6, v. 12). La pensée d’une victoire sur l’« adversaire » ne joue en l’occurrence aucun rôle.
Il y a toutefois deux sortes de combats que le chrétien ne doit pas mener : le combat contre le péché habitant en lui, auquel il doit se tenir lui-même pour mort (Romains 6 v. 11), et les contestations avec les autres, qu’ils soient des croyants ou non (2 Timothée 2 v. 24). Nous sommes appelés à la paix.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CONSOLATEUR, AVOCAT - Notre Dieu et Père nous a donné ce Consolateur.
Le mot grec paraklétos signifie à l’origine « celui qu’on appelle à son côté », c’est-à-dire celui qu’on appelle à son secours, et peut être aussi traduit par « intercesseur, consolateur ». Sa définition est : « Celui qui soutient la cause de quelqu’un devant le juge, un avocat ». Le mot est employé dans le Nouveau Testament aussi bien pour le Saint Esprit que pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus désigne le Saint Esprit comme l’« autre consolateur » que le Père donnerait aux disciples (Jean 14 v. 16). Jusqu’ici il avait pris soin lui-même de ses disciples, mais il s’en « irait », c’est-à-dire monterait au ciel, et il leur enverrait ensuite le Consolateur (Jean 16 v. 7) qui leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait toutes les choses qu’il leur avait dites (Jean 14 v. 26). Il rendrait aussi témoignage du Seigneur glorifié dans le ciel (Jean 15 v. 26).
Par Jean 7 v. 39, nous savons que le Saint Esprit est venu sur la terre après l’ascension de Jésus (cf. Actes 1 v. 5 ; 2 v. 1 à 4 ; 1 Corinthiens 12 v. 13). Quiconque accepte maintenant l’évangile du salut par la foi reçoit le Saint Esprit comme sceau et arrhes (Éphésiens 1 v. 13 et 14). C’est là une merveilleuse bénédiction pour laquelle nous ne pouvons être assez reconnaissants. Parmi ses nombreuses fonctions, le Saint Esprit a aussi celle de conduire les croyants sur leur chemin (Romains 8 v. 14 ; Galates 5 v. 18) et d’intercéder pour eux auprès de Dieu lorsque dans leur faiblesse ils ne savent plus ce qu’ils doivent demander (Romains 8 v. 26 et 27). En toutes choses, nous discernons les soins de notre Dieu et Père qui nous a donné ce Consolateur.
En 1 Jean 2 v. 1, le Seigneur Jésus lui-même est aussi appelé notre avocat (ou consolateur) : « Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste ». L’office d’avocat de Christ a pour but la restauration de la communion avec le Père lorsqu’un enfant de Dieu a péché, tandis que, comme Souverain Sacrificateur, il agit pour nous auprès de Dieu, afin de nous garder sur le chemin de la foi. Quelle bénédiction pour nous de savoir que le Seigneur Jésus est notre avocat auprès du Père et d’avoir le Saint Esprit habitant en nous comme autre Consolateur !
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CORBEAU - Presque tous les oiseaux dans la Bible peuvent être des figures des esprits immondes, et des figures des démons.
Selon la loi, toutes les espèces de corbeaux étaient impures (Lévitique 11 v. 15). Lorsque Noé, après le déluge, a lâché hors de l’arche un corbeau, ce dernier, contrairement à la colombe, a trouvé immédiatement de la nourriture : comme omnivore, il se nourrissait aussi des corps morts des bêtes, bien qu’il ait dû aller et revenir jusqu’à ce que les eaux aient séché (Genèse 8 v. 7). Au sujet du pays d’Edom rendu désert, il est dit prophétiquement : « Le pélican et le butor l’hériteront, et le hibou et le corbeau y habiteront (Ésaïe 34 v. 11) ». La merveilleuse puissance de Dieu est montrée en ce que les corbeaux, connus pour leur voracité, ont dû nourrir le prophète Élie avec de la chair et du pain (1 Rois 17 v. 4 à 6). Dans ses soins, il entend aussi le cri des jeunes corbeaux et leur donne de la nourriture (Job 39 v. 3 ; Psaume 147 v. 9), et c’est bien pour cela que le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’ont pas de cellier ni de grenier ; et Dieu les nourrit : combien valez-vous mieux que les oiseaux ! (Luc 12 v. 24) ». Presque tous les oiseaux dans la Bible peuvent être des figures des esprits immondes et des démons (Apocalypse 18 v. 2).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CORNE - La corne parle de vigueur, de force ou de puissance.
La corne parle de vigueur, de force ou de puissance : « Avec notre force, ne nous sommes-nous pas acquis de la puissance (en note, litt. : des cornes) ? » est-il dit en Amos 6 v. 13 (cf. Deutéronome 33 v. 17 ; 1 Samuel 2 v. 1 ; 1 Rois 22 v. 11 ; Michée 4 v. 13). Sa signification symbolique peut être aussi bien positive que négative (Psaume 75 v. 10 ; Ézéchiel 34 v. 21). Les sept cornes de l’Agneau au milieu du trône de Dieu montrent la puissance divine parfaite du Seigneur glorifié (Apocalypse 5 v. 6), alors que les dix cornes du chef de l’Empire romain et les deux cornes de l’Antichrist parlent de puissance diabolique (Apocalypse 13 v. 1 à 11).
Les cornes qui se trouvaient aux quatre coins de l’autel de l’holocauste et de l’autel de l’encens sont particulièrement intéressantes (Exode 27 v. 2 ; 30 v. 2). En elles s’exprimait l’importance universelle de l’autel. Elles indiquaient pour ainsi dire les quatre points cardinaux et rendaient par là en figure ce témoignage : de même que le monde entier est tombé sous le jugement de Dieu, de même la grâce de Dieu s’adresse au monde entier en vertu de l’œuvre de la propitiation accomplie par Christ (Romains 3 v. 19 ; Jean 3 v. 16). Le sang du sacrifice pour le péché pour le peuple d’Israël devait être mis sur les cornes de l’autel de l’holocauste (Lévitique 4 v. 30) et là le coupable trouvait aussi un lieu de refuge (1 Rois 1 v. 50).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CORPS - Le corps est la partie matérielle de l’homme comme créature de Dieu et en constitue la forme.
Le corps est la partie matérielle de l’homme comme créature de Dieu et en constitue la forme. L’âme et l’esprit sont des désignations bibliques en rapport avec son être intérieur qui se manifeste dans les actions du corps (cf. 1 Thessaloniciens 5 v. 23). Le corps naturel est périssable, mais il sera ressuscité à la venue de Christ en gloire (1 Corinthiens 15 v. 42 à 44). Le mot « corps » est employé à diverses reprises au sens figuré.
1. Le sens figuré essentiellement donné au corps humain dans la parole de Dieu est celui dans lequel l’Assemblée est présentée comme corps de Christ. Il est la tête déjà glorifiée dans le ciel, et tous les croyants forment ensemble son corps sur la terre (Colossiens 1 v. 18). Chaque croyant individuellement est un membre de ce corps (1 Corinthiens 6 v. 15 ; 12 v. 27). L’unité de ce corps est indestructible et trouve son expression visible à la Table du Seigneur (1 Corinthiens 10 v. 16, 17). La désignation « corps de Christ » peut se rapporter à l’Assemblée selon le conseil de Dieu, c’est-à-dire à tous les croyants depuis la Pentecôte jusqu’à l’enlèvement de l’Église (Éphésiens 1 v. 22 et 23), comme aussi à tous les membres vivant sur la terre à un moment précis (Éphésiens 4 v. 4) et aux croyants en un lieu déterminé qui, comme assemblée locale, représentent le seul corps d’une manière visible (1 Corinthiens 12 v. 27).
2. En Jean 2 v. 21, le corps humain du Seigneur Jésus est le temple de Dieu ; en 1 Corinthiens 6 v. 19, le corps du croyant est le temple du Saint Esprit.
3. En Romains 6 v. 6, le « corps du péché » ne se rapporte pas au corps humain que nous avons encore, mais au mal comme tout l’ensemble et le système du péché habitant dans l’homme, en tant qu’entité et nature même du péché. L’homme non régénéré demeure sous la contrainte du péché; toute son existence n’est constituée que par le péché; cette «machinerie» du péché est cependant abolie par la foi en l’œuvre de la rédemption, puisque, à la croix, le vieil homme est crucifié avec Christ. Il faut comprendre de la même manière l’expression «la loi du péché et de la mort», en Romains 8 v. 2, de laquelle le croyant est affranchi. Si, par la foi en Christ, le croyant n’est pas encore débarrassé du péché, il est cependant affranchi de la « loi du péché », de l’obligation de pécher. Cet « affranchissement » peut être la part de chaque croyant.
4. En Colossiens 2 v. 17, il est question d’« ombre » et de « corps ». Les types dans l’Ancien Testament (spécialement dans la loi du Sinaï) sont les ombres (Hébreux 8 v. 5 ; 10 v. 1) de la vérité du Nouveau Testament; la réalité n’a été révélée que par Christ et son œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Il ne s’agit donc ici ni du corps humain ni du corps spirituel de Christ, mais de l’ensemble de la vérité du Nouveau Testament, présentée en types dans l’Ancien Testament, mais révélée par Christ et par le Saint Esprit.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CORPS (mort d’une bête) - La bête morte est une figure de l’homme naturel qui, devant Dieu, est mort dans ses fautes et dans ses péchés, qui est corrompu.
Selon la loi, la chair des bêtes mortes était impure et ne pouvait par conséquent être ni mangée ni touchée par les Israélites (Exode 22 v. 31 ; Lévitique 17 v. 15). Tout ce qui entrait en contact avec la bête morte devenait impur, toutefois l’homme l’était seulement jusqu’au soir ; celui qui l’avait portée ou mangée devait en outre laver ses vêtements (Lévitique 11 v. 31 à 40). La bête morte est une figure de l’homme naturel qui, devant Dieu, est mort dans ses fautes et dans ses péchés, qui est corrompu (Éphésiens 2 v. 1 ; 4 v. 22) ; mais elle est aussi une figure de la chair pécheresse dans le croyant, en laquelle il n’habite point de bien (Romains 7 v. 18). Selon Romains 6 v. 6, « notre vieil homme » est « crucifié », et selon Galates 5 v. 24, « ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises », c’est-à-dire qu’elle doit être considérée comme étant morte. Mais chaque enfant de Dieu sait par expérience que la chair s’éveille souvent et souille par son action. Cependant l’eau de la parole de Dieu purifie toujours de telles manifestations.
En Matthieu 24 v. 28, le corps mort est une figure du peuple d’Israël rebelle et spirituellement mort, qui s’est volontairement soumis à l’Antichrist. Les aigles y sont l’expression du jugement de Dieu venant du ciel et dévorant tout.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• COUPE - Au sens figuré, la coupe représente souvent la bénédiction ou la malédiction.
La coupe est un récipient noble qui est utilisé par certaines personnes ou dans des occasions particulières et qui, de ce fait, reçoit une signification spéciale. L’échanson, mis sous garde par le Pharaon, songea qu’il tendait au Pharaon sa coupe dans laquelle il avait pressé les raisins mûrs, et il fut aussi rétabli dans son office (Genèse 40 v. 11 et suiv.). Joseph a utilisé sa coupe d’argent comme moyen pour revoir son frère Benjamin et pour amener ses frères à la repentance (Genèse 44). Au sens figuré, la coupe représente souvent la bénédiction ou la malédiction. Au psaume 16 v. 5, David parle de l’Éternel comme étant la portion de sa coupe, et au psaume 23 v. 5, il peut dire que sa coupe déborde de bénédictions.
Dans les évangiles, les souffrances du Seigneur Jésus sont comparées à une coupe qui pouvait bien troubler l’âme de Celui qui était saint et sans péché; il pria disant : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux (Matthieu 26 v. 39) ». Pendant sa vie terrestre, cette coupe était continuellement devant lui (Matthieu 20 v. 22), cependant quand le moment s’est approché, la détresse de son âme s’est traduite par ces paroles. Mais à aucun instant il n’a connu dans son cœur une volonté contraire à celle du Père ! Il pouvait ainsi dire à Pierre : « La coupe que le Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ? (Jean 18 v. 11) ».
Avec la cène, le Seigneur Jésus a laissé aux siens la coupe de bénédiction (1 Corinthiens 10 v. 16). Celle-ci est le symbole de son sang versé pour nous, par lequel celui qui croit en lui a reçu les plus hautes bénédictions.
En revanche, déjà dans l’Ancien Testament, la coupe de feu et de soufre, c’est-à-dire du jugement, est tendue aux ennemis de Dieu (Psaume 11 v. 6 ; cf. 75 v. 8). Dans les jugements à venir de la grande tribulation, il est aussi question plusieurs fois de la coupe de la colère ou de la fureur de Dieu (Apocalypse 14 v. 10 ; 16 v. 19).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• COURONNE - La couronne est le symbole de la souveraineté royale.
La couronne est le symbole de la souveraineté royale (2 Rois 11 v. 12), mais aussi, dans l’Ancien Testament déjà, du mérite, de l’honneur et de la dignité. Ainsi une femme vertueuse est appelée la couronne de son mari, et les richesses sont la couronne des sages (Proverbes 12 v. 4 ; 14 v. 24). Dans le Nouveau Testament, il faut entendre par couronne celle du vainqueur (grec stephanos), qui est promise à l’athlète comme stimulation et récompense. Nous trouvons la couronne de justice (2 Timothée 4 v. 8), la couronne de vie (Jacques 1 v. 12 ; Apocalypse 2 v. 10) et la couronne inflétrissable de gloire (1 Pierre 5 v. 4). C’est aussi dans ce sens qu’il faut comprendre, dans l’Apocalypse, les couronnes des 24 anciens qu’ils jettent devant le trône de Dieu et de l’Agneau en rendant hommage et dans l’adoration (Apocalypse 4 v. 4, à 10).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CRIBLE, CRIBLER - Le crible et l’action qui s’exécute par son moyen, le criblage, ne se trouvent dans la parole de Dieu qu’en rapport avec l’épuration du blé.
Le crible et l’action qui s’exécute par son moyen, le criblage, ne se trouvent dans la parole de Dieu qu’en rapport avec l’épuration du blé (Amos 9 v. 9). Après le battage, il était séparé de la balle au moyen d’un crible. Par la méthode du vannage, on jetait en l’air, avec une pelle, le produit du battage ; de ce fait, la balle était chassée par le vent. Le criblage ou le vannage parlent symboliquement du jugement de Dieu en purification (Osée 13 v. 3 ; Matthieu 3 v. 12), mais aussi des tentations de Satan qui cherche à effrayer les rachetés (Luc 22 v. 31). En Ésaïe 30 v. 24, le van est aussi un instrument pour séparer la balle du blé.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CUIRASSE - Les croyants sont exhortés à revêtir l’armure complète de Dieu.
À l’époque qui a précédé l’invention des armes à feu, la cuirasse de fer, qui recouvrait généralement tout le corps mais plus particulièrement sa partie supérieure, était une protection importante dans le combat contre les flèches et les coups de lance ou d’épée. En Ésaïe 59 v. 17, nous voyons Dieu revêtu de la cuirasse de la justice et du casque du salut quand il exercera ses jugements.
Dans le Nouveau Testament, les croyants sont exhortés à revêtir l’armure complète de Dieu, dont fait partie la cuirasse de la justice, de façon à être prêts pour le combat contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes (Éphésiens 6 v. 14) ; en 1 Thessaloniciens 5 v. 8, il est question de la cuirasse de la foi et de l’amour.
La cuirasse peut cependant être aussi une figure de l’endurcissement et de la méchanceté, comme le montrent les cuirasses de fer des sauterelles (méchanceté qui dévore tout) en Apocalypse 9 v. 9, et les cuirasses de feu, d’hyacinthe et de soufre des cavaliers (puissance qui inonde tout) au verset 17.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• CUVE, LAVER - Cela signifie pour nous que nous ne pouvons être dans la sainte présence et dans la communion du Seigneur que dans un jugement constant de nous-mêmes.
Dans le parvis de la tente d’assignation se trouvait une cuve d’airain remplie d’eau (appelée « mer de fonte » dans le temple ; Exode 30 v. 17 à 21 ; 1 Rois 7 v. 23 et suiv.). Les sacrificateurs devaient s’y laver les mains et les pieds lorsqu’ils entraient dans le lieu saint et lorsqu’ils offraient des sacrifices sur l’autel. S’ils ne le faisaient pas, ils devaient mourir. Par le contact avec des choses impures, ils étaient toujours dans l’obligation de se purifier à nouveau quand ils voulaient exercer leur service devant Dieu. À cet effet, il y avait l’eau de la cuve d’airain. Cela signifie pour nous que nous ne pouvons être dans la sainte présence et dans la communion du Seigneur que dans un jugement constant de nous-mêmes.
Par l’eau, un type de la parole de Dieu dans sa puissance purifiante (Éphésiens 5 v. 26), nous sommes ramenés à l’examen de nous-mêmes, à la confession, à la purification et ainsi à la joie de la communion. Lorsque notre cœur et notre conscience sont souillés par des pensées, des paroles ou des actes, le Saint Esprit n’a pas de repos jusqu’à ce qu’il nous ait conduits à la purification. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité (1 Jean 1 v. 9) ».
La purification nous est aussi montrée dans le lavage des pieds en Jean 13. Quant à leur position, les disciples étaient purs parce qu’ils étaient nés de nouveau. C’est pourquoi ils n’avaient pas besoin d’être «baignés» encore une fois. Mais afin qu’ils aient une part avec le Seigneur, c’est-à-dire communion avec lui, leurs pieds devaient toujours être lavés à nouveau. Cela demeure encore valable pour nous aujourd’hui si nous voulons avoir communion avec notre Seigneur dans le ciel. Le service du lavage spirituel des pieds n’est cependant pas exécuté seulement par Lui, mais en cela il nous a « donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez (Jean 13 v. 15) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• CHEMIN (les deux) - Si la conversion et la nouvelle naissance forment la porte d’entrée, la sainteté est bien la caractéristique du chemin resserré.
Matthieu 7 v. 13 et 14. On est soit sur l’un de ces chemins, soit sur l’autre ; il n’y en a pas d’intermédiaire, pas plus qu’il n’y a de place intermédiaire après la fin de ce temps du chemin. Notons bien ce que le Seigneur présente : Il montre, deux portes, deux chemins, deux groupes de voyageurs, deux buts. Dans cette vie, on se trouve soit sur le chemin resserré ou étroit, soit sur le chemin large, et on se dirige soit vers la vie, soit vers la perdition pour l’éternité.
Quand le Seigneur parle de perdition, Il utilise pour cela un mot (apoleia en grec) qui ne signifie pas dissolution ni anéantissement (l’Écriture sainte ne connaît pas cette pensée), mais une ruine ou une déchéance extrême et définitive, une perdition irrévocable. En ce sens, ce mot est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour décrire l’état après la mort et la séparation éternelle de la vraie vie divine (Jean 17 v. 12 ; Romains 9 v. 22 ; Philippiens 1 v. 28 ; 3 v. 19 ; 1 Timothée 6 v. 9 ; Hébreux 10 v. 39 ; 2 Pierre 2 v. 1, 3 ; 3 v. 16 ; Apocalypse 17 v. 8 à 11).
Le chemin resserré et étroit, ou le chemin large et spacieux ici-bas, la vie ou la perdition dans l’éternité, voilà la réalité que chacun doit regarder en face. Le fait que beaucoup suivent le chemin large n’en prouve pas la justesse. La vérité n’est pas du côté de la masse. Déjà Dieu avertissait dans l’Ancien Testament : « tu n’iras pas après le foule pour mal faire (Exode 23 v. 2) ». Même quand on est entré par la porte étroite, il faut une grande énergie, beaucoup de sérieuse décision de cœur pour se détacher de la grande masse et poursuivre à tout prix un chemin personnel qui soit bien « le chemin resserré ». Daniel, en son temps, avait déjà eu cette décision de cœur (Daniel 1), et Barnabas exhortait les jeunes croyants d’Antioche à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur (litt. : avec décision de cœur) (Actes 11 v. 23). Demeurer attaché au Seigneur, persévérer dans la foi, et être prêt à entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup d’afflictions (Actes 14 v. 22), voilà une bonne description du chemin resserré.
Ce n’est bien sûr pas un hasard si le mot grec pour resserré (tethlimmene = rétréci) est apparenté au mot thlipsis, qui signifie tribulation, détresse, oppression, affliction, tourment, angoisse. Si la conversion et la nouvelle naissance forment la porte d’entrée, la sainteté est bien la caractéristique du chemin resserré. Or dans un monde ennemi de Dieu, cela implique l’affliction, la détresse et la persécution. C’est tout autre chose qu’un chemin sans joie, mais la réalisation de la sainteté de Dieu et la conformité à Sa volonté en font un chemin « resserré ».
Or ceux qui parcourent le chemin resserré ont aussi trouvé ce chemin ou cette porte (l’expression ceux qui le trouvent peut viser aussi bien le chemin que la porte, du point de vue grammatical comme du point de vue du sens) : « peu nombreux sont ceux qui le trouvent ». Ce n’est certes pas à attribuer à leur propre mérite, mais à la seule grâce de Dieu dont nous venons de parler. La porte large et le chemin spacieux n’ont pas besoin d’être trouvés, car ils sont ouverts à tous et visibles de loin. Mais la porte étroite et le chemin resserré sont trouvés par la bonté de Dieu. C’est comme si, à l’occasion de cette trouvaille, on entendait résonner la joie de la surprise comme dans les trois paraboles de Luc 15.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• CHUTE (occasion) - Suis-je une aide ou une entrave ? Et qui puis est, une occasion de chute ?
Pour soi-même.
Matthieu 5 v. 28 à 30 mérite notre sérieuse attention. Il s’agit là d’un cas spécifique, qui chaque jour nous guette, jeune ou plus âgé, célibataire ou marié, si la convoitise, le désir coupable, vient suivre le regard. Dès que l’on se rend compte d’un attachement qui ne peut être selon Dieu, soit que la personne ne soit de toute évidence pas celle que le Seigneur a en vue pour fonder un foyer, ou que l’on soit déjà marié, il importe d’obéir sans retard à la parole du Seigneur : « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le » : ne plus se voir d’aucune manière ; « et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la » : plus de contact, plus de correspondance. Il faut de toute nécessité, sans égards et sans délai, couper une telle relation (Proverbes 6 v. 27 et 28).
Marc 9 v. 43 est plus général. En parlant ici de la main, du pied ou de l’œil, le Seigneur prévoit sans doute des actions, des lieux, des choses vues ou lues, qui sont en piège. Tout le témoignage peut en être gâté ; l’âme souillée, la lumière obscurcie. « Coupe, arrache », dit le Maître. On a commencé tel livre et découvre qu’il va souiller notre esprit ou troubler notre foi ; ayons l’énergie de le mettre aussitôt de côté. On fréquente tel camarade qui va nous entraîner dans le monde ou dans la tentation. Il faut rompre sans retard une telle amitié.
Pour les autres.
Après avoir placé au milieu des disciples un petit enfant, exemple d’humilité, le Seigneur ajoute, en Matthieu 18 v. 6 : « Quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu’on lui eût pendu au cou une meule d’âne et qu’il eût été noyé dans les profondeurs de la mer ». Combien sévèrement le Seigneur condamne ceux qui sont une occasion de chute pour un faible : un enfant dans la foi en Matthieu 18, ou l’un de ceux qui ne Le suit pas « avec nous », en Marc 9. Une parole légère, une plaisanterie douteuse, une réflexion faite en passant dont on n’a pas mesuré la portée, mais qui germera dans un jeune cœur ; de mauvais exemples, des doutes quant à la parole ; par-dessus tout, les médisances, les racontars, les critiques, sans parler du dénigrement de l’assemblée, des réunions, de tel ou tel serviteur du Seigneur.
Lorsqu’Abraham descendit en Égypte, il avait pour compagnon le jeune Lot. Le patriarche s’est rendu compte de sa faute et l’a jugée. Il est revenu jusqu’à Béthel où était sa tente au commencement ; son âme a été restaurée. Mais son neveu avait gardé dans son esprit la vision de l’Égypte et de ses attraits. Au jour décisif (Genèse 13 v. 10), se présente devant ses yeux toute la plaine du Jourdain, arrosée partout « comme le pays d’Égypte » ; le souvenir de ce qu’il y avait vu, l’a déterminé dans son choix. La première graine d’un égarement qui devait perdre la carrière et la famille de Lot, avait été semée par son oncle, sans qu’il l’ait certes réalisé. Suis-je une aide ou une entrave ? Et qui puis est, une occasion de chute ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• CULTIVATEUR (le riche) (1) - Quelle folie d’amasser des trésors pour soi sur cette terre, et de ne pas être riche quant à Dieu.
Luc 12 v. 13 à 21. Quand les disciples du Maître avaient demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier (Luc 11 v. 1) », le Seigneur ne leur avait pas seulement donné ce qu’on appelle le « notre Père », mais Il y avait ajouté la parabole des « trois amis ». Comme nous l’avons vu, Il illustrait par là l’urgence et l’importance de la prière. En second lieu, il y a la parabole du « riche cultivateur de blé » que nous avons devant nous ; elle est précédée de la demande d’un Juif : « Seigneur, dis à mon frère de partager l’héritage avec moi (12 v. 13) ». La troisième parabole faisant également suite à une demande est celle du « grain de blé ». Le Seigneur l’a prononcée à la suite de la prière adressée par quelques Grecs à Philippe : « Seigneur, nous désirons voir Jésus (Jean 12 v. 21) ».
Avertissement contre l’avarice.
Le Seigneur repousse absolument ce qu’on voulait obtenir de lui : « Homme, qui est-ce qui m’a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages ? (Luc 12 v. 14) ». S’Il s’était laissé entraîner dans cette affaire, Lui serait-il arrivé autre chose qu’à Moïse quand celui-ci voulut arbitrer une querelle entre deux frères ? « Mais celui qui faisait tort à son prochain, le repoussa, disant : Qui t’a établi chef et juge sur nous ? (Actes 7 v. 27) ». Étienne le rappela plus tard aux conducteurs du peuple juif. La similitude de langage n’est-elle pas frappante ? Le Seigneur utilise presque les mêmes mots que l’homme du milieu de la foule, de sorte qu’on ne peut guère ne pas voir le parallèle. Non, dans les deux cas le peuple n’était pas prêt à recevoir le Sauveur et Libérateur.
À l’époque de cet incident, le Seigneur se voyait déjà rejeté. Ce n’est pas par hasard qu’Il préparait Ses disciples à être persécutés et à être menés devant les synagogues et les magistrats (Luc 12 v. 1 à 12). S’il avait été reçu avec foi par Son peuple terrestre, Il aurait certainement fait ce dont les prophètes avaient parlé : « Et il ne jugera pas d’après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l’ouïe de ses oreilles ; mais il jugera avec justice les misérables, et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre (Ésaïe 11 v. 3 et 4) ». Mais L’ayant rejeté et finalement crucifié, ce peuple perdit sa position de bénédiction. Aussi il ne s’agissait plus d’introduire la justice sur la terre ni de « partager des héritages », mais d’amener des individus à leur juste position devant Dieu, au salut pour tous ceux qui le recevraient par la foi. Pour ceux-là, il y avait maintenant une part meilleure en haut, un héritage céleste.
Selon la loi en Israël, le premier-né avait droit à hériter une double part, mais c’est tout ce qu’il en est dit (Deutéronome 21 v. 15 à 17). On ne sait pas ce qui faisait la difficulté dans le cas présenté au Seigneur. Mais derrière le désir apparemment légitime de cet homme, le Seigneur voyait apparaître à nu l’avarice du cœur humain. Cela L’amène à avertir : « Voyez, et gardez-vous de toute avarice ; car encore que quelqu’un soit riche, sa vie n’est pas dans ses biens (Luc 12 v. 15) ».
L’avarice (ou aussi la cupidité) est un mauvais défaut. En Colossiens 3 v. 5 elle est appelée une « idolâtrie », et celui chez qui elle domine, est un « méchant », et en tant que tel, même s’il est « appelé frère », il doit être mis sous la discipline de l’assemblée (1 Corinthiens 5 v. 11 à 13).
Mais la soif de biens terrestres est plus que seulement un mal : elle est aussi une folie. C’est ce que montre le Seigneur dans la parabole qui suit. Car même quand quelqu’un a tout en surabondance, sa vie n’est pas dans ses biens. Cela veut dire que la vie (comme principe de vie, non pas comme manière de vivre) ne dépend nullement du fait d’être riche ou pauvre. On n’a pas un brin de vie de plus quand on possède beaucoup, ni un brin de vie de moins quand on a peu à soi. Comme la parabole le montre clairement, la possession de la vie dépend seulement et uniquement de Dieu.
Mais cela n’est pas encore tout le message de la parabole. Car quelle folie d’amasser des trésors pour soi sur cette terre, et de ne pas être riche quant à Dieu, riche du point de vue du ciel !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• CULTIVATEUR (le riche) (2) - Le Seigneur Jésus illustre le vrai caractère de l’avarice à l’aide de cette parabole.
L’avertissement du Seigneur contre l’avarice n’a vraisemblablement pas été saisi dans toute sa portée. Aujourd’hui il n’en va pas autrement. Aussi explique-t-Il par une parabole le sérieux et la portée de cette question, comme du reste Il le faisait aussi en d’autres occasions. La parabole suivante est l’illustration et en même temps la pleine vérité de ce qu’Il dit sur l’avarice : « Les champs d’un homme riche avaient beaucoup rapporté (Luc 12 v. 16) ».
Tout ce que le Seigneur peut dire d’abord de l’homme dans Sa parabole, c’est qu’il était riche. Il n’y a pas de honte à être riche. Abraham l’était, mais il était aussi beaucoup plus qu’un « certain homme riche ». Rien ne permet de conclure, dans le récit, qu’il s’agissait de richesses acquises malhonnêtement. Au contraire, l’homme possédait de grandes propriétés rurales dont, selon toute vraisemblance, il avait hérité ou qu’il avait acquises honnêtement.
La description que le Seigneur fait de cet homme n’est pas celle d’un oppresseur qui exploite les pauvres travailleurs ruraux ou les frustre de leur salaire. Non, il s’agit bien plutôt de quelqu’un de correct et d’estimé. Beaucoup pouvaient l’envier, surtout de s’être accru continuellement par le bon revenu de ses terres. La nouvelle récolte était en tout cas tellement bonne que les celliers et les greniers existants ne pouvaient pas la contenir.
Quand le Seigneur Jésus illustre le vrai caractère de l’avarice à l’aide de cette parabole, Il montre ce vice effrayant dans sa forme la moins repoussante. L’« homme » n’est pas dépeint de manière choquante. Même son avarice ne paraît pas détestable en soi, à première vue. Il vit simplement pour les choses de la terre. Ce sont elles, et elles seules, qui remplissent ses pensées, sa vie. C’est tout. N’y en a-t-il pas d’innombrables exemplaires semblables dans le monde aujourd’hui ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• CULTIVATEUR (le riche) (3) - Entendons-nous le moindre remerciement à Dieu pour ces riches bénédictions ?
« Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je, car je n’ai pas où je puisse assembler mes fruits ? Et il dit : Voici ce que je ferai : j’abattrai mes greniers et j’en bâtirai de plus grands, et j’y assemblerai tous mes produits et mes biens ; et je dirai à mon âme : (Mon) âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d’années ; repose-toi, mange, bois, fais grande chère (Luc 12 v. 17 à 19) ».
Ce que l’homme fait maintenant, n’est-ce pas tout à fait raisonnable ? Il s’assied, et réfléchit sur ce qu’il peut entreprendre pour bien mettre à l’abri son blé et ses autres fruits. Mais remarquez bien combien de fois figurent les mots « je », « mon », « mes » dans la conversation que l’homme tient avec lui-même et avec son âme : treize fois en si peu de mots ! Cela ne montre-t-il pas à quel point il était égoïste ? Entendons-nous le moindre remerciement à Dieu pour ces riches bénédictions ? Non, Dieu ne fait pas l’objet de ses considérations. Y penser, ne serait-ce pas du temps perdu ?
Son seul problème, c’est de savoir comment mettre à l’abri son abondante récolte, et comment agir pour ce faire. Mais en réalité il ne pense qu’à multiplier sa richesse. Ses pensées ne vont absolument pas au-delà de ce but et de ce temps. Ce qui vient après ne l’intéresse pas. L’« économe injuste » de Luc 16 se comporte d’ailleurs de manière tout à fait opposée. Il abandonne les avantages présents pour ne pas se trouver à vide le jour où les richesses (le Mammon) viendront à manquer. C’est la direction vers laquelle regarde le vrai croyant qui ne se considère que comme un administrateur de biens terrestres, en route vers les « tabernacles éternels ».
Remplacer de vieux greniers par des neufs, plus grands, est certainement un progrès aux yeux des hommes, et c’est justement de cette manière que le riche cultivateur voit les choses. Combien il est dramatique de se relaxer dans le contentement de soi, et de tout oublier quant au salut de son âme immortelle ! Il peut bien se parler à lui-même, et se féliciter de tous ses biens, et se promettre du repos, de la jouissance, et d’être heureux. L’autosatisfaction ne peut guère être plus manifeste et présomptueuse. Mais peut-on trouver la vraie paix sur un tel chemin, la paix avec Dieu ? Cet homme n’a devant les yeux que des biens matériels et passagers. Il en attend le bonheur. Des millions de gens lui ressemblent en cela. Et n’y a-t-il pas, pour nous croyants, le danger d’être plus ou moins saisi par cet esprit ? Nous ne parlons peut-être pas aussi crûment « à notre âme », mais nos actes ne manifestent-ils pas souvent le même langage ?
Un peintre français a représenté une fois le riche cultivateur dans l’attitude où il était quand il venait de prendre sa décision. L’homme a soigneusement compté son or et son argent, et a posé les sacs les uns à côté des autres. Il s’est ancré dans la tête une certaine somme réservée à d’autres usages. L’argent dont il a besoin pour les nouveaux bâtiments est entassé sur une table. Il est assis, renversé sur le dossier de son fauteuil ; son front plissé trahit ses réflexions, le regard est fixé sur le lointain. Il pense aux nouveaux greniers, et au grand changement qu’ils apporteront ; il voit les beaux bâtiments, il les voit regorger de tout son blé et des autres biens. Avec cela, il se laisse vivre un grand nombre d’années ; mais voilà ! quand on tourne la page, que voit-on ? Le même homme, mais il est mort, les bras croisés sur la poitrine.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• CULTIVATEUR (le riche) (4) - Quand Dieu redemande l’âme à quelqu’un, Il reprend la vie naturelle qu’Il a donnée.
« Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? (Luc 12 v. 20) ». Quoi que l’homme dise à son âme, Dieu la lui redemande, de manière soudaine, inattendue, cette nuit-là. Il n’avait pas compté là-dessus. Dans la multiplication de ses richesses terrestres, il avait oublié Dieu. Il ne découvre son erreur et sa folie que lorsqu’il est trop tard. Il était un insensé, Dieu le dit.
Combien il est sérieux quand ce que Dieu dit contredit entièrement ce que l’homme dit. C’est le cas ici. Quel contraste éclate ici ! Beaucoup d’années… c’était le langage de l’homme. Cette nuit-même… c’est le langage de Dieu. Salomon avertissait déjà : « Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu’un jour enfantera (Proverbes 27 v. 1) ». À l’inverse, cet homme riche considérait que demeurer encore longtemps ici-bas allait de soi. Il avait construit là-dessus tous ses plans. Mais c’était une mauvaise base. Il avait fait tous ses calculs sans tenir compte de la Personne la plus importante. C’est ce que Dieu appelle un insensé. Quelqu’un de mes lecteurs en serait-il un ? Il est encore temps de tirer la leçon de la folie du riche cultivateur.
Quand Dieu redemande l’âme à quelqu’un, Il reprend la vie naturelle qu’Il a donnée. Le sort en est alors jeté pour l’éternité. L’« âme » est la partie responsable de l’homme. Quand elle quitte le corps, elle va dans un autre endroit, ou bien le paradis auprès du Seigneur Jésus, ou bien le Hadès, selon qu’il s’agit d’un croyant ou d’un non croyant (Luc 23 v. 43 ; 16 v. 22 et 23). Il ne peut pas y avoir différence plus grande. C’est la différence entre le ciel et l’enfer. L’âme est immortelle. C’est ce que le Seigneur Jésus souligne par ces paroles : « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l’âme ; mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l’âme et le corps, dans la géhenne (Matthieu 10 v. 28) ». Prétendre qu’avec la mort tout est fini, est un terrible mensonge de Satan, le père du mensonge.
L’âme n’est pas redemandée à l’enfant de Dieu, mais le croyant la recommande au Seigneur quand il déloge, et se confie en Lui en face de la mort (Actes 7 v. 59 ; 2 Timothée 4 v. 18). Par contre, au pécheur qui, sa vie durant, a asservi son âme et subordonné ses besoins aux désirs du corps, à lui l’âme est redemandée. Le riche cultivateur est allé au lit comme toutes les autres nuits, sans autre pensée que celle de ses biens matériels. Et dans la nuit où son âme lui était redemandée, il en a encore été pareil : pas d’autre pensée !
Le Seigneur Jésus fait aussi ressortir la folie de cet homme par les propos qu’il ajoute : « et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? (Luc 12 v. 20) ». Tout son temps, toutes ses pensées, tous ses efforts, toute sa vie même, l’homme les a employées à se préparer des biens pour lui-même. Il s’est fermé à des pensées plus élevées. Et maintenant quand sa vie se termine de manière imprévue, la question est posée : pour qui sera tout cela ? Peut-être que les héritiers se le partageront en riant, peut-être se battront-ils là-dessus, comme les deux frères du v. 13. Eux aussi sont insensés. Est-ce bien pour cela qu’il s’est battu au prix de la perte de sa propre âme qu’il a trompée ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• CULTIVATEUR (le riche) (5) - Le Seigneur fait une application morale du contenu de la parabole pour chacun.
« Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche quant à Dieu (Luc 12 v. 21) ». Avec cette dernière phrase de conclusion, le Seigneur fait une application morale du contenu de la parabole pour chacun. Tous les détails ne s’appliquent pas à tous. Mais il en est ainsi avec celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n’est pas riche quant à Dieu : il est un insensé, et à la fin il n’a rien. Quand nous arriverons à la parabole de « l’économe injuste » de Luc 16 déjà mentionnée, nous trouverons qu’un croyant n’utilise pas ce qu’il possède seulement pour lui-même, mais aussi pour d’autres. Il montre par là qu’il est riche quant à Dieu. Il introduit Dieu aussi dans ces questions-là, et dans un esprit de grâce, il peut remettre à d’autres une partie de ce qu’il possède.
Mais c’est le contraire de ce que fait le riche cultivateur. Ce contraste dans la parabole met donc encore plus en relief sa folie. Il a amassé des trésors « pour lui-même », or la question posée est : « pour qui cela sera-t-il finalement ? » Être riche quant à Dieu signifie avoir la foi, avoir la richesse qui se trouve en Dieu. Le croyant ne se réjouit pas seulement du pardon de ses péchés et de posséder la vie éternelle, mais il est aussi béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ (Éphésiens 1 v. 3). Ici, le Seigneur Jésus ne va naturellement pas encore jusque-là, parce que l’œuvre de la rédemption n’était pas encore accomplie. Pourtant dans ce qui suit, Il parle aux disciples du « petit troupeau », et dit de lui : « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume (Luc 12 v. 32) ». Autant ils sont pauvres quant aux possessions et aux biens terrestres, autant ils sont riches quant à Dieu.
Il est surtout instructif de voir comment, à la suite de la parabole du « riche cultivateur », le Seigneur se sert d’un contraste pour continuer à montrer le chemin meilleur. « Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’ont pas de cellier ni de grenier ; et Dieu les nourrit : combien valez-vous mieux que les oiseaux ! Et qui d’entre vous, par le souci qu’il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très-petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste ? Considérez les lis, comment ils croissent : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n’était pas vêtu comme l’un d’eux (Luc 12 v. 24 à 27) ».
L’homme riche avait pensé devoir amasser beaucoup de biens dans ses greniers pour plusieurs années. Pourtant les corbeaux ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’ont ni celliers, ni greniers. L’homme riche avait travaillé dur, et voulait se mettre au repos. À l’inverse, les lis ne travaillent ni ne filent. Et pourtant Dieu nourrit les corbeaux et habille les lis. De combien plus de soins entourera-t-Il ses enfants ! On peut résumer l’enseignement de la parabole du « riche cultivateur » par les paroles suivantes de la première épître à Timothée :
« Or la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition ; car c’est une racine de toutes sortes de maux que l’amour de l’argent : ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, et poursuis la justice, la piété, la foi, l’amour, la patience, la douceur d’esprit (1 Timothée 6 v. 6 à 11) ».
Si nous avions vu le riche cultivateur et tous ses biens, nous aurions peut-être pensé : « quelle belle propriété possède cet homme ! ». Mais le Seigneur Jésus dit que les gens possédant de pareilles belles possessions n’entrent que difficilement dans le royaume des cieux (Marc 10 v. 23). Déjà dans l’Ancien Testament, il est donné un sérieux avertissement tout à fait en accord avec notre parabole : « Ne crains pas quand un homme s’enrichit, quand la gloire de sa maison s’accroît ; Car, lorsqu’il mourra, il n’emportera rien ; sa gloire ne descendra pas après lui, Quoique pendant sa vie il bénît son âme (et on te louera, si tu te fais du bien), Il s’en ira jusqu’à la génération de ses pères : ils ne verront jamais la lumière (Psaume 49 v. 16 à 19) ». Combien il est important de laisser la Parole de Dieu former nos pensées, et non pas laisser celles-ci être formées par les idées du monde !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• CALEÇONS (de lin) - Ce qui est de la chair est toujours mauvais, mais plus encore que partout ailleurs, dans le service de Dieu.
« Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair (Exode 28 v. 42) ». Il n'est pas possible que ce qui a été jugé devant Dieu dans la mort de Christ paraisse dans son saint service. Cela fut placé devant Lui dans le sacrifice pour le péché (voyez Exode 29 v. 10 à 14) et entièrement consumé. Si nous nous en remettons à ce qui a été fait, posant nos mains sur la tête de la victime comme cela avait lieu littéralement (Exode 29 v. 10), nous sommes tenus de ne plus jamais la laisser paraître dans notre service. Ce qui est de la chair est toujours mauvais, mais plus encore que partout ailleurs, dans le service de Dieu. Que peut-il y avoir de plus terrible dans ce cas que de voir la vanité, la jalousie, les rivalités ou le désir de paraître, admis dans ce qui devrait être le service spirituel ? Toutes ces choses seraient en effet « la nudité de la chair (Exode 28 v. 42) » ; elles ne doivent pas être tolérées.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• CHANDELIER (d’or) - C’est dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière.

Du côté opposé à la « Table des pains de proposition », se trouvait le « Chandelier », fait d'or pur battu (martelé), ayant sept branches et une lampe à chaque branche. C'était la seule lumière dans le « Saint », car, ainsi que nous l'avons vu, la lumière naturelle était obscurcie par les voiles et les courtines et il n'y avait aucune fenêtre. Ses sept lampes étaient nettoyées, arrangées et pourvues d'huile, etc.., par le Souverain Sacrificateur lui-même qui, en même temps, offrait l'encens sur « l'Autel d'or ». Le chandelier est la seule source de lumière dans le lieu saint : le Saint Esprit dans sa plénitude (7 lampes - 7 assemblées d’Asie), type de la plénitude de la lumière du Seigneur dans le sanctuaire ; il dirige le service.
Il est d’une seule pièce ; Le chandelier est un seul chandelier ; et pourtant nous y voyons encore une fois Christ et les siens. Le Saint Esprit met l’accent sur ce fait qu’il y a un seul corps de Christ (la tête et ses membres), que nous sommes uns en Christ, et rendus agréables dans le bien-aimé devant Dieu. « … afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m’as envoyé (Jean 17 v. 21) ». « Car aussi nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul corps… et nous avons tous été abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit (1 Corinthiens 12 v. 13) ». « Mais maintenant les membres sont plusieurs, mais le corps, un (1 Corinthiens 12 v. 20) ».
Il est constitué d’un talent d’« or pur » ; (un talent, près de 45 kg), ce qui exprime l’excellence de la justice divine en qui est la source de la lumière pour éclairer tout service dans le sanctuaire ; c’est un des rares éléments qui fût en or massif ; les autres éléments étaient de bois de Sittim plaqués d’or pur. Il représente la plénitude de la lumière, l’excellence de celui qui en est la source. C’est donc dans la justice divine seulement que se trouve la source de la lumière.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• CLOCHETTES D'OR ET LES GRENADES - Ces deux choses existaient le jour de la Pentecôte.

Les « grenades » et les « clochettes d'or » (Exode 28 v. 33 et 34) qui se trouvent sur les bords de la robe donnent à entendre que tout vrai fruit et tout vrai témoignage doivent être soutenus par le service sacerdotal et la grâce de Christ, et que de plus, ils sont célestes en caractère. Ces paroles : « Elle ne se déchirera pas (Exode 28 v.32) », donnent la pensée d'unité, et l'huile de l'onction descendait sur les grenades et les clochettes d'or. Ces deux choses existaient le jour de la Pentecôte ; des fruits de grâce céleste étaient portés par les saints, et quel son de clochettes d'or se faisait entendre alors ! Tout cela s'effectuait dans la puissance de l'onction, témoin vivant à Christ dans le ciel.
« Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service; et on en entendra le son quand il entrera dans le lieu saint, devant l'Éternel, et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas (Exode 28 v. 35) ». Le son de Christ doit être entendu pendant qu'Il est caché aux yeux des hommes, le son de tout ce qui se rapporte à « Son entrée » et le son de tout ce qui se rapportera à « Sa sortie » (Exode 28 v. 35). Tout cela doit être maintenu en témoignage.
Pensez à l'amour désintéressé qui conduisit tous les croyants à être en un même lieu, ayant toutes choses communes. « Nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui ; mais toutes choses étaient communes entre eux (Actes 4 v. 32) ». L'égoïsme naturel du cœur humain avait été déplacé par l'énergie de l'amour divin. Je crois que nous pouvons voir là les grenades, fruit plein de l'énergie de la vie. Aaron Je ne connais pas de fruit qui soit, plus que la grenade, rempli de graines, plus rempli de puissance productive. Il n'y a rien qui soit aussi énergique et aussi fécond que l'amour divin.
Il nous est dit qu'alors, « les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus; et une grande grâce était sur eux tous (Actes 4 v. 32 et 33) » : Ceci correspond, semble-t-il, aux clochettes d'or. Elles se firent entendre tout d'abord, le jour de la Pentecôte et depuis, elles n'ont pas cessé de rendre leur son. L'évangile est annoncé par le Saint Esprit envoyé du ciel et un témoignage est rendu à tout ce qui est en rapport avec la présence de Christ à la droite de Dieu. Bientôt, « il sortira (Exode 28 v. 35) », pour introduire le monde à venir et à cet égard aussi, le son de Christ se fait entendre.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• COUVERTURES (du tabernacle) - Nous devons suivre notre le Souverain Sacrificateur de notre ordre de sacrificature.
 La première, vue depuis l’intérieur, appelée aussi « tabernacle », est composée de dix tapis de quatre coudées sur vingt-huit, formant un ensemble de quarante coudées sur vingt-huit. Ces tapis sont faits de fin coton retors, de bleu, de pourpre, d’écarlate, avec des chérubins d’ouvrage d’art ; c’est le fin coton qui est mentionné en premier lieu alors que c’est le bleu, pour les rideaux et le voile. Ce tabernacle nous parle de Dieu manifesté en Christ et il peut aussi représenter les croyants tels qu’ils sont vus en Christ, dans le sanctuaire et portant ses caractères, « rendus agréables dans le Bien-aimé (Éphésiens 1 v. 6) ». Ainsi, lorsqu’il s’agit des croyants, c’est avant tout la justice pratique dans leur marche qui doit être remarquée, tandis que pour Christ son caractère céleste est d’abord mis en évidence.
La première, vue depuis l’intérieur, appelée aussi « tabernacle », est composée de dix tapis de quatre coudées sur vingt-huit, formant un ensemble de quarante coudées sur vingt-huit. Ces tapis sont faits de fin coton retors, de bleu, de pourpre, d’écarlate, avec des chérubins d’ouvrage d’art ; c’est le fin coton qui est mentionné en premier lieu alors que c’est le bleu, pour les rideaux et le voile. Ce tabernacle nous parle de Dieu manifesté en Christ et il peut aussi représenter les croyants tels qu’ils sont vus en Christ, dans le sanctuaire et portant ses caractères, « rendus agréables dans le Bien-aimé (Éphésiens 1 v. 6) ». Ainsi, lorsqu’il s’agit des croyants, c’est avant tout la justice pratique dans leur marche qui doit être remarquée, tandis que pour Christ son caractère céleste est d’abord mis en évidence.
Les tapis étaient unis ensemble par des ganses de bleu et des agrafes d’or : les liens qui unissent les rachetés aujourd’hui sont célestes et divins ; ils ne se groupent pas parce que cela leur convient de le faire, ou parce qu’ils se mettent d’accord sur certains points pour se réunir, mais c’est Dieu qui les a unis indissolublement ensemble. En se réunissant simplement autour du Seigneur Jésus, ils rendent témoignage à ce que Dieu a fait.
Dans la pratique, il importe que les croyants manifestent quelle est leur position dans le sanctuaire, reproduisant les caractères de Christ (fin coton, bleu, pourpre et écarlate) et montrant la réalité du fait que Dieu les a unis ensemble. En Christ et pour Dieu, ils sont un, comme l’ensemble des tapis joints l’un à l’autre par des agrafes d’or formait « un seul tabernacle (Exode 26 v. 6) ».
Les chérubins tissés dans cette couverture ont une signification particulière. Lorsque Moïse, Aaron et ses fils entraient dans le sanctuaire et levaient les yeux, ils voyaient ces reproductions d’êtres célestes. Il n’est pas difficile de saisir que ces figures de chérubins, en rapport avec l’assemblée, expriment une intention divine, comme il est écrit en Éphésiens 3, versets 10 et 11, « que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l’assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur ». Nous faisons bien de garder toujours ce fait devant nos yeux. Il en résultera que nous nous conduirons d’une manière convenable et selon Dieu dans sa Maison. Les anges nous observent en permanence.
La deuxième couverture est en poil de chèvre et s’appelle une « tente ». Elle est composée de onze tapis mesurant chacun quatre coudées sur trente. Cette tente de dimension plus grande que le « tabernacle » était étendue par-dessus celui-ci et faisait parfaitement protection. Le poil de chèvre parle de la séparation pour Dieu (vêtement des prophètes), non par sévérité envers les pécheurs, mais la séparation d’avec les pécheurs dans la sévérité envers soi-même, qui peut s’allier avec l’affabilité et la débonnaireté les plus parfaites, telles qu’elles ont été vues en Christ.
Il ne peut y avoir réalisation des caractères de Christ sans séparation du monde. Les femmes avaient filé le poil de chèvre (Exode 35 v. 26) : chaque croyant, même le plus humble, est appelé à réaliser pratiquement cette séparation du monde, dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans son comportement. Les tapis de la tente étaient joints par des ganses et des agrafes d’airain, image de l’unité des croyants dans la séparation et le jugement du mal.
La troisième couverture est faite de peaux de béliers teintes en rouge. Le bélier était la victime sacrifiée lors de la consécration des sacrificateurs (Exode 29 v. 19 v. à 22 ; Lévitique 8 v. 22). Cette couverture rappelle la consécration complète de Christ à Dieu pour les rachetés et qui l’a conduit jusqu’à la mort (teinte en rouge) : 2 Corinthiens 5 v. 15 ; Éphésiens 5 v. 2. Cette consécration produit dans le cœur des rachetés le dévouement au Seigneur, à ses intérêts, à sa maison.
La quatrième couverture faite de peaux de taissons, était la seule que l’on voyait de l’extérieur. Pour voir les tapis et les broderies, l’or des ais et les divers objets du lieu saint et du lieu très saint, il fallait pénétrer dans le sanctuaire. De l’extérieur on voyait seulement cette couverture de peu d’apparence. Tel fut le Christ dans ce monde : « il n’y avait point d’apparence en lui pour nous le faire désirer (Ésaïe 53 v. 2) ». Pour découvrir ses gloires variées, il faut la foi qui discerne en Lui le Fils de Dieu. Les peaux de taissons nous parlent aussi de la sainte vigilance indispensable requise pour éviter les pièges et faire échouer les attaques de l’ennemi (le taisson est caractérisé par sa vigilance) (*).
(*)NDLR - d’après Ézéchiel 16 v. 10 nous pensons plutôt que les peaux de taissons est ce qui préserve l’enfant de Dieu dans sa marche, contre tout ce qui le souillerait ou lui porterait atteinte.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• CUVE (d'airain) - La confession et la purification.
 En dedans de la porte, et immédiatement en face d'elle, se trouvait « l'Autel d'airain ». Cet autel était en bois, recouvert de cuivre, et avait 5 coudées carrées et 3 coudées de haut. Divers ustensiles appartenaient à son service : « vases à feu », (appelés encensoirs), pour transporter le feu à « l'Autel des parfums », bassins (pour recevoir le sang), fourchettes, pelles, etc. Ensuite, entre « l'Autel d'airain » et la porte du Tabernacle, était la « Cuve ». Elle était faite de cuivre poli et contenait de l'eau ; les sacrificateurs s'y lavaient avant d'entrer dans le Tabernacle.
En dedans de la porte, et immédiatement en face d'elle, se trouvait « l'Autel d'airain ». Cet autel était en bois, recouvert de cuivre, et avait 5 coudées carrées et 3 coudées de haut. Divers ustensiles appartenaient à son service : « vases à feu », (appelés encensoirs), pour transporter le feu à « l'Autel des parfums », bassins (pour recevoir le sang), fourchettes, pelles, etc. Ensuite, entre « l'Autel d'airain » et la porte du Tabernacle, était la « Cuve ». Elle était faite de cuivre poli et contenait de l'eau ; les sacrificateurs s'y lavaient avant d'entrer dans le Tabernacle.
Le lavage à la cuve d’airain est répétitif ; c’est la purification pratique et journalière de notre marche dans le désert. Pourquoi fallait-il se laver les pieds et les mains ? Parce qu’il fallait purifier les pieds dans la marche au désert, et les mains pour accomplir le service dans le sanctuaire. Dans l’économie actuelle de la grâce, nous n’avons plus à accomplir un service matériel, parce que notre adoration est en esprit et en vérité.
Mais nous marchons toujours sur la terre où nous sommes en contact avec la souillure. Lorsque le Seigneur a lavé les pieds des disciples, Pierre n’a pas compris le sens de ce lavage des pieds et a demandé au Seigneur de lui laver aussi les mains et la tête (Jean 13 v. 9). Alors le Seigneur lui a répondu : « Celui qui a tout le corps lavé, n’a besoin que de se laver les pieds ; car il est tout net ; et vous vous êtes nets ». Il ne s’agissait pas du lavage initial, d’être né de nouveau, d’avoir une position EN lui par la conversion, mais d’avoir une part AVEC lui. Pour être en communion avec lui, il est nécessaire d’être purifié des souillures que nous contractons dans le chemin, et des fautes que nous commettons encore. Notre communion est fragile mais notre position en lui est assurée.
Nécessairement, le croyant doit s’arrêter à la cuve d’airain, pour confesser ses manquements. « Que chacun s’éprouve soi-même (1 Corinthiens 11 v. 28) ». Ce qui nous fera ressentir le besoin de la cuve, c’est d’être passé à l’autel d’airain. Étant rachetés par la valeur du sacrifice de Christ, nous ne tardons pas à constater que la chair est encore en nous. Bien qu’il y ait en nous le nouvel homme qui ne pêche pas, grâces à Dieu, nous avons encore le support de notre être physique, humain, qui appartient encore à l’ancienne création, qui constitue la chair en nous, comme un fardeau que nous porterons jusqu’aux derniers pas de notre pèlerinage. Nous avons des défaillances, nous commettons même des péchés, et nous ne pouvons jamais crier victoire sur la chair ; c’est la raison pour laquelle le lavage à la cuve nous est constamment nécessaire. Que chacun s’éprouve soi-même et qu’il mange ; il n’est pas dit que chacun s’arrête à la cuve et n’aille pas plus loin. Après sa purification à la cuve d’airain, le sacrificateur est appelé à franchir la porte du sanctuaire.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
D
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• DAVID - Cet homme était véritablement un bien-aimé de Dieu.
Le nom de David signifie « bien-aimé », et cet homme était véritablement un bien-aimé de Dieu. Il appartenait à la tribu de Juda ; et Jacob avait déjà prophétisé que de lui sortirait Shilo, le prince (Genèse 49 v. 10). David fut le premier roi d’Israël selon le plaisir de Dieu : « selon son cœur (1 Samuel 13 v. 14) », après que le peuple eut obtenu en Saül un roi selon sa propre volonté. Après avoir été oint comme roi par Samuel (1 Samuel 16), David a dû toutefois endurer plusieurs années de persécution avant de pouvoir monter sur le trône d’Israël. Il est ainsi un type de Christ rejeté, mais finalement victorieux. Le fait que trois prophètes appellent le Messie promis « David » en est la confirmation (Jérémie 30 v. 9 ; Ézéchiel 34 v. 23 ; Osée 3 v. 5). Au premier verset du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus est déjà désigné comme le Fils de David (Matthieu 1 v. 1). Il est cependant non seulement le Fils de David comme homme, mais également le Seigneur de David comme le Dieu éternel, et aussi bien la racine (l’origine) que la postérité (le descendant) de David (Matthieu 22 v. 43 ; Actes 22 v. 16).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DÉLUGE - Le déluge est une figure des jugements à venir de Dieu sur la terre.
Le déluge, décrit en Genèse 6 à 8, venu sur toute la terre, était un châtiment de Dieu sur l’humanité de l’époque, dont les pensées et les aspirations n’étaient que méchanceté en tout temps, comme elles le sont aujourd’hui encore. Seul Noé, qui est appelé juste et parfait, a échappé au jugement, avec sa famille, dans l’arche. Tandis qu’Hénoc, son arrière-grand-père, a été enlevé avant le déluge, Noé et les siens, dans l’arche, ont traversé le jugement, puis ont vécu sur une terre purifiée.
Le déluge est une figure des jugements à venir de Dieu sur la terre ; les croyants du temps actuel seront enlevés de devant eux, mais le résidu croyant les traversera, pour être ensuite introduit dans le Millénium sous le règne du Messie. Le Seigneur Jésus compare le temps avant le déluge au temps qui précédera son apparition : « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l’homme. Car comme dans les jours avant le déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, et ils ne connurent rien, jusqu’à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l’homme (Matthieu 24 v. 37 à 39) ». Le passage parallèle de Luc 17 v. 30 où il est dit : « Il en sera de même au jour où le Fils de l’homme sera manifesté », établit que par la « venue du Fils de l’homme », il faut entendre non pas l’enlèvement des croyants, mais l’apparition ou la manifestation de Christ en gloire. Pierre également nous rappelle que l’annonce du déluge était aussi peu prise au sérieux par les hommes de cette époque que ne l’est aujourd’hui celle du jugement qui vient (2 Pierre 2 v. 4 à 11 ; 3 v. 4 à 7).
En 1 Pierre 3 v. 20 et 21, le déluge est vu en revanche comme figure de la condamnation éternelle de laquelle nous sommes sauvés par l’« antitype » du baptême. Ce qui nous sauve pour l’éternité, c’est la foi et non pas certes le baptême ; il est cependant un type de notre identification avec le Christ mort et enseveli pour nous. Quant à notre position sur la terre, nous sommes ainsi du côté du Sauveur; et nous sommes dès lors sauvés (Marc 16 v. 16 ; Romains 6 v. 3 à 6 ; cf. Actes 2 v. 40 et 41).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DENT - Figure de la puissance et de la cruauté de l’ennemi.
Les dents des animaux carnassiers font peur en raison de leur grosseur et de leur danger (Deutéronome 32 v. 24) ; elles sont parfois employées dans la Bible comme figure de la puissance et de la cruauté de l’ennemi (Job 16 v. 9 ; Psaume 57 v. 4 ; Joël 1 v. 6). En conséquence, le brisement des dents signifie l’assujettissement et la privation de pouvoir (Psaume 3 v. 7 ; 58 v. 6).
Dans l’Ancien Testament, le grincement des dents est l’expression de la fureur de l’agresseur (Psaume 35 v. 16 ; Lamentations 2 v. 16) et, dans le Nouveau Testament, une caractéristique de ceux qui subiront la condamnation éternelle (Matthieu 8 v. 12).
On est souvent tenté de considérer, d’une manière unilatérale et simplifiée, que le principe de vengeance (lex talionis), propre à l’Ancien Testament, « vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent… (Exode 21 v. 24) », caractérise la loi mosaïque. On oublie alors facilement que la loi de Sinaï contenait des ordonnances cérémonielles (par ex. relatives aux sacrifices), des commandements moraux et des règles légales pour la vie communautaire. L’ordonnance ci-dessus appartient à ce dernier groupe ; elle est une disposition pénale pour les juges (cf. Exode 21 v. 22 ; Deutéronome 19 v. 18). Il n’était pas permis à l’Israélite de se venger personnellement (Lévitique 19 v. 18). Cependant le Seigneur Jésus oppose à ce principe de la vengeance légitime le commandement de surmonter le mal par le bien : « Vous avez ouï qu’il a été dit : « œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis : Ne résistez pas au mal ; mais si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre… (Matthieu 5 v. 38 et 39) ». C’est la grâce.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DÉSERT - Le désert est une figure des circonstances terrestres.
Les régions montagneuses, pauvres en eau et en végétation, inhospitalières, situées au sud du pays d’Israël, sont une figure de la solitude, des privations et des difficultés, parfois aussi de l’éloignement de Dieu. Géographiquement, le pays du désert (hébreu negev) confine au sud à l’Égypte. Plus on s’éloigne du centre de la bénédiction, plus le désert devient brûlant et aride, jusqu’à ce que finalement la frontière vers le monde soit franchie (cf. Genèse 12 v. 9 et suiv.).
Les quarante ans pendant lesquels le peuple d’Israël a marché dans le désert, d’Égypte jusqu’en Canaan, ne faisaient pas partie des conseils de Dieu envers son peuple, mais ont servi à l’humilier et à l’éprouver (Deutéronome 8). Le peuple aurait pu effectuer cette marche en quelques semaines (Deutéronome 1 v. 2). Mais en raison de l’incrédulité de dix d’entre les douze espions et du peuple, tous ont dû errer 40 ans dans le désert, jusqu’à ce que ceux qui étaient sortis d’Égypte soient morts, à l’exception de Josué et Caleb (Nombres 13 ; 14). En 1 Corinthiens 10 v. 1 à 11, la marche d’Israël dans le désert et les événements qui s’y rattachent sont désignés comme étant des types donnés pour nous servir d’avertissement. Le désert est une figure des circonstances terrestres qui sont la part du croyant sur son chemin vers la gloire. Toutefois, de même que Dieu a pris soin de son peuple terrestre en lui donnant la manne du ciel et l’eau du rocher, de même il fait maintenant tout ce qui contribue au bien de ses enfants, comme il est dit en Romains 8 v. 28 : « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DEUX - Un seul témoin n’a aucune force et ne constitue aucune preuve.
Deux est le chiffre de l’attestation et du témoignage suffisant : « Sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins, la chose sera établie » (Deutéronome 19 v. 15 ; Matthieu 18 v. 16 ; 2 Corinthiens 13 v. 1 ; 1 Timothée 5 v. 19). Un seul témoin n’a aucune force et ne constitue aucune preuve (Nombres 35 v. 30 ; Deutéronome 17 v. 6).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DIX - Expression de l’entière responsabilité de l’homme envers Dieu.
Le nombre dix est le résultat de deux fois cinq et doit être considéré comme l’expression de l’entière responsabilité de l’homme envers Dieu. Nous avons dix doigts aux mains (« l’action ») et dix orteils aux pieds (« la marche »). Dieu a donné au peuple d’Israël dix commandements, dans lesquels la pleine mesure de la responsabilité de l’homme devant Dieu est exprimée (Exode 20). Les Israélites étaient tenus d’apporter le dix pour cent de leur revenu (la « dîme ») comme offrande continuelle à Dieu (Lévitique 27 v. 30). Dans une parabole en Matthieu 25 v. 1, il est parlé de dix vierges, et en Luc 19 v. 13, dix mines sont confiées à dix esclaves. Ce sont là aussi des allusions claires à la responsabilité.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DOUZE - Nombre du gouvernement et de l’administration de Dieu sur la terre.
Douze (trois fois quatre) est le nombre du gouvernement et de l’administration de Dieu sur la terre. Israël, le peuple terrestre de Dieu, se composait de douze tribus que des hommes fidèles ont continué de reconnaître longtemps après la division du peuple en deux royaumes et, finalement, sa dispersion (Exode 24 v. 4 ; 1 Rois 18 v. 31 ; Esdras 6 v. 7 ; 8 v. 35 ; Actes 26 v. 7 ; Jacques 1 v. 1). Le Seigneur Jésus s’est choisi d’entre ses disciples douze apôtres (Luc 6 v. 13 et suiv.) qui plus tard posèrent, avec l’apôtre Paul, le fondement de l’Assemblée (1 Corinthiens 3 v. 10 ; Éphésiens 2 v. 20). L’appellation « les douze » était une expression employée pour désigner les apôtres, même lorsque le traître Juda n’en faisait plus partie et que son successeur Matthias n’était pas encore choisi (Jean 20 v. 24 ; 1 Corinthiens 15 v. 5). La nouvelle Jérusalem porte les noms des douze fils d’Israël sur ses portes et les noms des douze apôtres de l’Agneau sur ses fondements (Apocalypse 21 v. 12 à 14). La ville mesure 12 000 stades, et sa muraille 144 (= 12 x 12) coudées (Apocalypse 21 v. 16 et 17). L’arbre de vie, un type de Christ comme source de vie et de bénédiction, portera douze fruits (Apocalypse 22 v. 2).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DRAGON - Le grand dragon… le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan.
Le nom de l’être hétérogène surhumain, qui apparaît dans les légendes de plusieurs peuples, crachant le feu, ailé, tenant du serpent et dont le caractère est opposé à Dieu et ennemi de l’homme, est traduit de l’hébreu tannin (Deutéronome 32 v. 33 ; Néhémie 2 v. 13) et nachasch (Job 26 v. 13), ainsi que du grec drakôn (duquel aussi provient le mot dragon). Le mot hébreu tannin, qui signifie « celui qui est allongé », est aussi traduit par « monstre marin » (par ex. Genèse 1 v. 21 ; en Ézéchiel 29 v. 3 et 32 v. 2 : tannim) et par « serpent » (Exode 7 v. 9), sans qu’il soit possible de déterminer clairement de quel animal il est question. Alors que dans l’Ancien Testament des puissances humaines sont souvent nommées tannim ou tannin (Nebucadretsar en Jérémie 51 v. 34 et le Pharaon en Ézéchiel 32 v. 2), dans le Nouveau Testament, où le mot dragon n’apparaît que dans l’Apocalypse, il s’agit toujours du diable ou de Satan.
En Apocalypse 12 v. 3, il est décrit comme étant roux, ce qui fait certes allusion au sang de ses nombreuses victimes. En Apocalypse 12 v. 9, il est désigné comme « le grand dragon… le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan » qui, au milieu de la dernière semaine d’années précédant le règne millénaire, est précipité du ciel sur la terre comme un ennemi vaincu. Il soutiendra en tant qu’instigateur l’Empire romain, aussi les hommes lui rendront-ils hommage (Apocalypse 13 v. 2 à 4). Il sera lié pendant le règne millénaire de Christ (Apocalypse 20 v. 2), puis sera encore une fois délié, pour recevoir enfin son jugement éternel dans l’étang de feu et de soufre qui est préparé pour lui et ses anges (Apocalypse 20 v. 7 à 10 ; Matthieu 25 v. 41). L’annonce de Dieu après la chute de l’homme trouvera alors son accomplissement (Genèse 3 v. 15).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• DROIT DE RACHAT - Jésus accomplit les devoirs de celui qui a le droit de rachat.
Selon la loi mosaïque, celui qui avait le droit de rachat (hébreu go’el) était un des plus proches parents masculins d’un Israélite, et il avait diverses obligations morales. Il pouvait :
1. racheter un Israélite vendu comme esclave (Lévitique 25 v. 47 à 49),
2. racheter la possession d’un Israélite devenu pauvre (Lévitique 25 v. 25),
3. susciter une descendance à son frère mort sans laisser d’enfant, en épousant sa veuve (Deutéronome 25 v. 5 ; Ruth 2 v. 20 ; 3, 9, 13 ; 4 v. 1 à 6),
4. comme « vengeur du sang », exercer le jugement sur un meurtrier (Nombres 35 v. 19).
Le Seigneur Jésus est le vrai Libérateur. Il est devenu homme comme nous (Hébreu 2 v. 14 ; 4 v. 15) afin de pouvoir accomplir les devoirs de celui qui a le droit de rachat : nous délivrer de la servitude du diable (Hébreu 2 v. 15), nous acquérir l’héritage (Éphésiens 1 v. 11 à 14) et nous donner la vie éternelle (Jean 1 v. 12 et 13). Mais un jour il sera aussi le juste Juge pour tous ceux qui ne seront pas venus à lui par la foi (Jean 5 v. 27). Dans le livre de Ruth, celui qui avait le droit de rachat mais ne pouvait pas racheter la jeune femme est une figure de la loi du Sinaï qui ne peut sauver aucun homme ; Boaz, en revanche, est non seulement un des ancêtres terrestres, mais aussi un type du Seigneur Jésus.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• DRACHME (perdue) (1) - Les deux paraboles ont le même sujet principal : les pécheurs comme objets de la grâce de Dieu qui les cherche.
La parabole de la drachme perdue est un complément à la parabole précédente de la brebis perdue, mais elle comporte des traits qui lui sont propres. « Ou quelle est la femme, qui, ayant dix drachmes, si elle perd une drachme, n’allume la lampe et ne balaye la maison, et ne cherche diligemment jusqu’à ce qu’elle l’ait trouvée ? et l’ayant trouvée, elle assemble les amies et les voisines, disant : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé la drachme que j’avais perdue. Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent (Luc 15 v. 8 à 10) ».
Cette parabole est tirée de la vie à la maison. Il ne s’agit pas ici d’un berger qui part à la recherche d’une brebis perdue, mais d’une femme qui a perdu une drachme sur les dix qu’elle avait, et qui se met alors à la chercher. Elle allume une lampe, balaye la maison et cherche diligemment jusqu’à ce qu’elle la trouve. Tout cela est tout à fait naturel. Pourtant, quelle peine, quelle application pour trouver une pièce d’argent ! Si le berger se donne autant de peine pour la brebis perdue, si la femme se donne autant de peine pour une pièce de monnaie perdue, est-il étonnant que le Seigneur et Sauveur s’occupe de pécheurs, de créatures immortelles dont la valeur dépasse de beaucoup celle d’une brebis ou d’une drachme ?
Je pense que c’est là l’enseignement simple de ces deux paraboles, un enseignement que même les pharisiens et les scribes devaient comprendre. Par contre, il est certain que certaines subtilités que le Seigneur y a insérées devaient leur rester cachées (comparer Matthieu 13 v. 10 à 15). Elles ne peuvent être reconnues que dans la puissance du Saint Esprit et que par les Siens.
Différences.
Les deux paraboles ont le même sujet principal : les pécheurs comme objets de la grâce de Dieu qui les cherche. Mais quand on en vient aux détails, on voit des différences qui ne sont certes pas sans importance. On trouvera plutôt que nous avons besoin des deux paraboles pour avoir une vue complète de cet objet grandiose. On pourrait même interpréter les deux tableaux des dix premiers versets comme ne formant qu’une parabole. Le premier tableau est rattaché directement au second par le simple mot « ou » du verset 8 (« Ou quelle est la femme… »), et cela parlerait en faveur de ce point de vue de ne voir qu’une parabole dans les deux tableaux. Il manque ici de façon très nette une introduction formelle du genre de celle qu’on a avec la troisième parabole au verset 11 (« Et il dit… »). Mais comme nous pouvons le voir les deux premiers tableaux ou paraboles vont bien de pair, et même de façon particulièrement étroite. Voyons maintenant quelques différences.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• DRACHME (perdue) (2) - Le Seigneur montre pas par là deux caractéristiques essentielles du pécheur.
Dans le premier tableau, il s’agit d’une brebis vivante, qui est perdue. Maintenant dans le deuxième, ce qui est perdu est une pièce de monnaie morte. Le Seigneur ne montre-t-Il pas par là deux caractéristiques essentielles du pécheur ? Comme la brebis s’en va de son propre mouvement loin du troupeau et de son berger, et se met dans une situation sans espoir, ainsi le pécheur s’est éloigné de Dieu par sa propre faute, et vit maintenant dans ses péchés « sans Dieu dans le monde » (Éphésiens 2 v. 12). C’est la vision que nous en donne particulièrement l’épître aux Romains. Il a une certaine vie, la vie naturelle, mais cette vie est utilisée à pécher. Il ne s’enquiert pas de Dieu, ni de Sa volonté, il ne cherche pas Dieu, il ne L’honore pas, il n’a pas de crainte de Dieu. Aussi est-il tombé sous le jugement de Dieu et il n’atteint pas à la gloire de Dieu (Romains 3). C’est en fait une situation sans espoir, pour autant que cela dépende de nous !
Mais la pièce de monnaie est morte, poussiéreuse, dans l’obscurité. C’est aussi une image de l’état du pécheur, selon la vision qu’en donne l’épître aux Éphésiens. Couvert de la poussière du péché, il est par nature mort dans ses fautes et dans ses péchés (Éphésiens 2 v. 12). Non seulement il s’est égaré, mais bien que physiquement vivant, il est mort spirituellement, mort pour Dieu, et par conséquent absolument sans force pour venir à Dieu. Et comme la drachme perdue gisait cachée quelque part dans les ténèbres, ainsi le pécheur se trouve dans les ténèbres spirituelles, c’est-à-dire qu’il est dans l’ignorance de Dieu : « ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l’ignorance qui est en eux (Éphésiens 4 v. 18) ».
Ce sont aussi deux états que l’Écriture nous montre à propos des pécheurs : vivant dans le péché, et morts dans les péchés. Par le premier, l’homme se rend coupable devant Dieu, tandis que le second état est fondamentalement son état devant Dieu. Ces caractéristiques sont d’ailleurs le propre de tous les hommes selon la nature, non pas seulement de certains « spécimen » particulièrement mauvais, comme on l’admet souvent.
Dans la parabole du « fils perdu » (prodigue), les deux côtés seront joints. Le plus jeune fils vivait dans le péché (Luc 15 v. 13) et était mort pour le père (Luc 15 v. 24). On ne peut pas s’empêcher de s’émerveiller devant la sagesse et la profondeur qui se trouvent dans ces paroles du Seigneur Jésus qui paraissent si simples.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• DRACHME (perdue) (3) - La femme est utilisée comme une image de l’assemblée de Dieu.
Dans le premier tableau c’est l’activité de la grâce divine qui nous était présenté avec le berger. Nous avons reconnu facilement la Personne et l’œuvre de notre Seigneur, le Fils de Dieu. Maintenant c’est une femme qui déploie une vive activité pour trouver ce qui est perdu. Or à plusieurs reprises dans l’Écriture Sainte, la femme est utilisée comme une image de l’assemblée de Dieu. Dans cette assemblée le Saint Esprit habite et agit, et Il agit par elle.
Elle est en même temps l’instrument, l’outil du Saint Esprit pour ce qu’Il veut opérer dans les hommes. Or quoi que ce soit qui soit opéré par elle, tout a proprement sa source en Dieu seul, le Saint Esprit. Et ainsi sous l’image de la « femme » dans cette parabole, le Seigneur Jésus semble ramener toute activité à cette Personne de la Déité, le Saint Esprit, et même ne s’en tenir qu’à Lui. Si nous voyons les choses ainsi, quelle image impressionnante se déploie sous nos yeux ! L’Esprit de Dieu prend une grande peine à trouver le pécheur perdu. En premier lieu, par le moyen de la « lampe », par le moyen de la Parole de Dieu, Il apporte la lumière au milieu des ténèbres de ce monde, au milieu des ténèbres de l’âme. Il applique la Parole au cœur et à la conscience des hommes, pour faire naître une nouvelle vie. Personne ne peut être né de nouveau autrement que justement de cette manière : « d’eau et d’esprit (Jean 3 v. 5) ».
Le diable met beaucoup d’obstacles sur le chemin des hommes, pour les empêcher de saisir le salut. Sous la figure de ce « balayage de la maison », le Seigneur n’indique-t-Il pas que le Saint Esprit peut justement éliminer ces innombrables obstacles ? Ce deuxième côté de l’activité de l’Esprit de Dieu est plein de consolation. La femme avait perdu la pièce de monnaie, et parce qu’elle lui était précieuse, elle allume la lumière, balaye la maison et cherche l’argent diligemment, aussi longtemps qu’il est nécessaire pour le trouver. Aujourd’hui aussi, l’amour de Dieu est actif par le Saint Esprit pour se donner la peine de chercher par la vérité ce qui est perdu. Quel travail cela représente, de ramener le cœur de l’homme à Dieu !
Dans cette parabole le Seigneur montre aussi que les sentiments au ciel sont la joie, des sentiments auxquels participent les rachetés. Nous l’avons déjà vu. Mais tandis que dans la première parabole notre communion est avec le Fils, dans la deuxième parabole la communion est celle du Saint Esprit. C’est la troisième parabole qui montre que nous avons aussi communion avec le Père. Quel privilège d’être apte à la communion avec les trois Personnes de la Déité, de participer aux sentiments, à la joie de Dieu !
On est aussi frappé de ce que le Seigneur s’exprime un peu différemment de la première parabole au sujet de la joie. Dans la première il est dit : « Ainsi il y aura de la joie au ciel… » ; dans la deuxième : « Ainsi, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu… ». Dans la première parabole, nous avions compris que les anges de Dieu qui demeurent au ciel se réjouissent de ce qu’un seul pécheur vient à la repentance. Mais maintenant il est question de joie « devant les anges de Dieu » ; cela semble signifier que le Seigneur Jésus n’a pas seulement en vue en général la joie des anges, mais spécialement la joie de Dieu Lui-même, à laquelle les anges participent.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• DISCIPLE (les conditions) (1) - Pour être ses disciples, nous devons marcher comme Christ a marché ; nous devons porter les fruits de la ressemblance à Christ.
Cet opuscule a pour objet d’exposer quelques-uns des principes qui déterminent le statut de celui qui se veut disciple de Jésus-Christ selon le Nouveau Testament.
Le christianisme authentique consiste à s’en remettre entièrement et en toute chose au Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur n’est pas à la recherche d’hommes et de femmes disposés à Lui consacrer quelques-unes de leurs soirées, ou leurs week-ends, ou leurs dernières années lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de la retraite. Ce qu’il veut, ce sont des gens prêts à Lui donner la première place dans leur vie.
« Il cherche aujourd’hui, comme il l’a toujours fait d’ailleurs, non pas à être suivi par des foules qui se contentent de dériver dans son sillage, mais des individus, hommes et femmes, dont la fidélité inaltérable témoignera du fait que ce qu’il veut ce sont des gens disposés à marcher dans le chemin de la renonciation à soi-même sur lequel il les a précédés ».
— Evan H. Hopkins
Seule une consécration totale peut être considérée comme une réponse suffisante au sacrifice de Jésus au Calvaire. Un amour aussi grand que le sien exige en retour le don de notre âme, de notre vie et de tout ce que nous sommes. Le Seigneur Jésus a adressé de très rudes injonctions à ceux qui voudraient être ses disciples, injonctions qui ne sont plus guère prises en considération de nos jours où la vie est devenue si facile. Nous avons pris l’habitude de voir dans le christianisme un moyen d’échapper à l’enfer et d’entrer à coup sûr dans le ciel. En dehors de cela, nous avons l’impression que nous avons parfaitement le droit de jouir au maximum de ce que cette vie peut avoir à nous offrir. Nous savons bien qu’il existe des versets impérieux dans la Bible concernant la vie du disciple, mais nous éprouvons des difficultés à les faire cadrer avec l’idée que nous nous faisons du christianisme.
Nous trouvons normal que des soldats donnent leur vie pour des raisons patriotiques. Nous ne trouvons pas étrange que des communistes meurent pour des motifs politiques. Mais que « le sang, la sueur et les larmes » doivent marquer la vie de l’homme qui fait profession de suivre le Christ, c’est plus que nous ne pouvons admettre. Et pourtant, les paroles du Seigneur Jésus sont suffisamment éloquentes. Elles ne peuvent prêter à confusion si nous sommes prêts à les accepter comme elles ont été dites. Voici donc les conditions posées par le Sauveur du monde pour quiconque veut devenir son disciple.
Aimer Jésus-Christ par-dessus tout.
« Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple (Luc 14 v. 26) ». Ceci ne signifie nullement que nous devions avoir des sentiments d’animosité envers les membres de notre famille ; cela veut dire que notre amour pour Christ devrait être si grand que toutes les autres affections, en comparaison, pourraient sembler être de la haine. Quant à l’expression « et même sa propre vie », elle est certainement la proposition la plus difficile à accepter. L’amour de soi est en effet un des principaux obstacles à la capacité de vivre en disciple. Ce n’est que lorsque nous sommes prêts à mourir pour Christ que nous sommes dans les dispositions où il veut que nous soyons.
Renoncer à soi-même.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même… (Matthieu 16 v. 24) ». Renoncer à soi-même ce n’est pas du tout la même chose que s’imposer des renoncements, par exemple renoncer à certains aliments, à certains plaisirs, à certaines acquisitions. Renoncer à moi-même signifie me soumettre si complètement à la seigneurie de Christ que le moi n’a plus aucun droit ni aucune autorité. Cela signifie que le moi accepte de descendre de son trône. Henry Martyn a exprimé cette disposition par ces paroles : « Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m’arriver de l’extérieur, mais comme consistant entièrement dans l’accomplissement de ta volonté ! »
Choisir délibérément la croix.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix… (Matthieu 16 v. 24) ». La croix dont il est question n’est pas quelque infirmité du corps ou tension de l’esprit, incommodités communes à tout le genre humain. La croix est un sentier sur lequel on a choisi de marcher. « C’est un sentier qui, aux yeux du monde actuel, est déshonorant, méprisable ! » C.A. Coates. La croix symbolise, en effet, la honte, la persécution et les outrages que le monde a amassés sur le Fils de Dieu et qu’il ne manque pas d’entasser sur tous ceux qui veulent faire face à la marée. Il est toujours possible au croyant d’échapper à la croix. Il lui suffit de se conformer au monde et de suivre ses voies.
Passer sa vie à suivre Christ.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive (Matthieu 16 v. 24) ». Pour comprendre ce que cela signifie, il suffit de se poser la question : Qu’est-ce qui a caractérisé la vie du Seigneur Jésus ? Ce fut une vie d’obéissance à la volonté de Dieu. Ce fut une vie vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Ce fut une vie de service désintéressé pour les autres. Ce fut une vie de patience et d’endurance devant les plus graves injustices. Ce fut une vie de zèle, de don de soi, de tempérance, de douceur, de bonté, de fidélité et de piété (Galates 5 v. 22 et 23). Pour être ses disciples, nous devons marcher comme Il a Lui-même marché. Nous devons porter les fruits de la ressemblance à Christ (Jean 15 v. 8).
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (les conditions) (2) - Pour être ses disciples, nous devons marcher comme Christ a marché ; nous devons porter les fruits de la ressemblance à Christ.
Aimer ardemment tous ceux qui appartiennent à Christ.
« À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres (Jean 13 v. 35) ». Cet amour-là, est celui qui considère les autres comme meilleurs que soi-même. C’est l’amour qui couvre une multitude de péchés. Cet amour est patient, plein de bonté, point envieux. Il ne se vante point, ne s’enfle point d’orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche point son propre intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout (1 Corinthiens 13 v. 4 à 7). Sans cet amour, la vie du disciple ne serait qu’une ascèse rigide et froide.
Persévérer sans défaillance dans sa Parole.
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples (Jean 8 v. 31) ». Pour être réellement un disciple, il faut de la persévérance. Il est facile de prendre un bon départ, de se lancer auréolé de gloire. Mais le seul critère du vrai disciple, c’est la persévérance jusqu’à la fin : « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu (Luc 9 v. 62) ». Obéir aux Écritures d’une façon épisodique, intermittente, ne suffit pas. Christ veut des hommes qui désirent Le suivre dans une attitude d’obéissance permanente et sans réplique.
« Garde-moi de retourner en arrière ; les poignées de ma charrue sont mouillées de larmes, la rouille en a rongé les socs. et pourtant, pourtant. Mon Dieu ! Ô mon Dieu ! Garde-moi de retourner en arrière »
Renoncer à tout pour Le suivre.
« Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple (Luc 14 v. 33) ». C’est peut-être la plus déplaisante de toutes les conditions mises par le Christ pour être son disciple ; il se pourrait même que ce soit le verset le plus décrié de toute la Bible. De bons théologiens pourraient avancer mille raisons pour vous prouver que ce verset ne signifie pas ce qu’il dit, mais les simples disciples le reçoivent tel quel avec empressement, en pensant que le Seigneur Jésus savait ce qu’il disait. Que signifie renoncer à tout ? Cela signifie faire abandon de tous les biens matériels que l’on possède et qui ne sont pas absolument indispensables et qui pourraient être employés pour la diffusion de l’Évangile.
Celui qui renonce à tout n’en devient pas pour autant un perpétuel vagabond ; il travaille pour pourvoir aux besoins de sa famille et aux siens propres. Mais puisque la passion de sa vie est de faire avancer la cause de Christ, il investit dans l’œuvre du Seigneur tout ce qui dépasse le nécessaire et laisse à Dieu le soin de l’avenir. En cherchant d’abord le royaume de Dieu et sa justice, il croit qu’il ne manquera jamais ni de la nourriture ni du vêtement.
Il ne peut en conscience retenir de quoi constituer une épargne quand des âmes périssent faute de connaître l’Évangile. Il ne veut pas gaspiller sa vie à accumuler des richesses qui tomberont aux mains du diable lorsque Christ reviendra pour prendre ses saints avec Lui. Il veut obéir aux injonctions du Seigneur contre le danger d’amasser des trésors sur la terre.
En renonçant à tout, il offre ce que, de toute manière, il ne pourrait pas conserver et qu’il a cessé d’aimer. Voici donc les sept conditions à remplir pour être un vrai disciple. Elles sont claires et sans équivoque. L’auteur se rend compte, après les avoir exposées, qu’il s’est condamné lui-même et mérite d’être considéré comme un serviteur inutile. Mais la vérité de Dieu devrait-elle être étouffée à cause des manquements du peuple de Dieu ? N’est-il pas vrai que le message est plus grand que le messager ? Ne convient-il pas que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme comme menteur ? Ne serait-il pas bon de comprendre ce que disait un grand homme : « Que ta volonté soit faite même si je ne l’ai pas faite » ?
En confessant nos échecs passés, sachons faire face courageusement aux exigences de Christ sur nos vies et chercher à être désormais ses vrais disciples.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (les conditions) (3) - Pour être disciple du Seigneur Jésus, il faut renoncer à tout.
« Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple (Luc 14 v. 33) ». Pour être disciple du Seigneur Jésus, il faut renoncer à tout. C’est bien cela, et sans aucune possibilité d’erreur, que signifient les paroles du Sauveur. Ce que nous pourrions avoir à objecter à une demande aussi « extrême » importe peu, pas plus que ce que nous pourrions avancer à l’encontre d’une politique aussi « inadmissible » et « insensée » ; reconnaissons simplement que c’est la Parole du Seigneur qui l’ordonne et qu’Il dit bien ce qu’il a voulu dire.
Avant toute chose, nous devrions regarder en face ces vérités irréductibles :
a. Jésus n’a pas exigé cela d’une certaine classe de chrétiens, d’hommes choisis pour entrer dans l’œuvre. Il a déclaré : « Quiconque d’entre vous… ».
b. Il n’a pas dit que nous devions simplement avoir l’intention de renoncer à tout. Il a dit : « Quiconque d’entre vous ne renonce pas ».
c. Il n’a pas dit que nous ne devions renoncer qu’à une partie de nos richesses. Il a dit : « Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ».
d. Il n’a pas dit qu’une forme atténuée de vie de disciple pourrait être envisagée en faveur de celui qui continuerait à s’accrocher à ses trésors. Jésus a dit : « … il ne peut être mon disciple ».
En fait, nous ne devrions pas être surpris par l’absolu de cette demande comme si c’était le seul passage du Nouveau Testament où il en soit question. Jésus n’a-t-il pas dit : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel (Matthieu 6 v. 19 et 20) ? »
Comme Wesley l’a dit très justement : « Amasser des trésors sur la terre est tout aussi clairement défendu par notre Maître que l’adultère et le meurtre ». Jésus n’a-t-il pas dit : « Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes… (Luc 12 v. 33) ? » N’a-t-il pas ordonné au jeune homme riche : « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi ! (Luc 18 v. 22) ? »
S’il n’avait pas l’intention de dire exactement ce qu’il a dit, que voulait-il donc dire ? Les croyants de l’église primitive ont pris ses paroles à la lettre : « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun (Actes 2 v. 45) ». De même, à travers les âges, beaucoup de saints renoncèrent littéralement à tout pour suivre Jésus.
Anthony Morris Groves et sa femme, missionnaires pionniers à Bagdad, étaient convaincus « qu’ils devaient cesser d’amasser des trésors sur la terre et qu’ils devaient consacrer la totalité de leurs revenus, pourtant très substantiels, au service du Seigneur ». Les réflexions de Groves sur ce sujet sont contenues dans son ouvrage Consécration Chrétienne.
C.T. Studd décida de donner toute sa fortune à Christ et de saisir ainsi l’occasion merveilleuse qui lui était offerte de faire ce que le jeune homme riche avait refusé de faire. Il s’agissait pour lui d’une simple obéissance à ce qui était écrit noir sur blanc dans la Parole de Dieu. Après avoir distribué des centaines de milliers de francs pour l’œuvre du Seigneur, il mit de côté une somme très importante qu’il réservait à sa jeune épouse. Celle-ci ne voulut pas être en reste sur son mari.
— Charles, lui dit-elle, qu’est-ce que le Seigneur a commandé au jeune homme riche de faire ?
— De tout vendre.
— Eh bien, alors nous allons nous mettre en règle avec le Seigneur dès le début de notre mariage.
Et l’argent s’en alla vers les champs de mission !
Le même esprit d’entière consécration animait Jim Elliot en Équateur. Il écrivait dans son journal : « Père, fais que je devienne faible pour que je cesse de me cramponner aux choses passagères. Ma vie, ma réputation, mes biens, fais, Seigneur, que je perde la tension de la main qui s’y agrippe. Je voudrais même, Père, perdre l’amour de ce qui me fait plaisir. Combien souvent n’ai-je pas relâché mon étreinte, mais tout en retenant pourtant ce qui me plaisait le plus, ce que j’aimais en secret. Ouvre-moi donc la main pour y planter le clou du Calvaire, tout comme l’était la main de Christ, afin qu’ayant tout abandonné, je puisse me sentir libéré, détaché de tout ce qui me lie encore. Jésus n’a pas considéré le ciel, ni même d’être égal avec Dieu, comme une proie à arracher. Qu’ainsi, Seigneur, je relâche mon étreinte ! »
Nos cœurs partagés voudraient nous faire croire qu’il est impossible d’accepter les paroles du Seigneur dans leur sens littéral. Si nous abandonnions tout, nous marcherions sûrement à la catastrophe. Après tout, ne devons-nous pas faire des économies pour assurer notre avenir et celui de ceux qui nous sont chers ? Si chaque chrétien abandonnait tout, qui financerait l’œuvre du Seigneur ? Et si quelques chrétiens n’étaient pas très riches, comment les couches supérieures de la société pourraient-elles être évangélisées ? Et ainsi de suite … les arguments tombant comme de la pluie, tout cela pour démontrer que le Seigneur ne pouvait avoir voulu dire ce qu’il a dit.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (les conditions) (4) - L’obéissance au commandement du Seigneur fait mener l’existence la plus saine et la plus raisonnable qui se puisse concevoir.
Le fait est, pourtant, que l’obéissance au commandement du Seigneur fait mener l’existence la plus saine et la plus raisonnable qui se puisse concevoir, celle aussi qui procure les plus grandes joies. L’Écriture et l’expérience rendent témoignage au fait qu’aucun de ceux qui vivent une vie offerte en sacrifice pour Christ ne manque ni ne manquera de rien. Lorsqu’un homme obéit à Dieu, le Seigneur prend soin de lui.
Celui qui abandonne tout pour suivre Christ ne devient pas un vagabond vivant aux dépens des autres chrétiens.
1. Il est laborieux. Il travaille courageusement pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.
2. Il est frugal. Il vit aussi économiquement que possible afin de pouvoir investir dans l’œuvre du Seigneur tout ce qui dépasse ses besoins immédiats.
3. Il est prévoyant. Au lieu d’amasser des richesses sur la terre, il place son trésor dans le ciel.
4. Il fait confiance à Dieu pour l’avenir. Au lieu de passer le plus clair de sa vie à constituer des réserves pour assurer sa vieillesse, il donne le meilleur de lui-même pour le service de Christ et Lui fait confiance pour le reste. Il croit que s’il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, la nourriture et le vêtement ne lui feront jamais défaut (Matthieu 6 v. 33).
Pour lui, il n’est pas raisonnable d’accumuler des biens pour les jours à venir et il voudrait s’en justifier en faisant valoir ce qui suit :
1. Comment pourrions-nous, en conscience, constituer des réserves financières quand cet argent pourrait être utilisé immédiatement pour sauver des âmes ? « Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? (1 Jean 3 v. 17) » ; « Considérez de plus ce que comporte ce grand commandement : Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Lévitique 19 v. 18) ».
Pouvons-nous, en vérité, prétendre aimer notre prochain comme nous-mêmes, si nous le laissons périr d’inanition alors que nous avons ce qu’il nous faut et même de quoi thésauriser ? Je pourrais en appeler à quiconque a fait expérience de la joie de connaître le don ineffable de Dieu et lui demander : « Seriez-vous prêt à échanger cette connaissance contre l’univers tout entier ? Ne retenons donc pas les moyens par lesquels d’autres pourraient parvenir à cette connaissance qui sanctifie, à cette consolation céleste » A. N. Groves.
2. Si nous croyons vraiment que le retour de Christ est imminent, nous devons avoir a cœur d’utiliser notre argent dans l’immédiat. Autrement, nous courons le risque de voir tomber aux mains du diable des fonds qui auraient pu être utilisés pour procurer des bénédictions éternelles.
3. Comment pourrions-nous en conscience prier pour que le Seigneur pourvoie aux besoins de son œuvre si nous sommes précisément les détenteurs de cet argent que nous refusons d’utiliser à cette fin ? Abandonner tout pour Christ nous préserve de l’hypocrisie lorsque nous prions.
4. Comment pourrions-nous prétendre enseigner aux autres toutes les lois de Dieu s’il est des domaines, comme celui-ci, où nous avons négligé d’obéir ? Dans ce cas, notre façon de vivre nous réduirait au silence.
5. Dans le monde, les gens intelligents s’emploient à constituer des réserves en vue de l’avenir. C’est ce qui s’appelle agir selon le bon sens et non par la foi. Le chrétien est appelé à vivre dans la dépendance de son Dieu. S’il se met, lui aussi, à amasser des trésors sur la terre, en quoi est-il différent des gens du monde ?
L’argument selon lequel nous devons assurer l’avenir de nos familles sous peine d’être pires que des infidèles est très fréquemment avancé. Les deux versets utilisés pour défendre cette thèse sont les suivants : « … Ce n’est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants (2 Corinthiens 12 v. 14) » ; « Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle (1 Timothée 5 v. 8) ».
Un examen attentif de ces versets montre qu’ils traitent des besoins de chaque jour et non pas d’éventualités à venir. Dans le premier passage, Paul parle ironiquement. Lui-même représente les parents, et les Corinthiens sont ses enfants. Il ne leur a pas imposé de charges financières, bien qu’il en ait eu le droit comme serviteur du Seigneur. Après tout, il était leur père en la foi, et ce sont les parents qui, d’ordinaire, pourvoient aux besoins de leurs enfants et non l’inverse. Il n’est absolument pas question de parents qui économisent pour assurer l’avenir de leurs enfants. Tout ce passage est écrit en fonction des besoins présents de l’apôtre et non de l’éventualité de difficultés futures.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (les conditions) (5) - L’idéal, selon la Parole de Dieu, serait que les membres du corps de Christ s’occupent des besoins immédiats de leurs frères en la foi.
Dans 1 Timothée 5 v. 8, Paul discute du sort des veuves qui sont dans le besoin. Il insiste sur le fait que les membres de leur parenté doivent prendre soin d’elles. Si elles n’ont pas de famille ou si ces familles manquent à leur devoir, alors c’est à église locale qu’incombe la responsabilité de leur entretien. Mais, ici encore, il est question des besoins de l’heure et non des nécessités de l’avenir.
L’idéal, selon la Parole de Dieu, serait que les membres du corps de Christ s’occupent des besoins immédiats de leurs frères en la foi : « Il s’agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d’égalité : Dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité, selon qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n’en manquait pas (2 Corinthiens 8 v. 13 à 15) ».
Un chrétien qui éprouve le besoin d’amasser en vue de l’avenir se trouve confronté à un problème difficile : celui de savoir ce qu’il doit considérer comme suffisant. Il passe dès lors sa vie à se constituer un capital d’un montant indéterminé et se refuse le privilège de donner le meilleur de lui-même au Seigneur Jésus-Christ. Il arrive ainsi à la fin d’une vie gaspillée pour découvrir qu’il aurait de toute manière été pourvu à ses besoins s’il avait vécu de tout son cœur pour le Seigneur.
Si tous les chrétiens prenaient à la lettre les paroles de Jésus, il n’y aurait pas de déficits dans les finances de l’œuvre du Seigneur. La bonne nouvelle serait portée avec une force croissante et atteindrait des masses encore ignorantes.
Si quelque disciple était dans la détresse, ce serait une joie et un privilège pour les autres de partager avec lui ce qu’ils auraient sous la main. L’argument selon lequel il doit y avoir des chrétiens fortunés pour atteindre les classes supérieures de la société n’est pas à prendre en considération. C’est alors qu’il était prisonnier que Paul eut l’occasion d’évangéliser « ceux de la maison de César (Philippiens 4 v. 22) ». Si nous obéissons à Dieu, nous pouvons être certains qu’il ordonnera Lui-même toutes choses.
La conduite du Seigneur Jésus devrait être considérée comme un exemple en la matière. Le serviteur n’est pas plus grand que son Maître : « Il ne convient pas au serviteur de chercher à devenir riche, grand et honoré dans ce monde où son Seigneur a été pauvre, sans apparence et méprisé » Georges Muller.
« Les souffrances de Christ incluaient la pauvreté (2 Corinthiens 8 v. 9) ». Bien sûr, la pauvreté ne doit pas être confondue avec la saleté et le débraillé, mais elle se manifeste par l’absence de réserves et des moyens de vivre dans le luxe… Andrew Murray faisait remarquer que le Seigneur et ses apôtres n’auraient pu accomplir leur œuvre s’ils n’avaient été pauvres. Celui qui veut en relever un autre, doit s’abaisser, comme le Samaritain ; l’infinie majorité du genre humain a toujours été et est encore pauvre » A. N. Groves.
On allègue qu’il est des biens matériels indispensables à la vie domestique. C’est vrai. On allègue que les hommes d’affaires chrétiens doivent disposer d’un certain capital pour la marche de leurs entreprises. C’est vrai. On allègue qu’il est même des biens matériels, comme la possession d’une automobile par exemple, qui peuvent être utilisés à la gloire de Dieu. Ceci est vrai aussi.
Mais par-delà ces nécessités légitimes, le chrétien devrait vivre frugalement et comme offert en sacrifice pour l’avancement de l’évangile. Son mot d’ordre devrait être : « Travailler dur, consommer peu, donner beaucoup, et tout pour Christ » A. N. Groves. Chacun de nous est responsable devant Dieu de la manière d’obéir à son ordre de tout abandonner. Un croyant ne peut en régenter un autre ; chacun doit agir après s’être placé lui-même devant le Seigneur. C’est une question personnelle, lourde de conséquences.
Si, à la suite d’un tel examen, le Seigneur devait amener un croyant à un degré de consécration inconnu jusqu’ici, il ne devrait pas y avoir là matière à orgueil spirituel. Quelque sacrifice que nous fassions ne nous paraît plus un sacrifice quand nous le considérons dans la perspective du Calvaire. En fin de compte, nous ne faisons que donner au Seigneur ce que, de toute façon, nous ne pouvons conserver et que nous avons cessé d’aimer.
« Celui qui donne ce qu’il ne peut conserver pour gagner ce qu’il ne peut pas perdre, est un sage » Jim Elliot.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (obstacles) (6) - Quiconque se décide à suivre Christ peut être assuré qu’il lui sera donné de nombreuses occasions de revenir sur ses pas.
Bien des voix lui offriront d’alléger quelque peu sa croix. Douze légions d’anges se tiennent prêtes à le délivrer du sentier du renoncement à soi-même et du sacrifice. Ceci est remarquablement illustré par le récit de trois candidats-disciples qui permirent à d’autres voix de prévaloir sur celle de Christ : « Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières. et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur. Permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur. mais permets-moi d’aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu (Luc 9 v. 57 à 62) ».
Trois hommes dont nous ignorons le nom rencontrèrent Jésus. Une impulsion intérieure les poussa à Le suivre. Mais ils accordèrent à quelque chose d’autre la permission de venir s’interposer entre leur âme et une entière consécration à son service.
Monsieur Impulsif.
Le premier de ces personnages, nous l’appellerons Monsieur Impulsif. Il s’offrit avec enthousiasme comme volontaire pour suivre le Seigneur n’importe où : « Je te suivrai partout où tu iras ! » Aucun prix ne serait trop élevé, aucune croix trop lourde, aucun sentier trop rocailleux. La réponse du Seigneur semble, au premier abord, n’avoir aucun rapport avec la proposition spontanée de Monsieur Impulsif. Jésus lui dit en effet : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête ! »
Dans le cas présent, la réplique du Seigneur était tout-à-fait à propos. Elle voulait dire en clair : « Tu prétends être disposé à me suivre n’importe où, mais es-tu prêt à te passer pour cela du confort matériel de l’existence ? Les renards sont mieux logés en ce monde que je ne le suis moi-même. Les oiseaux ont au moins un nid qu’ils peuvent appeler leur. Mais moi, je suis un vagabond errant dans ce monde que mes mains ont fait. Es-tu prêt à renoncer à la douceur d’un foyer pour me suivre ? Es-tu prêt à faire abandon des commodités légitimes de la vie pour me servir avec dévouement ? »
Apparemment cet homme n’y était pas disposé, car nous n’en entendrons plus parler dans l’Écriture Sainte. Son amour pour les agréments de la terre était plus grand que sa consécration à Christ.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (obstacles) (7) - Quiconque se décide à suivre Christ peut être assuré qu’il lui sera donné de nombreuses occasions de revenir sur ses pas.
Monsieur Temporisateur.
Le deuxième de ces personnages, nous l’appellerons Monsieur Temporisateur. Il ne se porta pas volontaire comme le premier, c’est plutôt le Sauveur qui l’appela à Le suivre. Sa réponse ne fut pas un refus catégorique. Il était loin de ne porter aucun intérêt au Seigneur, mais il y avait quelque chose qu’il voulait terminer d’abord. C’est en cela qu’il a péché. Il a voulu placer ses propres affaires avant celles de Christ. Écoutez sa réponse : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père ! (Luc 9 v. 59 ) »
Il est parfaitement légitime pour un fils de montrer du respect envers ses parents. Lorsqu’un père meurt, il est bien évident que la foi chrétienne recommande de lui faire des funérailles décentes. Mais les convenances légitimes de la vie deviennent à proprement parler un péché lorsqu’elles en arrivent à prendre le pas sur les intérêts du Seigneur Jésus. Le vrai mobile qui régissait la vie de cet homme est mis à jour par les termes mêmes de sa requête : « Seigneur … moi d’abord… … Les autres mots qu’il a prononcés n’étaient qu’un voile pour dissimuler son désir évident de se servir en priorité.
Apparemment, il n’avait pas compris que les mots « Seigneur ... moi d’abord... sont une absurdité et une impossibilité morales. Si Christ est Seigneur, alors Il doit passer le premier. Si c’est le « MOI » qui occupe le trône, alors Christ disparaît.
Monsieur Temporisateur avait quelque chose à faire, et il a laissé cette affaire prendre la première place. C’est donc à bon escient que Jésus lui a répondu : « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Paroles que nous pourrions paraphraser comme ceci : « Il est des choses que ceux qui sont morts spirituellement peuvent aussi bien faire que les croyants. Mais il est des choses dans la vie que seuls les croyants peuvent faire. Prends garde de ne pas passer ta vie à faire ce qu’un inconverti pourrait faire à ta place tout aussi bien que toi. Laisse le mort spirituel ensevelir le mort physique. Mais quant à toi, que l’idéal de ta vie soit de faire avancer ma cause sur la terre ! »
Il semble que le prix à payer ait été trouvé excessif par Monsieur Temporisateur. Il disparaît alors de la scène et le silence se fait sur son destin. Si le premier candidat nous montre que le confort matériel constitue un obstacle à l’enrôlement comme disciple, le deuxième nous fait comprendre que le travail et certaines occupations ont pris le pas sur ce qui aurait été la condition même d’une existence chrétienne.
Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à travailler pour gagner sa vie ; la volonté de Dieu, au contraire, est que l’homme travaille pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais la vie du vrai disciple de Jésus-Christ exige que le royaume de Dieu et sa justice soient placés en premier lieu ; qu’un croyant ne passe pas sa vie à faire ce qu’un irrégénéré pourrait faire tout aussi bien que lui, sinon mieux ; que l’accomplissement d’un travail soit simplement un moyen de pourvoir aux nécessités courantes, tandis que la vocation principale du chrétien demeure la prédication du royaume de Dieu.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (obstacles) (8) - Quiconque se décide à suivre Christ peut être assuré qu’il lui sera donné de nombreuses occasions de revenir sur ses pas.
Monsieur Sentimental.
Le troisième de ces personnages, nous l’appellerons Monsieur Sentimental. Il ressemblait au premier, dans ce sens qu’il se portait volontaire pour suivre le Seigneur. Mais il ressemblait également au deuxième par l’usage qu’il fit des mêmes paroles : « Seigneur … moi d’abord… » Il dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre congé de ceux de ma maison (Luc 9 v. 61) ».
Cette fois encore nous devons admettre qu’en soi il n’y a rien de déplacé dans cette requête. Il n’est pas contraire à la loi de Dieu de faire montre d’un affectueux intérêt envers ceux de sa parenté ou d’observer les règles du savoir-vivre en prenant congé d’eux. En quoi cet homme était-il donc répréhensible ? En ceci : Il a permis à la douceur des liens des affections naturelles de prendre une place qui n’appartient qu’à Christ.
C’est pourquoi le Seigneur Jésus lui a dit : « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu (Luc 9 v. 62) ». En d’autres termes : « Mes disciples ne sont pas pétris de cette mollesse et de ce sentimentalisme replié sur soi-même dont tu fais preuve. Je veux des hommes prêts à renoncer à ces liens qui les tiennent attachés à leur foyer, des hommes qui ne veulent pas se laisser détourner par l’amour qu’ils portent à leur famille mais qui désirent me faire passer avant tout le reste dans leur vie ! »
Nous pouvons conclure que Monsieur Sentimental a quitté Jésus et s’est éloigné tout triste. Ses aspirations irréfléchies à être un disciple s’étaient brisées sur les écueils des liens familiaux. Peut-être était-ce la pensée de sa mère en pleurs qui allait lui dire en sanglotant « Tu vas briser mon cœur de mère si tu me quittes pour aller vers les champs de mission ». Nous ne le savons pas. Tout ce que nous savons, c’est que la Bible ne nous livre pas le nom de cet homme au cœur défaillant qui, pour s’être éloigné de Jésus, a manqué la grande affaire de sa vie et s’est fait décerner l’épithète : «... impropre au royaume de Dieu ».
En Résumé.
Voici donc les trois principaux obstacles qui se dressent sur la voie de celui qui veut devenir un véritable disciple. Trois hommes qui n’étaient pas prêts à aller jusqu’au bout avec le Seigneur Jésus-Christ s’y sont heurtés.
• Monsieur Impulsif : L’amour du confort.
• Monsieur Temporisateur : Les affaires, le travail d’abord.
• Monsieur Sentimental : Priorité aux liens d’affection familiale.
Le Seigneur continue à faire appel, comme Il l’a toujours fait, à des hommes et à des femmes résolus à Le suivre héroïquement dans la voie du sacrifice. Les chemins qui s’en écartent se présentent d’eux-mêmes à nous et des voix se font entendre « Pense à toi ! Ne t’expose pas ! ». Rares sont ceux qui sont prêts à répondre !
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• DISCIPLE (récompenses) (9) - La vie qui est abandonnée au Seigneur Jésus jouit du bénéfice de la vraie récompense.
La joie et le plaisir de suivre Christ donnent à la vie son véritable sens. Le Sauveur a dit à plusieurs reprises : « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ». En fait, cette déclaration se retrouve dans les quatre Évangiles plus souvent que toute autre. (Voyez Matthieu 10 v. 39 - 16 v. 25 ; Marc 8 v. 35 - Luc 9.24 - 17 v. 33 ; Jean 12 v. 25). Pourquoi cette répétition constante ? N’est-ce pas parce qu’il s’agit ici d’un des principes fondamentaux de la vie chrétienne, à savoir qu’une vie conservée pour la jouissance égoïste est une vie perdue, tandis qu’une vie qui est comme répandue pour Lui est une vie retrouvée, sauvée, heureuse et gardée pour l’éternité ?
Être chrétien à moitié, c’est vivre une existence misérable. Être entièrement à Lui, c’est le sûr moyen de jouir de ce qu’il y a de meilleur. Être un vrai disciple, c’est être un esclave de Jésus-Christ et faire à son service l’expérience d’une parfaite liberté. Il y a liberté pour celui qui peut dire « J’aime mon Maître, et je ne veux pas Le quitter ».
Le disciple ne se laisse pas empêtrer dans des affaires sans importance ni par des choses passagères. Il s’occupe des choses éternelles, et, comme Hudson Taylor, il jouit du luxe de n’avoir à se soucier que de peu de choses. Il peut être inconnu, et pourtant, il est bien connu. Constamment mourant, il continue à vivre. Châtié, mais non mis à mort. Même dans le chagrin, il se réjouit. Quoique pauvre, il en enrichit plusieurs. Bien que n’ayant rien, il possède toutes choses (2 Corinthiens 6 v. 9 et 10).
Et si l’on peut dire que la vie du vrai disciple est celle qui est spirituellement la plus satisfaisante en ce monde, il peut être ajouté tout aussi certainement que c’est celle qui sera l’objet de la plus grande récompense dans le siècle à venir : « Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres (Matthieu 16 v. 27) ». C’est pourquoi, l’homme vraiment béni dans le temps et l’éternité est celui qui peut dire avec ce jeune universitaire de Yale : « Seigneur Jésus, pour ce qui concerne la conduite de ma vie, je Te laisse la direction. Je Te place sur le trône de mon cœur. Change-moi, purifie-moi, utilise-moi, comme Tu le trouveras bon ! »
Du temps pour le monde avec ses querelles et ses jouets ! Pas de temps pour l’œuvre de Jésus, nourrir l’affamé, Faire goûter aux âmes perdues les joies de l’éternité. En péril, en péril ! Écoute, écoute leur appel : Apportez-nous votre Sauveur, oh, parlez-nous de Lui ! Nous sommes si fatigués, si lourdement chargés. Et, à force de pleurer, nos yeux se sont abîmés.
Il ne veut pas qu’aucun périsse ! Suis-je donc son disciple, et comment puis-je vivre Plus longtemps tout à l’aise avec une âme qui se meurt ? Perdue faute du secours qu’il était en mon pouvoir d’accorder.
En péril ! En péril ! Tu ne veux pas qu’aucun périsse ! Maître, pardonne et inspire à nouveau, Bannis notre mondanité, aide-nous à vivre toujours Les yeux fixés sur les valeurs éternelles ».
Lucy R. Meyer
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
E
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• EAU - L’eau parle, au sens positif de l’eau de la vie.
Dans la Bible, l’eau peut avoir différentes significations symboliques. Les plus importantes sont les suivantes :
La parole de Dieu
L’eau est souvent une image de l’action purificatrice de la parole de Dieu. En Jean 15 v. 3, le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Vous, vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite », et en Éphésiens 5 v. 26, il est écrit que Christ a sanctifié l’Assemblée «en la purifiant par le lavage d’eau par la parole». L’acte symbolique du lavage des pieds (Jean 13) est aussi en rapport avec cette pensée (cf. Hébreu 10 v. 22).
Le Saint Esprit
En Jean 7 v. 38, le Seigneur Jésus parle des « fleuves d’eau vive » qui coulent de ceux qui croient en lui. Le verset suivant donne l’explication : « Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui ». Cela nous aide à comprendre les paroles du Seigneur Jésus en Jean 4 v. 10 et suivants, où il parle également de «l’eau vive» qu’il voulait donner. L’eau vive (cf. Lévitique 14 v. 5) est de l’eau de source, à la différence de celle qui provient d’un bassin ou d’une citerne.
Les masses des peuples
« Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules et des nations et des langues » (Apocalypse 17 v. 15 ; cf. Ésaïe 17 v. 12 ; 57 v. 20).
La mort
Les eaux de la mer Rouge et du Jourdain sont un type de la mort que Christ a connue à notre place et dont il est sorti victorieux par la résurrection (cf. 2 Samuel 22 v. 5 : « les vagues de la mort » ; Psaume 69 v. 1 à 15).
En outre l’eau parle, au sens positif (l’« eau de la vie »), de la bénédiction que Dieu veut donner à celui qui a soif spirituellement (Ésaïe 55 v. 1 ; Jérémie 2 v. 13 ; Ézéchiel 47 v. 1 à 12 ; Apocalypse 21 v. 6 ; 22 v. 17). Au sens négatif, l’eau est aussi une figure des puissances adverses (Psaume 66 v. 12 ; Ésaïe 43 v. 2).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉCARLATE, CRAMOISI - L’écarlate semble bien être en relation avec Israël.
L’écarlate est une substance colorante d’un rouge éclatant qui, dans l’Antiquité, était tirée de la cochenille. Le nom a été donné à l’étoffe teinte de cette couleur.
Le mot écarlate se trouve pour la première fois en Genèse 38 v. 28, où un fil écarlate est lié sur la main de Zérakh, un des fils jumeaux de Tamar, à sa naissance. Un cordon de fil écarlate a été attaché par la prostituée Rahab à la fenêtre de sa maison à Jéricho, afin qu’elle soit épargnée lors de la conquête de la ville (Josué 2 v. 21). Aussi bien Tamar que Rahab sont mentionnées dans la généalogie du Seigneur Jésus en Matthieu 1. Dans l’évangile selon Matthieu, le manteau dont on a revêtu le Seigneur par dérision est non pas de pourpre, comme en Marc 15 v. 17 et Jean 19 v. 2, mais d’écarlate. Ainsi l’écarlate semble bien, en premier lieu, être en relation avec Israël, le peuple élu de Dieu. Pour la purification d’un lépreux et pour la préparation de l’eau de séparation par le sacrifice de la génisse rousse, de l’écarlate devait être employé avec du bois de cèdre et de l’hysope (Lévitique 14 v. 4 ; Nombres 19 v. 6). Dans cet ordre d’idées, l’écarlate est souvent l’expression de la gloire de ce monde, ainsi que nous le trouvons en 2 Samuel 1 v. 24 ; Lamentations de Jérémie 4 v. 5 ; Nahum 2 v. 3. En Ésaïe 1 v. 18 le péché d’Israël est comparé au cramoisi (hébreu tola) et à l’écarlate (hébreu schanim).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉGYPTE - L’Égypte et le Pharaon une figure du monde et de Satan, son dieu et son chef.
L’Égypte est généralement une figure du monde ennemi de Dieu. Cela paraît clairement pour la première fois dans l’histoire d’Abraham (Genèse 12, v. 10 à 13, 4). Il quitte le pays de Canaan, que Dieu lui a promis, pour chercher en Égypte le moyen d’échapper à la famine; mais il doit y faire l’expérience des dangers du monde. Plus tard Dieu annonce à Abraham que sa semence serait opprimée dans ce pays (Genèse 15 v. 13).
Dans l’histoire de Joseph, l’Égypte a toutefois une signification quelque peu différente : le monde des peuples païens ou des nations y est vu en contraste avec le peuple d’Israël. Comme Joseph a été rejeté par ses frères, mais reconnu et hautement honoré en Égypte, ainsi le Seigneur Jésus n’a pas été accepté par les siens (Jean 1 v. 11), mais il a été cru et reconnu dans le monde (1 Timothée 3 v. 16). Dans l’histoire subséquente d’Israël, les prédictions de Dieu se sont accomplies. Le peuple a été opprimé quatre cents ans en Égypte. L’Égypte et le Pharaon sont ici une figure du monde et de Satan, son dieu et son chef (Jean 14 v. 30 ; 2 Corinthiens 4 v. 4).
Dans le Nouveau Testament, la sortie du peuple d’Israël hors d’Égypte est mentionnée deux fois pour l’instruction et l’avertissement des croyants du temps présent (Hébreu 3 v. 16 ; Jude 5). En outre, nous trouvons en 1 Corinthiens 10 v. 1 et suivants, la signification typique des événements liés à la sortie d’Égypte et à la traversée de la mer Rouge.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ENCENS - L’encens servait à réjouir Dieu.
L’encens est tiré de la résine de certains arbres de l’Orient (boswellia) et répand, en brûlant, une odeur aromatique. Dans l’Ancien Testament, il est mentionné comme élément de l’encens composé (Exode 30 v. 34) ; de l’encens devait être aussi offert avec l’offrande de gâteau (Lévitique 2 v. 1 et 2). Il ressort de Deutéronome 33 v. 10, que l’encens servait à réjouir Dieu. Dans le Nouveau Testament, l’encens est mentionné parmi les dons offerts par les mages au Seigneur comme petit enfant à Bethléhem (Matthieu 2 v. 11). Il est une figure de la gloire du Seigneur Jésus pendant sa vie ici-bas par laquelle le Père a été glorifié.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ENCENS COMPOSÉ - Il n’était là que pour être offert le matin et le soir sur l’autel d’or de l’encens dans le lieu saint, et une fois l’an dans le lieu très saint.
Pour le service divin dans la tente d’assignation, un encens composé était employé, dont les éléments, prescrits par Dieu, étaient: le stacte, la coquille odorante, le galbanum, l’encens pur et probablement le sel (Exode 30 v. 34 à 38). Ces drogues odoriférantes devaient être employées à poids égal, c’est-à-dire qu’il régnait un parfait équilibre. Les quantités ne sont pas données, peut-être une indication que le discernement de l’homme ne peut pas saisir la gloire infinie de Christ. Aucun homme ne devait fabriquer cet encens composé pour lui-même ou le flairer. Il n’était là que pour être offert le matin et le soir sur l’autel d’or de l’encens dans le lieu saint, et une fois l’an dans le lieu très saint (Exode 30 v. 7 et 8 ; Lévitique 16 v. 12 et 13). Les drogues odoriférantes et l’encens composé lui-même parlent de l’élévation et de la gloire de la personne de Jésus Christ, le Fils de Dieu, que le Père seul peut apprécier. Le fait que Dieu a trouvé son plaisir en son Fils bien-aimé est mentionné sept fois dans le Nouveau Testament (Matthieu 3 v. 17 ; 17 v. 5 ; Marc 1 v. 11 ; 9 à 7 ; Luc 3 v. 22 ; 9 v. 35 ; 2 Pierre 1 v. 17). En Apocalypse 5 v. 8, les prières des saints sur la terre sont comparées aux coupes d’or pleines de parfums des 24 anciens, et au chapitre 8 (v. 3), les parfums sont dans la main du Seigneur lui-même qui donne par eux efficace aux prières.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ENFANT - Le mot enfant a reçu sa signification la plus élevée dans la filiation divine.
Les langues hébraïque et grecque comportent différents mots qui sont traduits dans la Bible par « enfant ». Hormis leurs sens concrets de « descendant » et d’« être humain très jeune », ils sont aussi employés pour exprimer une relation intime ou l’affection (2 Timothée 2 v. 1 ; 1 Jean 2 v. 12). Les chrétiens qui pensent et agissent d’une manière charnelle sont appelés, au sens spirituel, des « petits enfants en Christ » ; ils ne peuvent supporter « la nourriture solide » de la parole de Dieu, mais ils ont besoin de « lait », des rudiments de la vérité chrétienne (1 Corinthiens 3 v. 2 ; Hébreu 5 v. 12 à 14).
Le mot enfant a reçu sa signification la plus élevée dans la filiation divine. « Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom; lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu » (Jean 1 v. 12 et 13 ; cf. 1 Jean 3 v. 9 ; 4 v. 7 ; 5 v. 1 à 4, 18). Être né de Dieu signifie avoir fait l’expérience de la naissance d’eau et de l’Esprit (Jean 3 v. 3 à 8). La vie éternelle, que nous avons par la foi au Fils de Dieu, est sa vie, est lui-même (Jean 3 v. 16 ; Colossiens 3 v. 4 ; 1 Jean 5 v. 11 à 20). Peut-on concevoir une relation plus intime d’anciens pécheurs avec Dieu, qui est lumière et amour ! Le Saint Esprit, que nous avons reçu par la foi à l’Évangile, rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu (Romains 8 v. 16). Déjà maintenant nous sommes rendus pleinement aptes et sommes appelés à nous tenir en esprit dans la sainte présence de Dieu, notre Père, et à nous y sentir comme à la maison ; mais nous sommes aussi invités, comme ses bien-aimés enfants, à refléter quelque chose de ce qu’il est en lui-même, amour et lumière.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉNOCH OU HENOC - Type des croyants qui seront enlevés par le Seigneur.
Enoch a vécu à l’époque qui a précédé le déluge (Genèse 5 v. 22 à 24). Cependant il ne périt pas dans le jugement de Dieu venu sur la terre par ce déluge, mais fut enlevé auparavant par Dieu. En cela il est un type des croyants qui seront enlevés par le Seigneur avant la grande tribulation pour être introduits dans la maison du Père (Hébreu 11 v. 5 ; 1 Thessaloniciens 1 v. 10 ; Apocalypse 3 v. 10). En revanche, Noé, qui fut sauvé à travers le déluge et transporté sur la terre purifiée, est un type du résidu juif qui sera gardé à travers la grande tribulation pour le Millénium (Zacharie 13 v. 8 et 9 ; Matthieu 24 ; Romains 9 v. 27 à 29). En outre Enoch a été le premier prophète qui a annoncé l’apparition de Christ en gloire et en jugement (Jude 14).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉPAULE - Image de la force, mais aussi du service ou encore de la servitude.
Autrefois la plupart des fardeaux étaient portés sur l’épaule (Genèse 49 v. 15 ; Exode 12 v. 34). L’épaule est ainsi l’image de la force, mais aussi du service ou encore de la servitude. Les Lévites qui portaient les choses les plus saintes de la tente d’assignation à travers le désert n’ont reçu aucun chariot à cet effet, mais il est dit expressément : « Ils portaient sur l’épaule » (Nombres 7 v. 9 ; 1 Chroniques 15 v. 2 à 15).
Le souverain sacrificateur portait sur ses épaules deux pierres d’onyx avec les noms des douze tribus d’Israël (Exode 28 v. 12). Ainsi, dans sa parfaite sacrificature, Christ, notre vrai Souverain Sacrificateur, représente tous les siens devant la face de Dieu et les porte dans sa puissance au travers de toutes les circonstances (cf. Hébreu 2 v. 18 ; 4 v. 14 à 16 ; 7 v. 25 ; cf. Luc 15 v. 5).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉPÉE - L'épée est la seule véritable arme de l’armure spirituelle.
Dans de nombreux passages de l’Ecriture sainte, l’épée est le symbole du jugement ou de la guerre et de la mort violente qui y est liée (Genèse 3 v. 24 ; Romains 8 v. 35 ; 13 v. 4, et beaucoup d’autres passages).
En Éphésiens 6 v. 17, « l’épée de l’esprit » est citée en sixième position de l’armure spirituelle et y est aussi expliquée : c’est la parole (écrite) de Dieu (lait, eau). L’expression veut dire que la parole de Dieu est inspirée et interprétée par le Saint Esprit, et par conséquent, qu’elle ne peut être employée à bon escient que dans la puissance de l’Esprit (cf. Jean 16 v. 13 ; 1 Corinthiens 2 v. 13 ; 2 Pierre 1 v. 21). Cette épée est la seule véritable arme de l’armure spirituelle. Les armes appropriées pour le combat contre l’ennemi des âmes sont non pas nos propres forces ou notre intelligence, mais seulement la parole de Dieu. Le meilleur exemple nous est donné par le Seigneur Jésus qui lui-même a « combattu » avec cette arme lorsqu’il a été tenté par Satan. Il a vaincu le tentateur à trois reprises par cette simple parole : « Il est écrit (Matthieu 4 v. 4, 7, 10) ». En Hébreux 4 v. 12, il est dit que « la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants ». Le fait qu’une épée aiguë à deux tranchants sort de la bouche du Fils de l’homme (Apocalypse 1 v. 16 ; 2 v. 12 ; 19 v. 15) devient compréhensible lorsqu’on pense à la Parole qui sort de sa bouche.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉPINES, RONCES - Les ronces et les épines sont une image de la malédiction du péché qui repose sur la création, et aussi une figure des hommes caractérisés par le péché.
Lorsque Dieu, après la chute, maudit le sol à cause de l’homme, il dit que désormais il en germerait des épines et des ronces et qu’Adam mangerait son pain à la sueur de son visage (Genèse 3 v. 17 à 19). Depuis lors, les ronces et les épines sont une image de la malédiction du péché qui repose sur la création, et aussi une figure des hommes caractérisés par le péché. David dit : « Mais les fils de Bélial sont tous comme des épines » (2 Samuel 23 v. 6 ; cf. Ésaïe 9 v. 18 ; 10, 17). Dans l’explication de la parabole du semeur, les épines sont présentées comme les «soucis de ce siècle et la tromperie des richesses» qui étouffent la parole de Dieu dans le cœur de l’homme, de sorte qu’elle ne peut produire aucun fruit (Matthieu 13 v. 7 à 22). Quand les soldats romains mirent, par dérision, une couronne d’épines sur la tête du Seigneur Jésus, ils n’étaient pas conscients de la signification de leur acte. Dans leur méchanceté, ils couronnèrent le seul homme sans péché avec le symbole de la malédiction, sans se douter qu’Il était destiné par Dieu à devenir malédiction pour nous (Matthieu 27 v. 29 ; Galates 3 v. 13).
Cependant, dans le règne millénaire, lorsque Satan sera lié et que le Seigneur Jésus régnera en justice et paix, selon Ésaïe 55 v. 13 « au lieu de l’épine croîtra le cyprès ; au lieu de l’ortie croîtra le myrte ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉPOUSE, FIANCÉE - Les deux premiers chapitres de la Bible, qui relatent la création d’Adam et Ève, contiennent non seulement l’exposé authentique de l’origine de l’homme et de la femme, mais aussi le premier type de Christ et de son Assemblée.
Le mot épouse dans l’original désigne une femme fiancée à un homme ou une femme au jour de ses noces. En tout cas, cette expression parle d’une relation d’amour vivante et fraîche. Dans l’Ancien Testament, l’Éternel considère son peuple terrestre, Israël, comme sa femme avec laquelle il s’est marié : « Je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l’amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Israël était saint à l’Éternel (Jérémie 2 v. 2 ; cf. Ézéchiel 16) ». Cependant par l’idolâtrie, que la Parole traite de prostitution, Israël était devenu infidèle à son Dieu et, pour cette raison, avait été répudié par lui. À la fin des temps, le peuple se tournera toutefois de nouveau vers l’Éternel qui en fera son épouse en réalité (Osée 2 v. 16 à 20). Dans le Cantique des cantiques, l’évolution spirituelle future du peuple juif est décrite sous la figure de la fiancée.
Dans le Nouveau Testament, l’Assemblée (grec : ekklesia) de Dieu est appelée « l’épouse, la femme de l’Agneau (Apocalypse 21 v. 9) ». Paul considérait l’assemblée à Corinthe comme une vierge chaste qu’il avait fiancée à Christ (2 Corinthiens 11 v. 2). Il est vrai que l’appellation « épouse » n’est pas employée en Éphésiens 5 v. 25 à 33, mais tout le passage est construit sur la relation du mari et de la femme dans les liens du mariage, comparée avec celle de Christ et son Assemblée. À la différence d’Israël, l’Assemblée se trouve dans une relation céleste et éternelle avec le Fils de Dieu qui est déjà appelé l’« époux » par Jean le Baptiseur (Jean 3 v. 29). Après l’enlèvement des croyants ont lieu dans le ciel les noces de l’Agneau, pour lesquelles sa femme est vêtue d’une robe de fin lin, ce dernier étant les justes actes des croyants (Apocalypse 19 v. 7 à 9). Dans l’éternité, l’Assemblée, « comme une épouse ornée pour son mari », sera à la gloire et à la joie de son Rédempteur (Apocalypse 21 v. 2).
Les deux premiers chapitres de la Bible, qui relatent la création d’Adam et Ève, contiennent non seulement l’exposé authentique de l’origine de l’homme et de la femme, mais aussi le premier type de Christ et de son Assemblée, donné encore avant la chute. Aucun des types de l’Ancien Testament ultérieurs n’atteint la perfection originelle et la beauté du premier, que nous pensions à Isaac et Rebecca, à Jacob et Léa, à Joseph et Asnath, à Moïse et Séphora, à David et Abigaïl ou à Assuérus et Vasthi. Ils ne contiennent souvent qu’un seul trait typifiant l’Assemblée ou l’Église. Le type d’Adam et Ève nous montre cependant les principes divins.
De même que Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et forma de l’une de ses côtes la femme qu’il lui présenta à son réveil, de même le Seigneur Jésus, après sa mort à la croix et maintenant « caché » en Dieu (cf. Colossiens 3 v. 3), forme aujourd’hui son Assemblée. Quand elle sera au complet, Christ, qui est à la fois Dieu et le dernier Adam, se la présentera glorieuse (Éphésiens 5 v. 27).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉTOILE - Employée comme figure du témoignage chrétien.
Les étoiles ont été créées conjointement avec le soleil et la lune (Genèse 1 v. 14 à 19) pour donner de la lumière sur la terre et pour orienter. Pendant des siècles, les voyageurs, spécialement les navigateurs, ont utilisé les étoiles pour déterminer leur position de nuit. De toutes les étoiles mentionnées dans la Bible, la plus significative a été l’« étoile de Bethléhem » que les mages de l’Orient ont vue, qui allait devant eux et qui s’est tenue au-dessus du lieu où le Sauveur du monde était né (Matt. 2). En rapport avec sa seconde venue, le Seigneur est lui-même l’étoile du matin. Le nombre considérable des étoiles n’était certes pas encore connu des hommes dans les temps bibliques, mais il a néanmoins été utilisé pour la description de multitudes innombrables, particulièrement pour la grandeur du peuple d’Israël (Genèse 15 v. 5 ; Deutéronome 1 v. 10). Dans le langage prophétique, les étoiles sont souvent des figures des autorités subordonnées (Juges 5 v. 20 ; Ésaïe 13 v. 10 ; 14 v. 13 ; Daniel 8 v. 10 ; Apocalypse 12 v. 4).
La lumière des étoiles est aussi employée comme figure du témoignage chrétien, quand Paul dit aux Philippiens qu’ils reluisent « comme des luminaires (porteurs de lumière, étoiles) dans le monde » pour présenter la parole de vie dans l’obscurité de la nuit spirituelle (Philippiens 2 v. 15). En revanche, les professants sans vie, qui se sont glissés parmi les vrais croyants, sont qualifiés d’« étoiles errantes, à qui l’obscurité des ténèbres est réservée pour toujours (Jude 13) ». Au lieu de répandre la lumière pure de la vérité et de l’amour divins et d’indiquer le chemin de la vie, ils conduisent les hommes dans l’erreur ! Que tous les enfants de Dieu aient le désir de recevoir force et joie du « Père des lumières », afin de rendre un témoignage vivant et lumineux à Lui-même et à son Fils !
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÉTOILE DU MATIN - Type du Seigneur Jésus qui viendra bientôt chercher les siens.
L’étoile du matin qui, à la fin de la nuit, annonce le commencement d’un nouveau jour, est un type du Seigneur Jésus qui viendra bientôt chercher les siens pour les introduire dans la maison du Père. En Apocalypse 22, où il est fait mention trois fois de son prochain retour (v. 7 v. 12 à 20), il se nomme lui-même « l’étoile brillante du matin » (v. 16). En 2 Pierre 1 v. 19, l’étoile du matin levée dans les cœurs fait allusion à l’attente vivante de la venue du Seigneur et, en Apocalypse 2 v. 28, le don de l’étoile du matin, dans la promesse au vainqueur de Thyatire, parle de l’espérance de sa prochaine venue; en revanche, lors de son règne dans le Millénium (auquel les vainqueurs auront également part, v. 26 et 27), il luira comme le soleil de justice.
Les étoiles du matin dont il est parlé en Job 38 v. 7, sont sans doute des princes parmi les anges ; Satan qui, en Ésaïe 14 v. 12, peut être discerné derrière le roi de Babylone, est appelé « astre brillant » et « fils de l’aurore ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ÈVE - Ève fut prise du côté d’Adam pendant son profond sommeil.
Ève, la femme d’Adam, est en Genèse 2 v. 20 à 24 un type de l’Assemblée. De même que l’Assemblée n’est venue à la vie qu’après la mort de Christ à la croix, ainsi Ève fut prise du côté d’Adam pendant son profond sommeil. De même que Dieu a présenté Ève à Adam, ainsi le Seigneur Jésus se présentera l’Assemblée glorieuse, sans tache et sans ride (Éphésiens 5 v. 27 ; cf. v. 30 à 32). De même que la relation d’Ève avec Adam a été troublée parce qu’elle a écouté le serpent, ainsi Paul craignait que les pensées des Corinthiens soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ (2 Corinthiens 11 v. 2 et 3).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• ENGENDREMENT - Le Christ est engendré en nous par l'Esprit de Dieu !
Lorsque nous avons accepté le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons reçu l’Esprit de miséricorde, en Jésus-Christ nous recevons la grâce de Dieu et sommes réconciliés avec le Père ! Malheureusement, beaucoup de chrétiens s’arrêtent là ! Ils ne peuvent pas manifester la vie du Christ dans leur vies chrétiennes car il leur manque le second « hé » ...
Typologiquement Abraham représente Dieu, Isaac l’époux, c’est-à-dire le Messie et Rebecca l’Epouse. Nous avons ici une vérité merveilleuse et solennelle en cette typologie. Dans le chapitre 17 du livre de la Genèse, il nous est relaté l’alliance de la circoncision que Dieu établit avec Abram et sa postérité. Saraï était stérile et Abram avait eu un fils, Ismaël, avec Agar. De manière logique, celui-ci crut que l’alliance de la circoncision (la brit mila, ברית מילה en hébreux), était pour Ismaël ! Cependant, l’Eternel lui confirma bien que ce serait Sarah qui lui donnerait un fils.
Mais avez-vous noté un évènement d’une extrême importance, qui se déroula avant cette annonce de la naissance d’un fils du sein de Sarah ? Dieu renomma Abram et Saraï ! Abram en hébreu s’écrit comme cela : אברם et Saraï, comme ceci : שׂרי ! Pour le nommer Abraham, Dieu lui ajouta une lettre, la lettre « hé », « ה », ce qui donna אברהם ! Pour Saraï, Il fit la même chose, ce qui a donné Sarah. Il ajouta un « hé » à son nom, ce qui donne : שׂרה ! Toutes les lettres de l’alphabet hébraïque ont une signification particulière ! Le « hé » est la représentation du souffle de vie, de l’Esprit de Dieu, la Ruwach, רוח !
Maintenant, regardons de plus près le Nom de Dieu qui ne se prononce plus, le Tétragramme. Il s’écrit comme cela en hébreu : יהוה, ce Nom divin est associé à la miséricorde, la « hesed », « חסד » et Il est formé de la lettre « yod », « י » et de deux « hé », « ה », séparés par un « vav », « ו ».
Le « yod » est associé à Dieu car il est la première lettre du Tétragramme, les sages d’Israël nous enseignent que lorsque l’on prend la première lettre d’un mot, on prend tout le mot, un peu comme notre tête représente tout notre corps. Je disais donc, que le « yod » est associé à Dieu, mais dans sa dimension de miséricorde, car Il a pris sur Lui le poids de la rigueur de sa propre justice. Cette miséricorde a été révélée en Jésus-Christ, le Nom de Yéshoua (Jésus) commence également par un « yod ». En d’autres termes, nous pouvons dire que le « yod » représente Dieu en Yéshoua, faisant miséricorde au monde par le sacrifice du Messie qui s’est chargé de nos fautes et a subi le châtiment de la justice divine à notre place.
Le « vav » représente un lien, le pictogramme original de cette lettre était un clou. Il représente le lien entre les cieux (les ciels si on veut être très précis) et la terre, de ce fait, il est le symbole du Messie.
Les sages d’Israël nous révèlent que Dieu a créé toutes choses sur la base de deux principes fondamentaux. Premièrement, La rigueur, la « gevurah », « גבורה » et deuxièmement la miséricorde, la « hesed », « חסד ». La rigueur, car Dieu est un Dieu moral, qui établit sa justice sur la base de la loi du bien. Il se soumet Lui-même à cette loi et ne peut tolérer le mal. Deuxièmement, la miséricorde, car l’Eternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, Il est amour et cette dimension est sa nature même !
Un commentaire (midrash) juif nous dit que chaque jour, Dieu se tient sur le trône de la rigueur (justice) pour juger le monde, et à cause du péché des hommes, Il prononce une sentence de mort sur l’humanité. Ensuite, Il se lève du trône de la rigueur et va s’assoir sur le trône de la miséricorde et déclare : « J’ai prononcé une sentence de mort sur les hommes, mais à cause de ma miséricorde, je suspends l’exécution de cette sentence pour laisser au pécheur le temps de se repentir afin qu’il vive ! » Les rabbins nous disent que la miséricorde de Dieu prédomine toujours sur sa rigueur.
Nous retrouvons ces deux principes fondamentaux dans le Tétragramme, ce sont les deux « hé » ! Nous disions précédemment que le « hé » représente l’Esprit de Dieu, son souffle, dans le Nom divin nous retrouvons l’Esprit de justice et l’Esprit de miséricorde de Dieu !
La rigueur est représentée typologiquement par Abraham qui reçut le « hé » de la justice de Dieu et la miséricorde par Sarah qui reçut le « hé » de la grâce de Dieu ! Lorsque Abraham et Sarah reçurent ces deux dimensions de l’Esprit de Dieu, celle-ci fut rendue capable d’enfanter ! Elle enfanta le « Messie », représenté par Isaac !
Frère et sœurs, comprenons-nous l’importance de cette révélation ? Saraï était stérile jusqu’à ce qu’Abraham et elles reçoivent l’Esprit de Dieu, unis à l’Esprit en Abraham ! De la même manière que l’enfant engendré en Marie venait de l’Esprit-Saint ; c’est par l’Esprit de Dieu seul que le « Messie » peut être engendré dans la vie des enfants de Dieu !
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Philippe Dehoux.
• ENLÈVEMENT - Être prêt pour l’enlèvement n'est pas un mythe !
« Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre (Matthieu 25 v. 6) ». Ce texte de Matthieu que tout le monde connait, renferme une vérité magnifique. Le verbe « crier » est, dans ce texte, employé au parfait ; en effet, en grec, le « parfait » retranscrit une notion de « présent » permanent. En hébreu, nous retrouvons la même pensée, parce que, fondamentalement en hébreux, il n’y a, ni présent, ni passé, ni futur. L’appel à aller à Sa rencontre est donc un cri éternel qui n’a ni commencement, ni fin.
Au milieu de la nuit, Jésus vient comme un Epoux pour chercher Son Epouse ; et au matin comme un Roi pour établir Son Royaume. Le chrétien qui entend ce que « l’Esprit dit à l’Eglise », est poussé à être prêt pour rencontrer son « Epoux ». Et non pas attendre le dernier moment, car il manquera certainement d’huile.
« Au milieu de la nuit », nous parle de ténèbres. Depuis le péché d’Adam, nous vivons dans un monde de ténèbres, influencé par « l’abime ». La conséquence est le « Tohu-bohu ». C’est donc l’huile du Saint-Esprit qui nous permet de luire de la lumière du Messies dans ce monde de ténèbres ; et de nous préparer pour l’enlèvement.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Philippe Dehoux.
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• ÉCONOME (gérance) - Le maître établit sur sa maison des économes fidèles et prudents.
Luc 16. La nourriture spirituelle n’est pas en vue ici, comme en Luc 12, mais les biens matériels, dont le Seigneur, dans une plus ou moins grande mesure, a confié l’administration aux siens. Les biens appartiennent au maître ; l’économe n’en a que la gérance. Il doit donc les administrer pour Lui. L’homme riche de Luc 12 v. 16, remplissait ses greniers ; celui de Luc 16 v. 19 ne pensait qu’à se vêtir splendidement et à faire joyeuse chère chaque jour ; le fils prodigue vilipendait les biens de son père ; l’économe emploiera pour autrui, quant à nous dans la dépendance du Seigneur, non pas à son insu comme dans la parabole, ce que le maître lui a confié. « Les richesses injustes » « ce qui est très petit », « ce qui est à autrui » représente les biens matériels qui nous sont confiés. « Ce qui est grand », « les vraies richesses » , « ce qui est vôtre », parle des biens spirituels qui sont la part bénie de tout chrétien en Christ. Mais l’administration des biens matériels, des « richesses injustes » requiert la fidélité : « Celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand ». Si un enfant de Dieu n’a pas été fidèle dans l’administration matérielle, si petite soit-elle, qui lui a été confiée, le sera-t-il dans le domaine spirituel ? (cf. 1 Timothée 6 v. 17 à 19).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• ÉCONOME (ou intendant) (1) - Dieu a pourvu l'homme de capacités qu’il doit utiliser pour glorifier son Créateur.
« Et il dit aussi à ses disciples : Il y avait un homme riche qui avait un économe ; et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et l’ayant appelé, il lui dit : Qu’est-ce que ceci que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton administration ; car tu ne pourras plus administrer (Luc 16 v. 1 et 2) ». Que le Créateur ait confié à l’homme des biens, la parabole du fils prodigue l’a déjà montré. Outre l’esprit, l’âme et le corps, Dieu l’a pourvu de capacités qu’il doit utiliser pour glorifier son Créateur. Dans cette mesure il est un administrateur (ou : intendant) de Dieu ; mais il n’a pas répondu à ce devoir. Le fils prodigue gaspilla (ou : dissipa) son bien, tout comme l’administrateur injuste le fit avec l’avoir de son maître. L’un l’a fait dans un pays éloigné, l’autre dans la maison de son Maître.
Cette dernière indication laisse penser qu’outre le point de vue général, l’administrateur injuste est aussi en particulier une image d’Israël. Dieu avait donné la loi à ce peuple dans un domaine établi par Lui, et avec elle les promesses et le service divin (Romains 9 v. 4 et 5). Mais ce peuple a, lui aussi, été infidèle vis-à-vis des biens extraordinaires qui lui avaient été confiés. Au lieu de transmettre aux peuples de la terre la connaissance qu’ils avaient reçue du seul vrai Dieu, ils violèrent la loi de Dieu, tombèrent dans l’idolâtrie et tuèrent finalement leur propre Messie, alors qu’Il était venu à eux comme une lumière pour la révélation des nations et la gloire du peuple d’Israël (Luc 2 v. 32).
À la suite de cela, ils furent destitués de leur administration. Dieu ne les a plus considérés comme Ses administrateurs. Déjà le prophète Osée avait dû crier au peuple : « vous n’êtes plus mon peuple, et moi, je ne suis plus à vous (Osée 1 v. 9) ». Mais ce n’est pas seulement Israël en particulier que Dieu ne considère plus comme Ses administrateurs, mais aussi l’homme en général. Il a perdu cette position par sa propre infidélité. Malgré tout, sa responsabilité subsiste vis-à-vis de son Créateur, car Dieu l’a encore laissé en possession des biens terrestres.
Même si dans notre parabole, la destitution de l’administrateur injuste de son poste d’administrateur est imminente pour lui, comment va-t-il agir entre temps avec les biens qui appartiennent à son maître, non pas à lui ? Comment va-t-il utiliser les possibilités et capacités qui lui restent ? C’est alors qu’intervient une application de la parabole à laquelle nous ne nous serions pas attendus de cette manière.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ÉCONOME (ou intendant) (2) - Dieu a pourvu l'homme de capacités qu’il doit utiliser pour glorifier son Créateur.
« Et l’économe dit en lui-même : Que ferai-je, car mon maître m’ôte l’administration ? Je ne puis pas bêcher la terre ; j’ai honte de mendier : je sais ce que je ferai, afin que, quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leurs maisons. Et ayant appelé chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? » Et il dit : Cent baths d’huile. Et il lui dit : Prends ton écrit, et assieds-toi promptement et écris cinquante. Puis il dit à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Et il dit : Cent cors de froment. Et il lui dit : Prends ton écrit, et écris quatre-vingts (Luc 16 v. 3 à 7) ».
Tandis que les paroles introductives de la parabole sont fort brèves, la prudence de l’administrateur est largement dépeinte. On entend ses réflexions, et on voit sa décision rapide et comment il l’a aussitôt traduite dans les faits. Il n’a pas non plus perdu beaucoup de temps pour échapper aux conséquences amères de sa destitution de fonction. Il est vrai qu’il exclut d’emblée deux possibilités. Il n’envisage pas de gagner sa vie en bêchant, car il n’a pas la force pour un travail aussi dur. Il a honte d’avoir tout juste de quoi vivre en mendiant. Finalement, il occupait jusqu’alors une position influente ; devrait-il maintenant avouer qu’il a sombré si bas ? Non, il ne se pose même pas la question !
N’avons-nous pas ici un tableau de l’homme naturel ? D’un côté il est entièrement sans force pour répondre aux exigences de Dieu, « alors que nous étions encore sans force (Romains 5 v. 6) ». C’est une des constatations les plus humiliantes que l’homme, qu’il soit Juif ou païen, ne possède aucune force pour faire le bien et pour laisser le mal. D’un autre côté, il a honte d’admettre son véritable état. Sa fierté lui interdit d’adopter une attitude de demandeur. Ce sont là les deux raisons principales pour lesquelles les gens refusent l’évangile et haïssent la grâce de Dieu. Car la grâce met en relief que nous sommes sans force, et qu’on ne peut la recevoir qu’en tant que suppliant, sans la mériter.
Mais l’administrateur arrive alors à une décision qui n’est pas typique de tout le monde. C’est pourquoi on peut parler d’un virage inattendu. Pour la plupart, les gens ne s’engagent justement pas dans les réflexions sur lesquelles l’administrateur a médité dans sa prudence. Ils vivent beaucoup plutôt dans l’insouciance du jour, sans réfléchir à ce qui arrivera au moment où les richesses (le Mammon) viendront à manquer (16 v. 9).
Pourtant l’administrateur, aussi injuste fût-il, pensait à ce qui allait se passer « après ». Que fallait-il faire, réfléchissait-il, pour que les gens le « reçoivent dans leurs maisons » quand il serait destitué de son administration ? C’est cela qui constituait sa prudence : il ne s’occupait pas du présent, mais dirigeait ses pensées vers l’avenir. Sans aucun doute, il aurait pu s’enrichir sur les biens de son maître tant qu’il en avait encore le pouvoir, mais il ne l’a pas fait. Il a plutôt cherché à transformer les débiteurs de son maître (il devait y en avoir beaucoup), en ses propres débiteurs, pour assurer son propre avenir. Il fit donc un usage des biens de son maître qu’on ne peut bien sûr pas qualifier de juste, mais de prudent.
Il n’est cité que deux exemples de débiteurs. Il semble qu’il s’agissait dans la parabole, non pas d’un fermier responsable de terres, mais d’un marchand, une sorte de commerçant en gros, devant des sommes d’argent considérables à son maître pour des quantités correspondantes d’huile et de blé fournies par ce maître. Autrement on ne peut guère expliquer que l’un ne devait à son maître que de l’huile, et l’autre que du blé (ou : froment). En outre 100 baths d’huile correspondent à environ 4000 litres et 100 cors de blé à environ 40 mètres cubes. L’administrateur remit « libéralement » à ces deux débiteurs une partie considérable de leur dette. Il fit la même chose avec « chacun des débiteurs de son maître ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ÉCONOME (ou intendant) (3) - Le maître ne peut s’empêcher de reconnaître la prudence de son économe injuste.
« Et le maître loua l’économe injuste parce qu’il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents, par rapport à leur propre génération, que les fils de la lumière (Luc 16 v. 8) ». Que le comportement de l’administrateur ait été injuste, cela n’est nullement passé sous silence. Il est expressément appelé, selon la traduction littérale, administrateur de l’injustice, ce qui ne signifie naturellement rien d’autre qu’administrateur injuste ; mais cette expression insiste spécialement sur l’injustice de cet homme et de ses agissements.
Mais pourquoi son maître le loue-t-il, et à quel sujet le loue-t-il quand il apprend la réalité de toute l’affaire ? En fait, il ne peut s’empêcher de reconnaître la prudence de son administrateur injuste. Celui-ci avait finalement sacrifié le présent à l’avenir, ce qui n’est pas banal du tout, et est pour cela digne de louange. On remarque bien que l’administrateur n’est pas loué pour son injustice, mais « parce qu’il avait agi prudemment ». Il avait su se faire des amis avec ce qui ne lui appartenait pas en vue du temps qui arriverait « après ».
Les gens n’agissent-ils pas en général de manière diamétralement opposée, et ne sacrifient-ils pas l’avenir au présent ? Leurs pensées ou leurs visées sont surtout tournées vers des événements et des évolutions présents, et si quand même ils se soucient de l’avenir, ce n’est alors qu’en vue d’un avenir dans ce monde. Leur prudence ne va pas plus loin. Ils vivent pour ce monde, et ce qui vient après ne les intéresse pas. C’est pourquoi ils sont appelés fils de ce monde. L’homme riche dans le dernier paragraphe du chapitre sera comme un fils de ce monde, tandis que le pauvre Lazare était un vrai fils de la lumière. Mais une fois morts, qu’arriva-t-il ? Nous le verrons en son temps.
D’habitude on tire de ceci que la parabole se termine par la louange du maître au sujet de l’administrateur injuste. Pourtant ce n’est qu’à partir du v. 9 que le Seigneur Jésus applique la parabole à Ses disciples. Entre deux, il y a cette remarque de 16 v. 8 « car les fils de ce siècle (ou : monde) sont plus prudents, par rapport à leur propre génération, que les fils de la lumière » ; elle appartient encore à la parabole.
Certes cette phrase n’ajoute rien au récit, mais la parabole est ainsi replacée dans son ensemble dans une juste lumière pour les auditeurs. Elle parle de la prudence des fils de ce monde par rapport à leur « génération ». Ils s’entendent à obtenir des avantages pour eux-mêmes, et ils ne s’embarrassent pas de scrupules de conscience ou de questions morales. En cela ils sont sans aucun doute supérieurs aux fils de la lumière.
Le personnage principal de notre parabole, l’administrateur, est directement la personnification de l’injustice, du début à la fin. Ce n’est pas par hasard que son injustice a donné son titre à la parabole, la parabole de ‘l’économe injuste’. Et pourtant le Seigneur profite de la prudence de cet homme pour nous communiquer des enseignements importants.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ÉCONOME (ou intendant) (4) - Traçons une deuxième ligne parallèle, la ligne de l’application à nous les enfants de Dieu.
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très-petit, est fidèle aussi dans ce qui est grand ; et celui qui est injuste dans ce qui est très-petit, est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? Et si, dans ce qui est à autrui, vous n’avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre ? (16 v. 9 à 12) ».
Il n’y a guère de parabole qui ait donné lieu à plus de commentaires contradictoires que celle-ci : comme si on pouvait s’acheter le ciel avec des richesses injustes ! Les exposés fantaisistes et se contredisant souvent les uns les autres proviennent pour la plupart de ce qu’on oublie à qui le Seigneur s’adressait avec cette parabole. Le v. 1 dit expressément « et il dit aussi à ses disciples », ce qui veut dire que les paroles du Seigneur ne concernent pas la manière dont on devient disciple, mais elles s’adressent à des gens qui le sont déjà. Nous ne devons donc pas interpréter de travers les explications du Seigneur comme si elles traitaient de la manière dont on parvient à la vie éternelle, dont on accède au ciel. Ensuite, on fait souvent l’erreur de prendre tel ou tel détail de la parabole comme base de son interprétation, au lieu de voir la parabole comme un tout. Considérons encore une fois la ligne de la parabole, et traçons à côté une deuxième ligne parallèle, la ligne de l’application à nous les enfants de Dieu ! La correspondance est manifeste.
En image, cette correspondance s’exprime sous forme de deux flèches parallèles dirigées dans le même sens.
L’homme est l’administrateur, nous le sommes aussi. Des biens lui sont confiés, à nous aussi. Il s’agit de richesses (ou : Mammon) injustes, c’est aussi notre cas. Il s’en fait des amis avec, c’est aussi ce que nous devons faire. Elles viennent à manquer, pour nous aussi. Mais alors un contraste apparaît : les fils de ce monde recherchent des maisons terrestres, les fils de la lumière recherchent des tabernacles éternels, des habitations célestes. Cela retourne la flèche en sens contraire. En fait, les uns sont motivés par l’injustice, les autres au contraire, par la justice. Dans ce cas, en image, cela fait symboliquement deux flèches parallèles dirigées en sens contraire.
Entrons maintenant d’encore plus près dans les paroles du Seigneur. Il parle de Mammon injuste (richesses injustes), l’expression littérale étant Mammon de l’injustice, comme il avait parlé précédemment d’administrateur de l’injustice. Autrement dit, Mammon comme désignation (dévalorisante) des richesses et des biens terrestres est caractérisé par l’injustice. L’explication de ce qualificatif ne réside pas seulement dans ce que la possession terrestre peut facilement conduire à l’injustice ; ce serait certainement un sens trop faible. L’argent et les richesses ne sont-ils pas marqués par la tache d’avoir circulé dans les mains d’hommes déchus et pécheurs, et d’avoir servi d’une manière pécheresse à des desseins de péché ? sans parler de ce qu’ils ont souvent été acquis de manière injuste.
Une deuxième comparaison suit. Les richesses (= le Mammon) injustes ne sont pas seulement ce qui est très petit, mais elles sont aussi fausses, superficielles, fugaces, trompeuses ; c’est pourquoi le Seigneur les met maintenant en contraste avec les vraies : « Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? (16 v. 11) ». Il arrive un moment où les richesses (le Mammon) viennent à manquer (16 v. 9) : quelle folie, dès lors, d’y mettre son cœur ! Notre vraie richesse est spirituelle, elle est dans le ciel. Tout ce qui est en rapport avec Christ glorifié, c’est les vraies richesses.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ÉCONOME (ou intendant) (5) - Traçons une deuxième ligne parallèle, la ligne de l’application à nous les enfants de Dieu.
Le Seigneur achève Ses enseignements avec les paroles suivantes : « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre : vous ne pouvez servir Dieu et les richesses (Luc 16 v. 13) ». Il nous arrive trop souvent de nous illusionner en croyant qu’on peut ménager la chèvre et le chou. C’est un grand danger de nos jours, de penser que d’un côté on pourrait servir le Seigneur, et de l’autre nos intérêts mondains. Le Seigneur dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, que nous ne pouvons pas servir Dieu et les richesses (Mammon).
Croyons-nous vraiment que Dieu nous ait donné la vie éternelle pour gagner le plus d’argent possible ? N’oublions-nous pas parfois que nous avons été achetés à un prix très élevé, le prix de Son sang (1 Corinthiens 6 v. 20) ? Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C’est pourquoi notre maître ne peut être qu’unique. Si nous n’y prenons pas garde, les richesses (Mammon) vont croître facilement pour devenir l’élément dominant dans notre vie, sans que nous n’en ayons bien conscience. On comprend bien que nous devons répondre à nos obligations terrestres avec fidélité et soin, mais c’est toute autre chose que de diriger nos pensées sur la multiplication de notre avoir terrestre. Prenons au sérieux la parole de notre Seigneur et Rédempteur ! Si nous servons les richesses (Mammon) sous une forme ou sous une autre, nous ne pouvons pas servir Dieu.
Servir signifie servir comme esclave. Nous ne pouvons pas être esclave de Dieu et en même temps esclave des richesses (Mammon). Le Seigneur explicite cela du point de vue d’un esclave, car deux maîtres pourraient arriver à s’entendre sur l’usage partagé d’un même esclave. Mais il est impossible à un esclave ou un domestique, de servir deux maîtres. Ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Autrement dit, dans son cœur et ses pensées il n’y aura qu’un seul des deux maîtres qu’il considérera comme son maître réel, et c’est à lui qu’il consacrera son service de cœur. L’autre ne sera servi qu’extérieurement ; ce ne sera qu’un service apparent.
Effectivement, dans notre cas, il ne peut y avoir qu’un Seigneur et Maître dans notre cœur. Nous nous imaginons certes souvent en train d’accorder le service apparent à l’autre maître, Mammon, tandis que nous servirions Dieu en réalité. Cependant le danger se trouve exactement en sens inverse : que nous servions Mammon de cœur et que nous cherchions à cacher cela par un service apparent vis-à-vis de Dieu.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• EFFORTS (pour se corriger) - Le Seigneur met en évidence divers moyens que l’ennemi emploie pour empêcher les âmes de venir à Lui.
Ceux-ci seraient-ils vraiment un obstacle ? Matthieu 12 v. 43 à 45 ; Luc 11 v. 24 à 26, nous donnent la réponse dans la parabole de l’esprit immonde. Celle-ci s’applique évidemment en première ligne au peuple juif, mais n’en pouvons-nous pas faire aussi une application pratique ? Cette maison balayée et ornée, mais vide, ne ressemble-t-elle pas à un cœur qui a cherché à se réformer soi-même, à s’orner de bonnes œuvres, mais où Christ n’a pas sa place ? Et si le cœur est vide, Satan saura bien y rentrer, et « la dernière condition de cet homme-là est pire que la première ». N’en est-il pas de même de Laodicée : « Je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai besoin de rien » ? Et le Seigneur est dehors, à la porte, qui frappe et plaide : « Si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi ». Bienheureuse portion d’un cœur rempli de Christ, qui ne s’est pas contenté de ses propres efforts pour se corriger.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• ENFANTS TÊTUS (1) - Image des hommes insensés, mais aussi méchants.
Matthieu 11 v. 16 à 19 et Luc 7 v. 31 à 35. La parabole des « enfants têtus » jouant sur la place du marché se trouve à peu près mot pour mot en Matthieu 11 v. 16 à 19 et Luc 7 v. 31 à 35. Le contexte est aussi le même dans les deux évangiles. Le Seigneur avait parlé de Jean le baptiseur, et avait montré que, sous l’ancienne dispensation de la loi, parmi ceux qui sont nés de femme, aucun n’était plus grand que Jean le baptiseur. Il avait été estimé digne d’être le précurseur direct du Seigneur Jésus, pour préparer Sa voie comme Messie. Et non seulement ce service exceptionnel lui avait été confié, mais Jean le baptiseur était lui-même l’objet de la prophétie (Malachie 3 v. 1).
Les conducteurs religieux du peuple avaient-ils accepté cette personnalité extraordinaire, ce messager de Dieu ? Non. Les publicains se faisaient bien baptiser par lui, et ainsi ils justifiaient Dieu ; c’est-à-dire ils avouaient et témoignaient que les revendications de Dieu à leur égard étaient fondées. Mais les pharisiens et les scribes le refusaient délibérément. De cette manière, ils annulaient le propos de Dieu à leur égard.
Alors le Seigneur Jésus montre à l’aide d’une petite image à quel point les « hommes de cette génération » (juive) étaient insensés, et non seulement ils étaient insensés, mais il y avait derrière tout cela une profonde méchanceté.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ENFANTS TÊTUS (2) - Le Seigneur voit devant Lui deux groupes d’enfants.
« À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? Ils sont semblables à des petits enfants qui sont assis au marché et qui crient les uns aux autres et disent : Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé ; nous vous avons chanté des complaintes et vous n’avez pas pleuré (Luc 7 v. 31 et 32) ». Représentons-nous d’abord la scène que le Seigneur décrit. En soi, elle est toute simple, si nous laissons tout à la place où le Seigneur l’a mis. Il y a là des enfants sur la place du marché, et ils jouent. La grande place du marché était naturellement parfaitement appropriée aux jeux d’enfants, les jours où il n’y avait pas marché. Le Seigneur voit devant Lui deux groupes d’enfants. Cela ressort encore plus clairement du texte de Matthieu : « Elle est semblable à de petits enfants assis dans les marchés, et criant à leurs compagnons… (Matthieu 11 v. 16) ».
L’un des groupes cherche à conduire et à influencer le jeu des autres à leur idée. Ils voudraient d’abord jouer à tel jeu, et ensuite à tel autre ; et si cela ne marche pas, ils s’en plaignent aux autres. Ils veulent d’abord jouer à la noce. Pour cela ils imitent ce que font les adultes dans une telle occasion, et spécialement ce qu’ils aiment faire dans le cortège. Ainsi ils sifflent ou jouent de la flûte sur des pipeaux qu’ils se sont fait eux-mêmes, ou bien ils reproduisent le son seulement avec leurs lèvres. Ils attendent alors que les autres enfants se mettent à danser et sauter. Mais ceux-ci refusent car ils n’ont pas envie de ce jeu. Il leur faut alors entendre la plainte : « nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé ».
Alors les premiers enfants disent en quelque sorte : « si vous ne voulez pas jouer à ce jeu drôle, jouons à un jeu triste, à l’enterrement ! » Et ils se mettent à imiter de nouveau les adultes, et commencent à faire tout haut des lamentations et des complaintes. Matthieu 9 v. 23 montre que c’était effectivement l’usage en Israël. On faisait même venir des personnes spécialisées qui s’y connaissaient en lamentations et en chants de douleur (Amos 5 v. 16). De telles pleureuses faisaient le tour des rues (Ecclésiaste 12 v. 5). Mais les autres enfants ne veulent pas non plus jouer à ce jeu-là. Ils refusent de pleurer et de se frapper la poitrine en signe de deuil, car tel est le sens du terme « complaintes » utilisé par Matthieu (11 v. 17). Et de nouveau on leur fait le reproche : « nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés ».
Manifestement l’un des groupes d’enfants prend un rôle de meneur dans les jeux, et lance l’idée de ce qu’on doit jouer. Devant le refus des autres, ils passent au jeu correspondant, mais complètement inverse. Et quand les autres ne se plient par à leur volonté, et ne veulent ni d’un jeu ni de l’autre, ils s’en plaignent tout fort auprès d’eux. Voilà, dit à peu près le Seigneur, cette génération est justement semblable à ces enfants (voir Matthieu 11 v. 16).
Le Seigneur commence par une double question : « À qui comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils ? » ; cette double question souligne la gravité avec laquelle Il établit la comparaison. C’est comme si, après avoir posé Sa question, Il avait observé un petit temps d’arrêt pour donner l’occasion à Ses auditeurs de se faire une idée de la réponse à donner. Mais alors, Il dit Lui-même à qui Il les compare : aux enfants entêtés du premier groupe.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ENFANTS TÊTUS (3) - Image ni du Seigneur et de Jean, mais du peuple Juif.
« Car Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites : Il a un démon. Le fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants (Luc 7 v. 33 à 35) ». Par ces paroles, le Seigneur applique cette parabole aux Juifs d’un côté, et à Jean le baptiseur et à Lui-même de l’autre côté. Le « Car » au début du v. 33 a conduit bien des commentateurs à expliquer que les enfants jouant de la flûte ou chantant des complaintes symbolisent Jésus et Jean (l’un mangeait et buvait, et l’autre pas), et que les autres enfants qui ne les suivaient pas étaient une image du peuple désobéissant.
Mais cette interprétation n’est pas en harmonie avec les paroles du Seigneur introduisant la parabole : « À qui comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? » Il ne dit pas : « À qui me comparerai-je, Moi et "Jean ? » Il poursuit en disant « Ils sont semblables à des enfants… ». Il ne se représente pas non plus, Lui et Jean, comme ceux qui passent d’un extrême à l’autre, et se plaignent ensuite de ce que le peuple n’accompagne pas ces revirements. Il est aussi frappant de ce que dans l’image, le son de la flûte est nommé en premier, et les complaintes ensuite, tandis que dans l’application qu’en fait le Seigneur, Il commence par parler de Jean le baptiseur prêchant la repentance, et ensuite de Lui-même. Non, ces enfants têtus ne sont une image ni du Seigneur et de Jean, ni de leur service, mais du peuple Juif.
Ils se comportaient comme des enfants insensés et têtus. Quand Dieu leur envoya Jean le baptiseur, il était décidément trop sérieux pour eux. Ils voulaient qu’on « joue de la flûte », ils voulaient que tous se réjouissent avec eux et « dansent ». Quand Jean refusa, et ne mangea ni ne but avec eux, mais plutôt prêcha la repentance, ils lui collèrent sans hésiter l’étiquette de « possédé par un démon (Luc 7 v. 33) », et se détournèrent de lui. Ils voulaient de la « noce », avoir de la joie, sans repentance ni conversion.
Alors le Seigneur Jésus vint à eux, et avec Lui des jours de joie et de bénédiction, s’ils s’étaient repentis à la prédication de Jean. Mais ils allèrent à sa rencontre avec un esprit d’« enterrement ». Ils jeûnaient pendant que l’époux était présent (comparer la parabole de la présence de l’époux, en Matthieu 9), ils insistaient sur une observance stricte de la loi, mais rejetaient la grâce apparue en Christ. Ce qu’ils exigeaient de la part de Jean, ils le condamnaient chez Jésus. Car si Jean « ne mangeait ni ne buvait », le Fils de l’homme s’abaissa à manger et à boire avec les publicains et les pécheurs. Quand le Seigneur Jésus ne voulut pas « chanter des complaintes », pour reprendre le langage de la parabole, il rencontra Lui aussi l’indignation des « enfants têtus ». Ils allèrent même jusqu’au point de Le traiter avec mépris de mangeur et de buveur, et d’ami des publicains et des pécheurs.
Ainsi « cette génération » avait sous les yeux à la fois Jean le baptiseur et le Fils de l’homme Lui-même, et elle les condamnait tous les deux. Effectivement aux yeux des gens de l’époque comme à ceux d’aujourd’hui, ce que Dieu fait est pratiquement tout faux. On ne veut ni Sa justice ni sa grâce. Si Dieu appelle à la repentance, pour beaucoup de gens c’est trop sérieux et ils n’écoutent pas. Et s’Il leur présente Sa grâce en Christ, pour la plupart des gens c’est trop facile et trop simple, et ils refusent. Derrière tout cela il n’y a rien d’autre que le méchant cœur de l’homme qui est inimitié contre Dieu (Romains 8 v. 7).
Finalement dans ce que les Juifs disaient sur Jean et sur le Seigneur, ils ne se condamnaient qu’eux-mêmes, et comme nous le verrons de nouveau, le jugement de l’homme naturel dans les choses de Dieu ne vaut rien du tout. Il interprète de travers aussi bien la gravité de Jean que la grâce du Seigneur, parce qu’en réalité il ne veut pas les comprendre. Nous avons déjà trouvé ce principe dans la parabole du semeur.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ENFANTS TÊTUS (4) - Les enfants de la sagesse.
Si calomnieux que fût le jugement des Juifs sur le Seigneur et son précurseur, le Seigneur ne s’avise pas de se défendre devant eux. Il ajoute seulement ces paroles remarquables : « et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants ». Que veut-Il dire par-là ? Il avait montré où cela mène de suivre la folie et l’entêtement du cœur de l’homme. Les « hommes de cette génération » ne faisaient que montrer clairement par leur comportement vis-à-vis du Seigneur et de Son précurseur qu’ils étaient des enfants de folie. Il ne le dit pas expressément, mais c’est juste à quoi revient l’enseignement qu’Il veut donner avec cette parabole des « enfants têtus ».
Mais de son côté, la sagesse, aussi, a des enfants. En Proverbes 8 la « sagesse » est présentée comme une personne, et nous pouvons déjà reconnaître en elle le Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament il est parlé nommément de Christ comme étant la puissance et la sagesse de Dieu (1 Corinthiens 1 v. 24). Voilà donc maintenant les enfants de la sagesse, ceux qui suivent la vraie sagesse et qui croient en Christ. Tandis que la grande masse du peuple juif refusait aussi bien Jean le baptiseur que le Seigneur Jésus, il y avait quand même des individus qui accordaient foi au message du premier, comme à la Personne et aux paroles du second. Par-là, la sagesse était justifiée, ou, autrement dit : ils répondaient positivement aux voies de Dieu qu’Il a adoptées en Christ pour leur salut.
C’était justement les « publicains et les pécheurs » qui le faisaient, comme le montre aussi l’exemple de la « femme pécheresse » de Luc 7. Ils manifestaient tous leur sagesse en ce qu’ils ne critiquaient rien, ni chez Jean ni chez le Fils de l’homme. Bien au contraire. Ils trouvaient tout parfaitement en ordre, et ils acceptaient leur message. Combien cela est beau ! Ceux qui voyaient les choses correctement étaient justement ceux qui étaient méprisés des grands de ce monde. Ils comprenaient correctement aussi bien l’appel de Jean à la repentance que la grâce que Jésus apportait. Et quand le Sauveur s’asseyait à côté d’eux, et s’abaissait avec eux, ils savaient l’apprécier, et ne l’interprétaient pas de travers. Ils reconnaissaient plutôt l’amour en action chez Lui, et leur cœur s’enflammait pour Lui.
La signification de tout cela n’a pas changé aujourd’hui. Il s’agissait, à l’époque, des Juifs et de leurs conducteurs religieux, qui refusaient autant l’appel de Dieu à revenir que Sa grâce en Christ. Aujourd’hui il s’agit de la chrétienté, et il y a en elle d’innombrables gens qui, en principe, font la même chose. Ah ! si seulement beaucoup d’entre eux devenaient des « enfants de la sagesse » !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE (qui revient des champs) (1) - Parabole que le Seigneur prononce seulement devant ses disciples.
Luc 17 v. 7 à 10. Nous trouvons là une courte parabole que le Seigneur a prononcée seulement devant ses disciples, juste avant son dernier voyage vers Jérusalem. Au premier abord, sa relation avec les versets précédents n’est pas évidente, mais elle existe pourtant.
La foi comme un grain de moutarde.
Comme le montrent les premiers versets du chapitre, les apôtres éprouvaient, pour marcher dans le chemin que le Seigneur venait de placer devant eux, qu’ils avaient besoin de plus de foi qu’ils n’en avaient alors, un sentiment que nous connaissons certainement tous. C’est ainsi qu’ils lui ont demandé : « Augmente-nous la foi ! (v. 5) ». À cette prière certainement juste, le Seigneur a donné la réponse : « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait (v. 6) ».
Ces paroles du Seigneur sont en effet mal comprises et mal interprétées de plusieurs manières. C’est ainsi, par exemple, que certains commentateurs estiment que le Seigneur parle ici d’une « foi charismatique », d’une foi donc par laquelle on peut opérer des guérisons, accomplir des miracles et transporter des montagnes (1 Corinthiens 12 v. 9, 10, 28 ; 13 v. 2). D’autres comprennent qu’il s’agit d’un sérieux blâme envers la petitesse de la foi des disciples.
Je ne crois pas cependant que ces explications soient satisfaisantes. Car pour les premiers, peut-on vraiment déduire de ce passage que les apôtres priaient à ce moment-là pour avoir plus de foi, afin de pouvoir opérer de plus grands miracles ? Était-ce là le genre de foi nécessaire pour ce dont le Seigneur Jésus avait parlé ? S’ils devaient ne donner lieu à aucun scandale, s’ils devaient prendre garde à eux-mêmes, s’ils devaient montrer de la grâce envers les autres et toujours pardonner à leurs frères, avaient-ils besoin, en plus, d’une « foi charismatique » ?
Quant aux autres, le Seigneur ne blâmait pas la petite foi, mais il fortifiait les disciples dans leur foi, si petite pouvait-elle être, et ainsi il l’augmentait. Ils devaient apprendre, comme nous aussi, à faire intervenir Dieu en toute circonstance, c’est là ce que fait la foi, et ils seraient en mesure d’accomplir des œuvres de foi qui, pour l’entendement humain, semblent impossibles. Dieu répond à la plus faible foi, pour autant qu’elle soit réelle, même si elle est petite « comme un grain de moutarde ». En tous cas, Dieu est souverain, et n’est pas limité dans sa grâce. Et si, dans sa grâce, il répond à une foi encore aussi petite, nous ne pouvons en déduire aucun droit d’aucune sorte pour nous. Nous avons là précisément la pensée à la base de la parabole qui suit, et qui la relie aux versets précédents.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE (qui revient des champs) (2) - Le Seigneur fait allusion à deux services chrétiens fondamentaux.
« Mais qui est celui d’entre vous, qui, ayant un esclave labourant ou paissant le bétail, quand il revient des champs, dise : Avance-toi de suite et mets-toi à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire : Apprête-moi à souper et ceins-toi, et me sers jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; et après cela, tu mangeras et tu boiras, toi ? Est-il obligé à l’esclave de ce qu’il a fait ce qui avait été commandé ? Je ne le pense pas (v. 7 à 9) ».
Le Seigneur présente la parabole sous forme interrogative, ce qui la rend plus expressive. Il place ainsi les disciples dans une situation qui les oblige à répondre eux-mêmes aux questions posées. Ils devaient se mettre à la place d’un homme qui a un esclave. Tout le temps et le travail de celui-ci appartiennent au maître. Ainsi, quand l’esclave revient des champs après avoir labouré ou avoir fait paître le bétail, le moment de se reposer n’est encore nullement venu pour lui. Auparavant, il doit encore apprêter le souper de son maître et le servir à table. Le dur travail aux champs et le service à la maison sont-ils considérés comme quelque chose de spécial ou formidable ? Non, ils font partie du travail d’un esclave. Il ne reçoit peut-être pas même de remerciement pour cela. Le maître « est-il obligé à l’esclave de ce qu’il a fait ce qui avait été commandé ? Je ne le pense pas », dit le Seigneur.
En faisant l’application de la parabole aux apôtres et à nous-mêmes, il faut faire attention aux activités de l’esclave dans les champs : labourer et paître. Le Seigneur ne les a certainement pas choisies sans intention. « Vous êtes le labourage de Dieu », écrira plus tard l’apôtre Paul aux Corinthiens, en prenant l’image de la mise en état d’un champ (1 Corinthiens 3 v. 9). L’apôtre avait planté et Apollos avait arrosé (v. 6), ces deux activités étant précédées du labourage, du brisement et de la préparation de la terre des cœurs, un dur travail en effet ! Est-il aujourd’hui moins difficile et moins important qu’alors ? Accomplissons-le si le Seigneur nous y a appelés ! Et souvenons-nous à ce sujet que seul le soc de la charrue de la parole de Dieu peut opérer le résultat désiré dans les cœurs et les consciences. Toutes les ressources humaines sont sans effet à cet égard.
Le Seigneur parle aussi de paître. Cela nous rappelle le service confié à l’apôtre Pierre (Jean 21 v. 15 à 17). Paître et veiller sur le troupeau de Christ est d’une valeur inestimable ; mais c’est aussi un service difficile qui ne peut être accompli qu’en regardant au Seigneur et dans la puissance du Saint Esprit. Ainsi, par ces deux activités de l’esclave, le Seigneur fait allusion à deux services chrétiens fondamentaux : la préparation du cœur pour recevoir la parole de Dieu et les soins à ceux qui lui appartiennent.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE (qui revient des champs) (3) - La clé de cette parabole réside précisément en ce que le Seigneur parle de notre attitude envers lui, et non pas de son attitude envers nous.
Le service d’un esclave est donc quelque chose qui va de soi et qui ne nécessite pas même un remerciement. Alors le Seigneur Jésus applique la parabole à ses disciples : « Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; ce que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait (v. 10) ».
Considérons d’abord ce que le Seigneur dit à ses disciples, puis nous porterons notre attention sur ce qu’il ne leur dit pas. La clé de cette parabole réside précisément en ce que le Seigneur parle de notre attitude envers lui, et non pas de son attitude envers nous.
Même si notre foi a été beaucoup augmentée, et même si nous avons été par là rendus capables d’accomplir l’œuvre du Seigneur, cela ne nous autorise nullement à revendiquer quelque chose pour nous. Même si nous avons fait tout ce qui nous a été commandé, nous devons garder l’intime conviction que nous sommes des esclaves inutiles. Inutile ne signifie pas dont on peut se passer. Car la parabole montre que le Seigneur veut utiliser ses esclaves, et non pas qu’il peut faire sans eux. Nous devons nous considérer comme des esclaves inutiles parce que nous n’avons fait que ce que nous étions obligés de faire, et par conséquent nous ne pouvons rien revendiquer auprès du Seigneur. Nous n’avons pas acquis de droit particulier auprès du Seigneur par notre service ; cela est vrai même pour le serviteur le plus estimé et le plus fidèle. La pensée souvent nourrie secrètement dans nos cœurs que le Seigneur nous est redevable en quelque chose à cause de notre service, est dépourvue de tout fondement. Et en outre, l’amour pour le Seigneur ne va-t-il pas dépasser la pure obligation, et ne va-t-il pas faire aussi ce qu’Il n’a pas commandé directement ?
Il est bien clair que le Seigneur ne parle pas ici d’un esclave paresseux, de quelqu’un de négligent et nonchalant dans l’œuvre du Seigneur ; s’il ne fait pas ce qui lui est demandé, il n’est pas alors un esclave inutile, mais un esclave paresseux. Nous n’avons pas non plus à soulever la question de savoir s’il y a jamais eu un serviteur du Seigneur qui ait « fait toutes les choses » qui lui avaient été commandées, effectivement et sans exception. Il n’y en a pas. Même un serviteur aussi fidèle que l’apôtre Paul était convaincu qu’il n’était pas justifié par le fait qu’il n’avait rien sur la conscience (1 Corinthiens 4 v. 4). Le Seigneur présente en tous cas un cas qui était parfait à cet égard. Et malgré cela, l’esclave ne reçoit aucun remerciement particulier.
Les raisons pour lesquelles nous avons été placés dans la position d’esclave du Seigneur, et avons par conséquent le devoir de faire tout ce qu’il nous commande, ne nous sont pas présentées dans cette parabole, mais on les trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Par exemple : « Car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps (1 Corinthiens 6 v. 20) ». « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité (2 Corinthiens 5 v. 15) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE (qui revient des champs) (4) - La clé de cette parabole réside précisément en ce que le Seigneur parle de notre attitude envers lui, et non pas de son attitude envers nous.
Jusqu’ici, nous avons considéré notre côté, ce que nous devons dire : « Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; ce que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait ». C’est la manière dont nous avons à parler. Il n’est pas dit que le Seigneur parle de cette manière.
C’est réjouissant de le constater. Car cela laisse place à la pensée que notre Seigneur et Maître est infiniment bon et que justement, il n’agira pas comme l’homme de cette parabole. C’est pourquoi aussi le Seigneur Jésus ne commence pas la parabole en disant : « Un homme avait un esclave… ». Par la question : « Qui est celui d’entre vous, qui, ayant un esclave… », il nous montre plutôt comment nous sommes portés à agir envers ceux qui travaillent pour nous. Cependant LUI agira différemment, chers amis.
D’autres passages de la parole de Dieu le montrent très clairement. Si nous n’avions que cette parabole, nous devrions en conclure que notre travail pour le Seigneur demeure non rémunéré. Nous trouvons ainsi une confirmation de ce que nous avons déjà dit au début de nos explications sur les paraboles : de façon générale, une parabole ne comprend qu’une seule pensée principale, une seule ligne d’enseignement. Nous avons vu quel est l’enseignement ici : notre service est quelque chose qui va de soi, et il nous faut en rester toujours conscients. Nous n’avons aucun droit à faire valoir auprès du Seigneur.
Mais il y a certainement aussi le côté du Seigneur. Et si nous nous en tenons simplement aux paraboles, nous y voyons clairement que le Seigneur récompensera la fidélité dans le service et le travail fait pour lui. C’est ce que nous trouvons dans la parabole des ouvriers loués pour la vigne, de même que dans les paraboles des talents et des mines (Matthieu 20 v. 1 à 16 ; 25 v. 14 à 30 ; Luc 19 v. 11 à 27). Toutefois, sa récompense sera pure grâce, nous n’avons rien à revendiquer. Il agira ainsi parce qu’il demeure fidèle à lui-même et que sa bonté est infinie. C’est pourquoi, de notre côté, l’amour pour notre Seigneur est le seul vrai mobile pour le service pour Lui, non pas le désir d’être rémunéré.
En comparant les trois paraboles que nous venons de mentionner avec celle qui nous occupe, on arrive à une constatation supplémentaire : il y aura un temps de repos de tout le travail que nous avons fait pour le Seigneur ici-bas sur la terre. Un jour, l’esclave « reviendra des champs ». Alors même qu’il aura encore à faire à la maison, car nous ne serons certainement pas inactifs au ciel, mais nous servirons éternellement le Seigneur (Apocalypse 22 v. 3), le travail aux champs avec toute la peine qui s’y rattache aura cessé pour toujours. Bienheureuse certitude !
Comme si ce bonheur ne suffisait pas, nous pouvons faire encore une autre comparaison. Dans notre parabole, le Seigneur Jésus fait dire au maître de l’esclave : « Ceins-toi, et me sers jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ». Mais que dire, quand nous entendons le Sauveur parler de ces esclaves qui l’ont servi fidèlement et qui l’ont attendu : « Bienheureux sont ces esclaves, que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu’il se ceindra et les fera mettre à table, et, s’avançant, il les servira (Luc 12 v. 37) ». Quand le travail aux champs sera terminé pour les esclaves et que le Maître sera de retour dans sa maison, alors il montrera son amour et sa condescendance incomparables en se ceignant et en servant ceux qui l’auront servi. Il nous fera jouir de la gloire de la maison de son Père. Quelle grâce qui dépasse ce que nous pouvons comprendre ! Combien cela est digne de Toi, Seigneur Jésus !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE FIDÈLE (ou serviteur) (1) - Le service auprès des saints.
« Qui donc est l’esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable ? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu’il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu’il l’établira sur tous ses biens (Matthieu 24 V. 45 à 47) ». C’est par une question pénétrante que le Seigneur introduit la première parabole : « Qui donc est l’esclave fidèle et prudent… ? » Ceci nous rappelle une parole de l’apôtre Paul : « Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c’est qu’un homme soit trouvé fidèle (1 Corinthiens 4 v. 2) ». C’est donc entièrement une question de responsabilité. Les trois paraboles ont toutes en commun cette pensée de base, même si le point de vue est chaque fois différent.
La parabole elle-même traite d’un esclave établi par son maître (ou : Seigneur) sur ses domestiques, sur les gens de sa maison. Selon l’intention exprimée par son Seigneur, l’esclave a reçu cette position pour qu’il donne aux autres esclaves et servantes de Sa maison leur nourriture au temps convenable.
Le sens figuré est facile à saisir. Car le Seigneur Jésus a encore aujourd’hui « des domestiques », des serviteurs et des servantes, de ceux qu’Il appelle « les Siens » et qui Lui sont infiniment proches et précieux. Il prend soin d’eux pour qu’ils aient toujours la nourriture convenable au temps convenable. Combien sont heureux les soins du Seigneur glorifié pour Son assemblée (comp. aussi Éphésiens 5 v. 29) !
Mais n’est-il pas remarquable que, parmi les trois paraboles, celle-ci vienne en premier ? Ne devons-nous pas en conclure peut-être que l’intérêt du Seigneur pour Son peuple ici-bas sur la terre tient la première place dans Son cœur ? Nous, les hommes, nous aurions sûrement mis au premier rang la prédication de l’Évangile pour le monde perdu. Et qui oserait émettre le moindre doute sur l’importance de cette activité ? C’est dans la troisième parabole que le Seigneur en parle avec beaucoup d’insistance. Mais s’occuper de ceux qui sont à l’intérieur, en un sens, a la priorité avant de s’occuper de ceux de dehors. Ceci est confirmé par la triple mission confiée à Pierre par le Seigneur ressuscité en rapport avec Ses brebis et Ses agneaux : « Pais mes agneaux » ; « Sois berger de mes brebis » ; « Pais mes brebis » (Jean 21 v. 15 à 17).
Le Seigneur a des gens qui sont « Sa maison » : « Nous sommes sa maison (Hébreux 3 v. 6) ». À l’intérieur de ce domaine, le maître de maison attribue la plus grande importance, dans Son amour, à un service fidèle et intelligent. Voyons-nous les choses pareillement ? Ou bien les besoins spirituels des enfants de Dieu ne sont-ils qu’accessoires pour nous, parce que nos intérêts, notre prédication sont exclusivement tournés vers ceux de dehors ? Si c’était le cas, nous n’aurions pas encore bien compris un caractère essentiel de notre époque. Car un tel service auprès des saints est justement caractéristique du christianisme, alors que le judaïsme ne connaissait rien de semblable. Il y avait bien aussi un « enseignement » en Israël, mais il s’agissait toujours d’un enseignement ou d’une lecture de la loi, une instruction du peuple au sujet de la loi (Deutéronome 33 v. 10 ; 2 Chroniques 17 v. 7 à 9 : Esdras 7 à 10 ; Néhémie 8 v. 7, 8, 18 ; 9 v. 3).
Mais comment cela se situe par rapport à ce qui est relaté en Néhémie 8 : « Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu’on lisait (Néhémie 8 v. 8) » ? N’était-ce pas une sorte d’« exposé » (Actes 28 v. 23 ; 2 Timothée 2 v. 15) au sens du Nouveau Testament ? Non, il s’agissait bien plutôt d’une traduction. Durant leur captivité, les Juifs avaient perdu leur langue d’origine, l’hébreu, et avaient adopté à la place, comme langue courante, l’araméen de leurs oppresseurs, qui était une langue apparentée. Or la loi était rédigée en hébreu comme presque tout l’Ancien Testament, ce qui fait que les Juifs ne comprenaient plus correctement ce qui était lu. C’est pourquoi les lévites, restés familiers avec l’hébreu, leur donnaient le sens de ce qui était lu. C’est aussi pourquoi il est dit au verset 12 : « Car ils avaient compris les paroles qu’on leur avait fait connaître ». Le verset 13 v. 24 confirme également les difficultés linguistiques des Juifs revenus de Babylone.
Quelle différence avec l’enseignement donné à l’époque chrétienne au sujet de la loi et de ses commandements et du service ! Aujourd’hui le Saint Esprit conduit dans toute la vérité, et Il annonce les choses qui vont arriver, et Il glorifie Christ. Il prend de ce qui est au Seigneur Jésus et nous le donne (Jean 16 v. 12 à 15). C’est une véritable « nourriture ». Il n’y a rien de comparable dans la dispensation juive. Bien sûr, le service lui-même ne peut être accompli qu’au moyen de la parole de Dieu, comme les apôtres l’exprimaient déjà au début de l’ère chrétienne : « et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole (Actes 6 v. 4) ». Et si le service est accompli dans l’esprit du Maître et sous la conduite du Saint Esprit, l’esclave fidèle et prudent saura donner du lait aux « enfants » et de la nourriture solide aux « hommes faits », exactement selon les besoins (1 Corinthiens 3 v. 2 ; Hébreux 5 v. 12 à 14). C’est ce que le Seigneur veut dire ensuite par les mots « faisant ainsi », et c’est ce qu’Il apprécie tant.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE FIDÈLE (ou serviteur) (2) - Responsabilité vis-à-vis du Seigneur.
Il y a encore autre chose à apprendre de cette parabole simple : L’esclave appelé à ce service ne reçoit sa mission que du Seigneur, non pas des hommes, quels qu’ils soient, ni de l’assemblée. L’autorité pour faire ce service ne vient que du Seigneur ; Lui seul peut établir l’esclave sur Ses « domestiques ». Instruit lui-même dans la parole, il est maintenant appelé à enseigner d’autres. C’est plus tard dans les épîtres que nous apprenons que Christ exalté a donné des dons à Son assemblée : « et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ; en vue du perfectionnement des saints, pour l’œuvre du service, pour l’édification du corps de Christ (Éphésiens 4 v. 11 et 12) ».
Et comme la mission et l’autorité viennent du Seigneur seul, ainsi l’esclave n’est responsable dans son service que devant le Seigneur. Aucune instance humaine ne pourrait s’en mêler. Le service auprès des saints est une affaire divine, et il s’exécute sous le regard du Seigneur. C’est la raison pour laquelle dans notre parabole, tout tourne autour de la manière dont le maître, à sa venue, juge l’attitude de Son serviteur.
Nous arrivons par là à une autre question. Qu’est-ce qui rend l’esclave capable de servir de la bonne manière ? Qu’est-ce qui le fait poursuivre fidèlement en dépit de toutes les difficultés qui se rattachent au service ? C’est l’espérance que son Seigneur revient et qu’il y aura une rémunération pour toutes les peines. « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi (Apocalypse 22 v. 12) ». Si nous aimons le Seigneur Jésus, nous attendrons ardemment Son retour, et en attendant, nous nous consacrerons à un service d’amour envers ceux qu’Il aime de manière si inexprimable.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE MÉCHANT (ou serviteur) (3) - Responsabilité vis-à-vis du Seigneur, deux groupes d’ouvriers.
Mais il y a aussi un autre côté du tableau, le côté sombre. Nous le retrouverons dans les deux paraboles suivantes : « Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur : Mon maître tarde à venir, et qu’il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu’il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu’il n’attend pas, et à une heure qu’il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites : là seront les pleurs et les grincements de dents (Matthieu 24 v. 51) ». Comme le Seigneur parle de « ce méchant esclave-là », beaucoup se sont demandés : d’où vient-il donc, ce méchant esclave-là. Pourquoi dit-Il : « ce … là » ? De qui parle-t-Il ?
Comprenons d’abord que l’esclave fidèle et le méchant esclave ne représentent pas des individus, mais différents groupes de serviteurs. L’esclave fidèle et prudent symbolise le groupe des serviteurs fidèles du Seigneur au temps du christianisme, le méchant esclave le groupe des serviteurs infidèles, indignes. Par contre, dans la troisième parabole nous avons bien l’aspect individuel des ouvriers, mais pas ici. Il est extrêmement utile de considérer ces précisions.
La conjonction « si » est un « si » d’expectative. Le Seigneur prévoit de Son œil spirituel un changement néfaste des serviteurs dans la sphère chrétienne. Ce changement concerne le caractère des serviteurs, non pas leur position, et il a pour origine l’abandon de l’espérance du retour du Seigneur. En ce qui concerne la position, le méchant esclave est vu et traité de la même manière que l’esclave fidèle. Ceci veut dire que tous les deux sont vus comme établis sur les domestiques, et qu’ils en sont donc tous les deux responsables. Mais c’est le caractère de l’esclave qui change : Il est devenu un méchant esclave. C’est dans ce sens-là que le Seigneur considère le méchant esclave comme étant le même esclave, et dit à cause de cela : « Mais si cet esclave-là… ». Nous avons la même manière de voir dans la parabole du « grain de moutarde », où le petit grain de semence, quoique semé par le Seigneur Lui-même dans Son champ, devient un grande arbre et offre une demeure aux oiseaux du ciel (Matthieu 13 v. 31 et 32).
Nous pensons parfois que les méchants esclaves ne sont pas du tout des serviteurs du Seigneur. Mais le Seigneur nous enseigne autre chose dans cette parabole. Ce n’est pas seulement le méchant esclave lui-même qui dit : « mon maître », mais c’est également le Seigneur qui se nomme Lui-même le « maître de cet esclave » (24 v. 50). Ceci est très remarquable. Si quelqu’un professe être au Seigneur, et être un serviteur du Seigneur, alors il est aussi responsable vis-à-vis de ce Seigneur. Le Seigneur Jésus ne dit pas : « Tu n’es pas mon esclave », mais Il agit avec lui selon sa profession, et selon qu’il a été conforme à cette profession.
Ce principe s’étend à toute la chrétienté. Si quelqu’un professe être à Christ par le baptême ou par la cène ou de tout autre manière, il est aussi responsable vis-à-vis de ce Seigneur, responsable de vivre selon ses enseignements. Le Seigneur ne le libère pas de cette responsabilité si sa profession est vaine et qu’il n’y a pas de vie divine. Si quelqu’un prétend être chrétien, le Seigneur le jugera sur ce terrain-là, non pas comme un païen qui n’a jamais entendu parler de Lui, et qui porte donc une responsabilité bien moindre.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE MÉCHANT (ou serviteur) (4) - Le mal est entré dans l’assemblée par dans le cœur.
Comment le mal est-il entré dans l’assemblée ? Cela a commencé dans le cœur, par l’abandon de l’espérance du retour immédiat de Christ : « Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur : Mon maître tarde à venir… ». Notons que c’est le langage du cœur que seul peut percevoir Celui qui connaît les cœurs. Or c’est là, dans le cœur, que l’évolution funeste a eu son point de départ. Il en est toujours ainsi. Quand Étienne se tenait devant ses accusateurs juifs, il dut leur rappeler leurs pères « qui ne voulurent pas être soumis » à Moïse et donc à Dieu ; « mais ils le repoussèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte (Actes 7 v. 39) ».
Si on aime le Sauveur, il n’y a rien de plus normal et de plus beau que d’attendre ardemment l’accomplissement de Sa promesse de revenir bientôt. Pour un tel chrétien le retour de Christ n’est pas qu’une question doctrinale, mais un besoin du cœur. Les croyants à Thessalonique s’étaient « tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils (1 Thessaloniciens 1 v. 9 et 10) ». Voilà, bien-aimés, ce qui devrait être notre attitude et notre espérance ! Le Seigneur Jésus n’a-t-Il pas dit qu’Il reviendrait pour nous prendre auprès de Lui, afin que là où Il sera, nous, nous soyons aussi (Jean 14 v. 3) ? Cette espérance est sur Son cœur, et elle devrait également être sur le nôtre. Oui, son cœur nous désire, et Il transformera ce désir en réalité. Peut-il donc y avoir de notre côté une autre réponse que celle de chercher du regard Celui qui nous aime ?
Mais il peut en être autrement. Pourquoi est-ce que je parle de nous les enfants de Dieu, alors que c’est le « méchant esclave » qui est devant nos yeux ? Son langage peut-il aussi être le nôtre ? Malheureusement, oui ! Nous pouvons certes ne pas être directement « ce méchant esclave-là », car sa fin est la perdition. Mais nous pouvons tout à fait tenir son langage, avec des conséquences catastrophiques pour nous aussi.
Notons bien que le méchant esclave ne pense pas que son maître ne va pas revenir, mais il repousse cet événement (non désiré) vers un futur éloigné (comp. 2 Pierre 3 v. 4 à 9). Si le diable réussit à faire cela avec nous, la ruine est inéluctable. Peu importe la méthode utilisée par l’adversaire pour arriver à son but. Soit il amène le monde entre nous et Christ, soit il introduit de nouveaux enseignements : par exemple l’opinion selon laquelle les croyants devraient préalablement traverser la grande tribulation (post-tribulationistes), ou l’idée que la venue de Christ ne pourrait avoir lieu qu’après le règne millénaire (post-millénaristes). Le résultat est le même dans les deux cas : L’attente immédiate de Sa venue est relativisée (atténuée), Son retour est repoussé dans le lointain, et en conséquence le cœur perd sa force vive. On s’installe sur la terre ; c’est elle qui devient le domicile (ou : la patrie) de l’âme, non pas le ciel. Et finalement on est même satisfait de penser que Christ ne viendra pas avant longtemps, si tant est qu’on croit qu’Il reviendra un jour.
Dans la chrétienté les choses ont évolué depuis longtemps dans cette direction ; c’est l’état le plus largement répandu. Mais quel avertissement ! ce qui a conduit à cela n’était à l’origine rien d’autre que l’abandon de la bonne manière de penser. Et c’est ainsi que ceux qui auraient dû être fidèles et prudents sont devenus infidèles et méchants. Qu’on comprenne bien cette phrase ! Il n’est pas question ici de savoir si un croyant peut après tout aller à la perdition, ce que l’Écriture nie sans ambiguïté (Jean 10 v. 27 à 30), mais il s’agit dans cette parabole de la responsabilité du serviteur au temps du christianisme.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE MÉCHANT (ou serviteur) (5) - La prétention à une fausse position, gouverner au lieu de servir.
Après avoir perdu la bonne orientation d’esprit, l’étape suivante est la prétention à une fausse position : « et il se met à battre ceux qui sont esclaves avec lui ». Ceci est un changement radical d’un vrai service tel que le Seigneur vient de le décrire (Matthieu 19 v. 29 et 30). Il nous montre là deux grands principes qui devraient être la motivation du vrai serviteur au service : l’amour (« aura quitté…pour l’amour de mon nom ») et l’humilité (« les premiers seront les derniers »). Ici, nous avons au contraire l’élévation du Moi et l’oppression des autres. Il n’est pas difficile de suivre les progrès de cet état d’esprit dans l’histoire de la chrétienté à travers les siècles. Déjà au temps des apôtres, il y avait un homme dont l’apôtre Jean a dû dire : « …qui aime à être le premier parmi eux (3 Jean 9) ». Ce cas a rapidement fait école.
Je ne veux pas dire qu’en principe l’exercice de l’autorité dans l’assemblée soit faux. Au contraire, il est voulu de Dieu. Le Seigneur tient les sept étoiles dans Sa main droite ; Il les a placées pour répandre dans l’assemblée la lumière divine pour conduire et pour enseigner (Apocalypse 1 v. 16 à 20 ; 2 v. 1). Le Seigneur les mesurera selon qu’elles auront répondu à cette position et à ce devoir et se seront soumises en tout à Sa volonté et à Sa parole. Dans ce contexte j’aimerais mentionner que dans l’Écriture sainte le « soleil » est souvent utilisé comme image d’une autorité absolue (Dieu), la « lune » comme image d’une autorité dérivée (l’assemblée) et les « étoiles » comme l’image d’une autorité subordonnée (anges des assemblées), les deux dernières « pour dominer sur la nuit » (comp. Genèse 1 v. 16 ; Psaume 136 v. 9). Dieu attend de Ses serviteurs que Sa volonté soit présentée et réalisée dans l’assemblée avec autorité.
Ces remarques montrent aussi clairement que l’exercice de l’autorité dans l’assemblée n’a strictement rien à voir avec une domination de propre volonté sur elle. Le travail de paître le troupeau de Dieu doit être fait ; la surveillance sur ce troupeau doit s’exercer. Mais l’apôtre Pierre ajoute aussitôt cet avertissement à ceux auxquels le Seigneur a confié un tel service : « non pas comme dominant sur des héritages (1 Pierre 5 v. 1 à 3) ». Quand le Seigneur parlait dans Sa parabole d’esclaves battant les autres, Il vivait ici-bas sur la terre. À peine 70 ans plus tard, Il donnait du ciel au vieil apôtre Jean la mission d’écrire sept lettres à sept assemblées, des lettres qu’Il lui a dictées Lui-même. Dans deux de ces lettres, Il mentionne un certain groupe de gens, les nicolaïtes, et Il parle de leurs « œuvres » et de leur « doctrine » (Apocalypse 2 v. 6 à 15). « Nicolaïtes » signifie « dominateur du peuple » et nous pouvons en déduire que, par cette expression symbolique, le Seigneur visait l’apparition (précoce) d’un système clérical, avec une hiérarchie pyramidale, même s’Il ne voulait pas limiter l’expression à cette pensée.
Ce système ecclésiastique nia rapidement la sacrificature (ou : prêtrise) de tous les croyants, comme l’enseigne l’Écriture sainte (1 Pierre 2 v. 5 à 9), et il mit de côté la libre action du Saint Esprit dans la prédication de la Parole de Dieu. Il introduisit la différence, contraire à l’Écriture, entre clergé et laïcs, ce qui amena la domination sur ces derniers. Seule une certaine classe, recevant une ordination par des hommes, avait le droit de prêcher, d’enseigner et de conférer les soi-disant sacrements (baptême et cène).
Un exemple historique confirme la rapidité avec laquelle ces principes faux ont pris pied dans la chrétienté : Ignace avait été à l’école de l’apôtre Jean et était son ami. Il ne lui survécut guère que sept ans. La veille de sa mort comme martyr, en chemin vers Rome, vers l’an 107, cet homme dévoué, évêque d’Antioche et archevêque de la Syrie, écrivit sept lettres à différentes assemblées. Dans ces lettres, il souligne la soumission des croyants à l’évêque et leur demande « de regarder à l’évêque comme au Seigneur Lui-même ». Il écrit à l’assemblée à Philadelphie : « J’ai crié, lorsque j’étais parmi vous, je vous ai dit bien fort : Écoutez l’évêque et les anciens et les diacres ! » (Andrew Miller, Histoire de l’église).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE MÉCHANT (ou serviteur) (6) - La communion avec le monde, troisième caractéristique du méchant esclave .
Après que les convictions justes ont été perdues et qu’on eut cessé d’attendre la venue du Seigneur, il en est résulté, outre la prétention à une fausse position (ce que nous venons de voir), la communion avec le mauvais côté, ce qui était presque inévitable : « il mange et boit avec les ivrognes ». Il n’est pas dit que le méchant esclave est ivre lui-même, mais il a communion avec ceux qui sont dans cet état. La communion avec le monde : c’est la troisième caractéristique du méchant esclave. « Ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit » dit l’Écriture (1 Thessaloniciens 5 v. 7) ; nous voyons ainsi que la communion avec le monde se traduit par une communion avec les ténèbres. Les « enfants de lumière » sont donc exhortés : « N’ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi ; car les choses qu’ils font en secret, il est honteux même de les dire (Éphésiens 5 v. 11 et 12) ». Car si on s’associe avec le monde et ses principes, comment pourra-t-on le reprendre ?
Manger et boire expriment la communion, que ce soit avec le bien ou avec le mal, un principe dont on retrouve la confirmation dans d’autres passages (comp. 1 Corinthiens 5 v. 11 ; 10 v. 17 à 22). Bien que le méchant esclave ne soit pas ivre, comme nous l’avons remarqué, le Seigneur le voit quand même uni avec ceux qui le sont. Pourquoi ? Parce qu’il « mange et boit » avec eux. Il ne faut pas forcément faire le mal soi-même pour être en communion avec lui. Il suffit souvent d’une participation extérieure. Le Seigneur la juge comme une identification, une assimilation avec le mal. La seule salutation normale peut faire participer aux « mauvaises œuvres » d’un faux docteur (2 Jean 11). C’est la manière de voir de Dieu, et combien peu les enfants de Dieu la comprennent aujourd’hui ! Sinon ils éviteraient et abandonneraient plutôt les relations mauvaises par lesquelles Il est déshonoré. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs (1 Corinthiens 15 v. 33) ».
Au lieu de servir le Seigneur, le méchant esclave s’engage avec le monde, et s’unit à ses voies et ses principes. Aussi, le moment venu, il sera traité comme lui.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESCLAVE MÉCHANT (ou serviteur) (7) - Le méchant esclave sera coupé en deux et recevra sa part avec les hypocrites.
« Le maître de cet esclave-là viendra ». Il ne faut pas confondre la venue du verset 50 avec celle du verset 46. L’esclave fidèle et prudent vit dans l’attente du retour de son Maître. Tout son service s’accomplit en vue de ce moment désiré ardemment depuis longtemps. Mais pour le méchant esclave, la venue du Maître est quelque chose d’inattendu autant que non désiré. Il établira l’esclave fidèle sur tous Ses biens, tandis que le méchant esclave sera coupé en deux et recevra sa part avec les hypocrites.
Ainsi la venue du Seigneur porte un caractère totalement différent dans les deux cas. C’est pour le monde qu’Il vient « comme un voleur dans la nuit » (1 Thessaloniciens 5 v. 2 et 3 ; voir aussi 2 Pierre 3 v. 10 ; Apocalypse 3 v. 3 ; 16 v. 15), mais non pas pour les Siens. Nous apprenons plus tard, en particulier par les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, qu’il s’agit de deux actes différents et de deux moments différents de Sa venue. Mais au moment où parlait le Seigneur, la vérité de l’enlèvement des Saints n’avait pas encore été révélée. Les paroles du Seigneur ici en indiquent cependant déjà le chemin. Il est très heureux de le voir.
Le sort du méchant esclave est d’autant plus solennel. Il sera « coupé en deux », avec une « scie » bien plus terrible que celle avec laquelle David « scia » les fils d’Ammon autrefois (1 Chroniques 20 v. 3). Et comme le méchant esclave est un hypocrite, il prétendait servir le Seigneur, mais ne l’a pas fait, c’est pour cela que le Seigneur lui donnera là sa part : avec les hypocrites.
Arrivé là, le Seigneur abandonne le langage en parabole, et se met à parler directement, littéralement. Il en est de même quand Il décrit plus en détail cette « part avec les hypocrites » : « Là seront les pleurs et les grincements de dents ». Nous retrouvons cet abandon subit du langage en parabole à la fin de plusieurs paraboles, et cela souligne l’immense portée et les lourdes conséquences de ce que la Seigneur place sur les cœurs. Quand on compare entre eux les passages où le Seigneur utilise cette expression solennelle « les pleurs et les grincements de dents » (Matthieu 8 v. 12 ; 13 v. 42 à 50 ; 22 v. 13 ; 25 v. 30 ; Luc 13 v. 28), il apparaît clairement qu’Il parle toujours d’un jugement éternel dans le lieu de tourments. C’est l’enfer, la seconde mort, la séparation éternelle d’avec Dieu.
Que le Seigneur accorde qu’aucun de mes lecteurs n’arrive dans ce lieu effrayant, duquel on ne peut plus s’échapper ! Aujourd’hui est encore un jour de salut, aujourd’hui on peut encore « se tourner vers Dieu », pour venir des ténèbres à Sa merveilleuse lumière.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESPRIT (immonde) (1) - La parabole semble se rapporter à la guérison d’un démoniaque.
Matthieu 12 v. 43 à 45. La parabole de l’esprit immonde semble se rapporter à la guérison d’un démoniaque tout comme la parabole précédente (la maison de l’homme fort, Matthieu 12 v. 22 et suiv.). En tout cas, c’est ce que suggèrent les paroles introductives : « Or quand l’esprit immonde est sorti d’un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n’en trouve point. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui-même ; et étant entrés, ils habitent là ; et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante (12 v. 43 à 45) ».
Toutefois, le Seigneur n’a pas prononcé cette parabole directement à la suite d’un miracle opéré par Lui, comme dans le cas des deux autres paraboles de ce chapitre (la brebis dans la fosse et la maison de l’homme fort). Ces deux dernières servaient à expliquer la signification de Ses miracles. Ici il s’agit au contraire de la demande d’une méchante génération de voir un signe. Le Seigneur n’avait-il pas fait le miracle remarquable de la guérison du démoniaque, et les pharisiens ne l’avaient-ils pas attribué au diable ? Au lieu de croire, ils demandaient encore un autre signe. On s’étonne comment, après tous les miracles puissants opérés par le Seigneur, ils pouvaient encore avoir l’audace de dire : « Maître, nous désirons voir un signe de ta part (12 v. 38) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESPRIT (immonde) (2) - Deux signes solennels : convaincus ou jugés ?
N’avaient-ils pas assez vu de signes et de miracles ? À cet égard, il est peut-être instructif de remarquer que non moins de 33 miracles du Seigneur sur les 46 qui sont rapportés ont eu lieu en Galilée. Non, aucun signe supplémentaire ne les convaincrait. C’est pour cela que le Seigneur leur donne un ou deux signes appropriés pour les juger. « Mais lui, répondant, leur dit : Une génération méchante et adultère recherche un signe ; et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n’est le signe de Jonas le prophète. Car, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé trois jours et trois nuits, ainsi le fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas (12 v. 39 à 41) ».
C’était le premier signe. Jonas fut le premier et le seul prophète à être envoyé aux nations avec un message de la part de Dieu. Mais avant de remplir correctement sa mission, il dut symboliquement passer par la mort et la résurrection. De la même manière le Fils de l’homme passerait Lui aussi par la mort, et en tant que ressuscité d’entre les morts, Il apporterait aux nations la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais si le Messie était retranché, quelle espérance resterait-il pour cette génération méchante et adultère ? Le fait que les hommes de Ninive aient prêté l’oreille au message du prophète et se soient inclinés devant lui, renforcerait d’autant plus le jugement solennel des hommes d’Israël, puisque ceux-ci rejetaient le message d’un plus grand que Jonas.
En outre, il y avait encore un deuxième signe, pour ainsi dire : la force d’attraction de la sagesse de Salomon sur la reine de Sheba. « Une reine du midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon (12 v. 42) ». La gloire de cette sagesse (voir 1 Rois 10) avait suscité dans son cœur quelque chose d’encore plus précieux que la repentance des Ninivites : elle l’avait amenée en présence du grand roi. Et quel en avait été le résultat ? Tous les désirs de son cœur furent plus que satisfaits. Et qu’en était-il maintenant ? Quelqu’un d’incomparablement plus grand que Salomon était au milieu de Son peuple, et ils avaient le privilège d’être en Sa présence. Ce n’était rien moins que Celui qui avait donné à Salomon toute sa sagesse, toute sa richesse et toute sa gloire. Mais eux ne voyaient « pas d’apparence en Lui pour le faire désirer (Ésaïe 53 v. 2) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESPRIT (immonde) (3) - Une image de l’idolâtrie.
Sur ces entrefaites, Il décrit d’abord leur état actuel dans la parabole de « l’esprit immonde ». L’esprit immonde (une image de l’idolâtrie) avait effectivement quitté « l’homme », Israël, pour un temps. Il semble que, parmi tous les efforts de Satan pour éloigner les hommes de Dieu, l’idolâtrie ait été la forme de mal ayant le mieux réussi. L’Écriture sainte ne mentionne pas l’idolâtrie avant le déluge. À cette époque, le diable se servait des passions sans frein de l’homme, comme les premières pages de la bible en donnent un aperçu. Une fois l’épée de la justice mise entre les mains de Noé et de ses fils, la violence physique fut certes enrayée, mais le mal moral continua son cours sans retenue. Et comme les hommes n’avaient pas de sens moral pour garder la connaissance du vrai Dieu (Romains 1 v. 28), et qu’ils avaient quand même besoin d’un dieu quel qu’il soit, ils se firent leurs propres dieux sous la direction de Satan. Ils les firent comme leurs cœurs méchants les désiraient. Ils leur prêtèrent tous les méchants caractères qui remplissaient leurs propres cœurs. L’idolâtrie sous toutes ses formes eut tôt fait de pénétrer tout le monde connu alors.
Dans Sa grâce Dieu choisit Abraham, et le fit sortir de l’idolâtrie. Il allait devenir le père des croyants. Mais « l’esprit immonde » dans toute son efficacité pernicieuse, n’épargna pas la race élue. L’Écriture nous montre que la maison même de Jacob avait toléré l’idolâtrie. Et pendant la traversée du désert, le peuple s’y livra, et même sous le règne du roi le plus sage, elle fut maintenue. Enfin Manassé, roi de Juda et fils du pieux Ézéchias, fit pis que tous ceux qui avaient été avant lui. Il suffit de lire l’histoire de ses actes abominables en 2 Rois 21 ! Dieu prononça alors finalement le jugement sur Jérusalem, et la ville ne tarda pas à être « écurée comme on écure un plat (2 Rois 21 v. 13) » : les fils de Juda furent chassés en tant qu’héritage de l’Éternel, et furent livrés en la main de leurs ennemis et emmenés en captivité à Babylone.
Depuis ce temps jusqu’à maintenant, on n’a plus trouvé d’idolâtrie parmi les Juifs. C’est ce que le Seigneur veut exprimer en disant que l’esprit immonde est sorti de cet homme. Ils avaient « balayé et orné » leur maison. Cela ne veut pas dire que d’autres formes de mal ne se trouvaient pas parmi eux ; mais quant à l’idolâtrie d’autrefois, ils en avaient purifié leur maison. Ils l’avaient même richement dotée des formes religieuses d’une piété extérieure, ils l’avaient « ornée », comme dit le Seigneur. Bien sûr les Juifs étaient très contents d’eux-mêmes et de leur piété, comme le sont toujours les hommes religieux avec leurs formes vides. Seulement ils ne remarquaient pas que Dieu n’y était plus. Et quand Il revint encore une fois vers eux dans la personne de Son Fils Jésus Christ, ils Le rejetèrent. La conséquence en était désormais l’imminence de la rupture avec eux. Se doutaient-ils un peu de ce que cela signifiait, pour le présent et pour le futur proche et lointain ?
Le Seigneur lève ici un peu le voile, et laisse voir à eux et à nous, des choses qui font frissonner. L’esprit immonde traverserait des lieux secs, chercherait du repos, mais n’en trouverait pas. Il avait besoin d’un lieu pour s’installer ; oui, il avait besoin d’une « maison » telle que le peuple juif : balayée et ornée, avec une profession de Dieu, avec beaucoup de piété extérieure, mais en réalité sans Dieu. Tel était le « terrain fertile », la « maison » appropriée pour qu’il s’y déploie. Le Seigneur Jésus prédit qu’il retournerait ainsi dans sa maison, et montre qu’en réalité cet esprit méchant n’avait jamais abandonné « "sa" maison », et qu’il amènerait avec lui sept autres esprits plus méchants que lui-même. Ensemble, ils prendraient possession de la maison et y habiteraient, « et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première ».
Le Seigneur fait allusion par là au temps de la fin et au sort de cette « génération méchante et adultère ». Non seulement l’idolâtrie prendra de nouveau possession du peuple juif coupable, mais aussi du monde chrétien ; mais des formes de mal encore plus graves y trouveront également domicile. Ne recevant pas Celui qui était venu au nom de Son Père, ils recevraient un autre, venu en son propre nom, l’antichrist, l’homme de péché (Jean 5 v. 43). Par le moyen de ce personnage, l’homme s’assiéra dans le temple de Dieu (temple qui peut représenter l'Eglise) et se fera apporter l’adoration divine ; il « se présentera lui-même comme étant Dieu (2 Thessaloniciens 2 v. 3 et 4) ». On rendra hommage à l’antichrist aussi bien qu’à l’image de « la première bête », le chef de l’empire romain (Apocalypse 13 v. 11 à 18), et ceux qui le feront seront les hommes, la nation ayant la plus grande intelligence de la terre !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• ESPRIT (immonde) (4) - Conclusions pratiques.
Quand l’homme est sous le contrôle de Satan et est abandonné aux convoitises de son méchant cœur, il n’y a alors effectivement aucune forme de mal à laquelle peut échapper même l’homme le plus intelligent, ni le monde entier si hautement civilisé. Combien sommes-nous heureux aujourd’hui d’être encore au temps de la grâce, où Dieu agit encore aujourd’hui par Son Esprit et par Sa parole, et fait briller la lumière de l’évangile ! Pourtant l’avertissement du Seigneur s’adresse à nous tous : « L’esprit immonde » viendra, et avec lui le temps où plus personne ne pourra travailler (Jean 9 v. 4). De profondes ténèbres morales régneront alors sur ce monde, et tout sera livré à la puissance directe de Satan. Combien il est meilleur, chers amis, d’avoir Dieu et Sa parole pour guide, et non pas Satan ni les convoitises de notre cœur !
Nous apprenons donc une nouvelle fois que, même des paraboles qui visent clairement et prophétiquement Israël, sont quand même remplies d’avertissements et d’instructions pour les croyants comme pour les non croyants d’aujourd'hui, pour l’individu comme pour la collectivité. Par exemple, avons-nous appris l’inutilité absolue de vouloir maîtriser extérieurement un mal quelconque, et combien l’apport de simples réformes extérieures est peine perdue ? Si on ne le fait pas avec Dieu, si on ne le surmonte pas avec Dieu, rien n’est vraiment gagné. Le peuple juif avait certes réformé et balayé sa maison, et pourtant ce n’était que le premier pas vers quelque chose de pire.
Ceci peut également être l’image de quelqu’un qui rompt avec une mauvaise habitude pour un temps, sans toutefois recevoir Christ dans son cœur. En agissant ainsi, il s’est borné à faire de la place pour l’esprit méchant qui reviendra avec du renfort. Au lieu d’aller vers une amélioration, les choses empireront pour cette personne. Sans une œuvre de Dieu véritable dans le cœur, il y aura tôt au tard endurcissement, et Satan gagnera d’autant plus de puissance sur l’homme.
La maison d’Israël ornée n’est-elle pas aussi une image frappante de la maison de la chrétienté professante ? Ne se contente-t-on pas aussi ici de beaucoup de formes et réformes extérieures, sans qu’on se rende compte que le Seigneur Jésus est dehors, hors du système créé par l’homme ? On se vante d’être riche, riche en biens spirituels et terrestres, riche en influence et en intelligence, riche en dignité et en fonctions dont on est investi, riche en efforts sociaux, culturels et humanitaires, riche en efforts pour l’amélioration du monde, riche en doctrine biblique. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est fait est sans valeur. Bien des activités et attitudes généreuses conviendraient aussi aux enfants de Dieu. Mais tout cela est fait sans Dieu, et c’est la raison pour laquelle le Seigneur doit dire à Laodicée : « Parce que tu dis : Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu ». Ce système sans vie sera finalement vomi de Sa bouche (Apocalypse 3 v. 16 et 17).
Le chemin de la chrétienté sans le gouvernement de Christ ressemble à celui du judaïsme sans Christ. Ils se rencontreront sous le règne impitoyable de l’antichrist. Tous les privilèges de la foi judaïque seront alors abandonnés, et aussi ceux de la foi chrétienne (1 Jean 2 v. 22). Et comme les esprits méchants habiteront la maison juive, de même aussi « Babylone », l’église mondaine du temps de la fin deviendra « la demeure de démons » et le « repaire de tout esprit immonde » (Apocalypse 18 v. 2).
Quelle signification profonde et vaste se trouve contenue dans les simples paroles du Seigneur Jésus ! Puissions-nous les prendre à cœur, ainsi que les avertissements qui y sont contenus ! Lui nous familiarise avec la fin de ce mouvement que nous ne pouvons pas saisir dans son ensemble. Son point de vue est toujours le bon. C’est là qu’il faut mettre notre confiance, et non pas dans ce que disent les hommes !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• EXCUSES - Le Seigneur met en évidence divers moyens que l’ennemi emploie pour empêcher les âmes de venir à Lui.
« Le grand souper » (Matthieu 22 v. 1 à 14 ; Luc 14 v. 16 à 24). Dans Luc, les conviés « commencèrent tous unanimement à s’excuser ». L’un avait acheté un champ : apprécier son bien devait nécessairement prendre place avant l’invitation de son hôte. Un autre avait acquis cinq couples de bœufs et devait les essayer. C’étaient les instruments de son travail. L’activité journalière forme souvent prétexte pour ne pas venir à Christ : on n’a pas le temps de penser à Lui ; il y a tant de choses à faire. Le troisième avait épousé une femme. Piège combien fréquent aux mains de l’ennemi pour détourner un cœur disposé à s’approcher du Seigneur ! Une affection pour une personne qui ne Le connaît pas, lie, et pour toujours peut-être, éloignera de Lui.
Matthieu nous donne le secret de ces excuses, en disant tout simplement : « Ils ne voulurent pas venir (Matthieu 22 v. 3) ». Le Seigneur Jésus reprochait aux pharisiens : « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Au dernier chapitre de la Bible, retentit encore l’appel : « Que celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• ENCENS - Il typifie la manière dont l'Esprit de Christ s'exprime envers Dieu.
« Et l'Éternel dit à Moïse : Prends des drogues odoriférantes, du stacte, et de la coquille odorante, et du galbanum, des drogues odoriférantes, et de l'encens pur : de tout, à poids égal (Exode 30 v. 34) ». « L'encens » qui est le sujet suivant est très important, car je comprends qu'il typifie la manière dont l'Esprit de Christ s'exprime envers Dieu. C'est un Esprit d'interces, un Esprit de prière, un Esprit d'doration, ce qui devait être brûlé sur l'autel d'or, « un encens continuel devant l'Eternel, en vos générations (Exode 30 v. 8) ». Je pense que tout ce qui est de l'Esprit de Christ dans les saints s'exprimera d'abord envers Dieu en prière. C'est une chose merveilleuse que d'avoir l'Esprit de Christ. C'est ce qui distingue un saint de toute autre personne dans le monde.
Veillons plus que jamais à ce que l'Esprit de Christ soit en évidence et qu'Il le soit avant tout, dans le secret avec Dieu. Je suis persuadé qu'il y aurait un grand élargissement, qui se traduirait par de saints exercices d'affections envers Dieu, si nous nous attachions davantage à assurer la liberté de l'Esprit de Christ. « Et tu en pileras très-fin, et tu en mettras sur le devant du témoignage dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi : ce vous sera une chose très-sainte. Et quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez point pour vous selon les mêmes proportions: il sera, pour toi, saint, consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le flairer, sera retranché de ses peuples (Exode 30 v. 36 à 38) ».
Il est possible de considérer ces diverses choses en détail. L'écriture parle de certaines de ces drogues odoriférantes que l'on réduisait en poudre (Exode 30 v. 36). Quelque trait de Christ impressionne et attire votre cœur ; vous voudriez bien en éprouver la grâce et la puissance ; vos désirs à cet égard s'expriment devant Dieu dans une sainte confiance. Ne pensez-vous pas que ce soit pour Lui un parfum agréable ? C'est l'Esprit de Christ qui vous porte à vous ouvrir ainsi dans le secret de la présence de Dieu, cherchant à la source unique, la grâce et la puissance qui vous permettront d'exprimer ce que chérit votre cœur. C'est là votre parcelle de la « poudre (Exode 30 v. 6) ».
C'est une chose bénie que de penser à l'Esprit de Christ dans les saints, se manifestant dans la nature même et dans le caractère de leurs prières. La vraie prière est « très sainte (Exode 30 v. 36) », parce qu'elle est l'expression donnée à Dieu de ce qui est Sa propre volonté et de Son propos qui, par l'Esprit de Christ, sont devenus le désir de Ses saints. l'encens devait être « salé, pur, saint (Exode 30 v. 35) ». Ceci parle, je crois, de vrai et pieux exercice de nature à nous préserver de ce qui est cérémonieux et affecté.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• ENTENDEMENT - La faculté de percevoir, de comprendre spirituellement.
Beaucoup peuvent apporter les Écritures à l'esprit, mais seul le Seigneur peut préparer l'esprit à recevoir les Écritures. Notre Seigneur Jésus diffère de tous les autres enseignants ; ils atteignent l'oreille, mais Lui, instruit le cœur ; ils traitent de la lettre extérieure, mais Lui, donne un goût intérieur pour la vérité, par lequel nous percevons sa saveur et son esprit. Les hommes les moins instruits deviennent des érudits mûrs à l'école de la grâce lorsque le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, leur dévoile les mystères du royaume et leur accorde l'onction divine par laquelle ils sont rendus capables de contempler l'invisible.
Heureux sommes-nous si nos compréhensions ont été clarifiées et renforcées par l’Esprit du Maître ! Combien d'hommes d'un profond savoir ignorent les choses éternelles ! Ils connaissent la lettre meurtrière de la révélation, mais ils ne peuvent discerner son esprit meurtrier ; ils ont sur leur cœur un voile que les yeux de la raison charnelle ne peuvent pénétrer. Tel était notre cas il y a peu de temps ; nous qui voyons maintenant étions autrefois totalement aveugles ; la vérité était pour nous comme une beauté dans l'obscurité, une chose inaperçue et négligée.
Sans l'amour de Jésus, nous serions restés jusqu'à ce moment dans une ignorance totale, car sans sa gracieuse ouverture de notre compréhension, nous n'aurions pas plus pu atteindre la connaissance spirituelle qu'un enfant ne peut escalader les Pyramides, ou une autruche voler jusqu'aux étoiles. Le Collège de Jésus est le seul où la vérité de Dieu puisse être réellement apprise ; d'autres écoles peuvent nous enseigner ce qu'il faut croire, mais seule celle de Christ peut nous montrer comment y croire.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• ÉPHOD - Merveilleux symbole de la gloire divine du Fils.

Par-dessus ses autres vêtements, le sacrificateur était revêtu d’un éphod. Il est la pièce caractéristique attribuée pour l’exercice de la sacrificature (cf. 1 Samuel 2 v. 28). Comme le voile, il était tissé de bleu, de pourpre, d’écarlate et de fin coton, mais il s’y ajoutait de l’or : « Ils étendirent des lames d’or, et on les coupa par filets pour les brocher parmi le bleu, et parmi la pourpre, et parmi l’écarlate, et parmi le fin coton, en ouvrage d’art (Exode 39 v. 3) ». Merveilleux symbole de la gloire divine du Fils. Dans les jours de sa chair, sa gloire de Fils de Dieu était comme voilée : pas d’or broché en filets dans les rideaux et le voile. Mais dans son office de souverain sacrificateur dans le ciel, où il conserve tous les caractères de dignité qu’il a revêtus comme homme sur la terre, brille sans voile la gloire divine, s’entremêlant pour ainsi dire à la texture même de ses autres caractères. Dieu qui lui rend ce témoignage : « Tu es sacrificateur pour l’éternité », a d’abord déclaré : « Tu es mon Fils (Hébreux 5 v. 5 et 6) ».
Solidement fixées aux épaulières de l’éphod, et enchâssées dans des chatons d’or, deux pierres d’onyx (couleur d’ongle, donc couleur chair suggérant l’humanité de Christ) portaient gravés « en mémorial », les noms des fils d’Israël : six sur une pierre, six sur l’autre, « selon leur naissance ». Ayant été fait à la ressemblance des hommes, Christ remonté au ciel, est devenu sacrificateur pour l’éternité en faveur de tous ses rachetés. Il porte sur ses épaules puissantes leurs noms gravés « selon leur naissance », ensemble, « en mémorial » devant Dieu. Ainsi, tous les siens, nés de nouveau, sont constamment rappelés à Dieu qui nous garde par sa puissance par la foi (1 Pierre 1 v. 5).
La ceinture entourait l’éphod. Ouvrage d’art particulièrement précieux (Exode 28 v. 8) soulignant que le service du sacrificateur s’accomplit parfaitement avec la force des reins ceints en permanence. Comme autrefois sur la terre, le Seigneur ne se lasse pas et ne se fatigue pas. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Il présente à Dieu les supplications, les prières, les intercessions et les actions de grâces des siens (1 Timothée 2 v. 5 ; Hébreux 9 v. 24).
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
F
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• FAMINE - Le Seigneur est le seul secours possible.
Dans la Bible, il est parlé de plusieurs famines dans le pays de Canaan: la première est survenue au temps d’Abraham qui a tenté d’y échapper en descendant en Égypte (Genèse 12 v. 10 à 13, 4). Une autre a eu lieu durant la vie d’Isaac qui s’est réfugié chez les Philistins (Genèse 26). En Genèse 41 v. 53 et suivants, la famine de sept ans que Joseph avait prophétisée, a frappé « tous les pays » et a servi finalement à lui faire retrouver son père et ses frères. Le livre de Ruth commence avec la famine à Bethléhem, la « maison du pain », qui a amené Élimélec à fuir avec sa famille aux champs de Moab (Ruth 1). La famine a aussi régné durant les trois ans et demi de sécheresse aux jours d’Élie (1 Rois 17 et suiv. ; Jacques 5 v. 17), de même qu’au temps de son successeur Élisée (2 Rois 4 v. 38 ; 6 v. 25 ; 8 v. 1). Dans le Nouveau Testament, il est parlé une fois d’une famine qui eut lieu sous l’empereur Claude (Actes 11 v. 28).
Selon Deutéronome 11 v. 16 et 17, si le peuple d’Israël venait à se détourner vers d’autres dieux, Dieu fermerait les cieux « en sorte qu’il n’y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son rapport ». Il en résulterait la famine dans le pays de Canaan. La famine mentionnée en 2 Rois 8, 1 était expressément appelée par l’Éternel (cf. Psaume 105 v. 16 ; Ézéchiel 36 v. 29). La pénurie de pain, nourriture nécessaire pour la vie, est une figure de la pauvreté et de la misère spirituelles. Cela est mis en lumière dans la parabole du fils prodigue : à la fin de son chemin d’éloignement, il est tombé dans une grande famine qui a été le moyen de son retour vers son père (Luc 15 v. 11 à 32). En Amos 8 v. 11 Dieu dit au peuple d’Israël : « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai une famine dans le pays ; non une famine de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles de l’Éternel ». Ce n’est que par le pain vivant venu du ciel, le Fils de Dieu qui a laissé sa vie pour les pécheurs, que la faim de l’âme peut être assouvie pour toujours (Jean 6). Mais aussi pour les croyants qui spirituellement sont dans le besoin, le retour vers le Seigneur est le seul secours possible.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FARINE (fleur) - Symbole de la pureté et de la perfection de Christ.
La farine, spécialement la fleur de farine, est souvent un symbole de la pureté et de la perfection de Christ dans son humanité (par exemple dans l’offrande de gâteau en Lévitique 2 ; cf. 2 Rois 4 v. 41). La fleur de farine provenait du blé, auquel le Seigneur se compare lui-même (Exode 29 v. 2 ; Jean 12 v. 24).
Les trois mesures de farine de la parabole en Matthieu 13 v. 33, que le levain a fait lever, désignent ce qui a commencé en perfection selon la volonté de Dieu et par le service du Seigneur Jésus : le royaume des cieux sur cette terre. Il a été envahi dans son ensemble par le levain des fausses doctrines « jusqu’à ce que tout fût levé ». Dans ses mises en garde contre le levain en 1 Corinthiens 5 v. 6 et en Galates 5 v. 9, l’apôtre Paul ne met pas l’accent sur le processus, mais sur le résultat : « un peu de levain fait lever la pâte tout entière ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FEMME, FÉMININ - Image de la position subordonnée de l’être humain.
Dans la Bible, la femme est souvent une image de la position subordonnée de l’être humain comme créature de Dieu. Selon l’ordonnance de Nombres 6 v. 5, l’homme qui avait fait vœu de nazaréat ne devait pas se couper les cheveux (comme c’est d’ailleurs le cas pour une femme) ; cela signifiait qu’il prenait une place d’entière soumission à la volonté de Dieu. Le fait que le Seigneur Jésus, comme homme, est né de femme (Galates 4 v. 4), exprime qu’il est devenu parfaitement semblable à l’homme quant à sa position (et non pas pratiquement, car il était sans péché). Il est venu en ressemblance de chair de péché, mais aussi pour le péché, c’est-à-dire pour son abolition (Romains 8 v. 3). Bien qu’il fût le Fils éternel de Dieu, il était, comme enfant, soumis à ses parents et il est devenu obéissant jusqu’à la mort de la croix ; car il ne voulait qu’une chose: faire la volonté de Celui qui l’avait envoyé et accomplir son œuvre (Jean 4 v. 34 ; Philippiens 2 v. 6 à 8).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FER - Employé comme figure de l’inflexibilité.
Le fer, déjà mentionné dans la Bible en Genèse 4 v. 22, est fréquemment employé comme figure de l’inflexibilité, et cela aussi bien au sens positif, tel le Seigneur Jésus qui exercera le gouvernement du règne millénaire avec une verge de fer (Apocalypse 2 v. 27 ; 12 v. 5 ; 19 v. 15), qu’au sens négatif, telles l’indocilité et la dureté des hommes. Dieu a dû dire de son peuple Israël que son cou était une barre de fer (Ésaïe 48 v. 4). Et l’Empire romain est représenté prophétiquement, dans la statue que Nebucadnetsar vit en songe, par les deux jambes de fer, mais dans la vision divine de Daniel par la quatrième bête aux dents de fer (Daniel 2 v. 33 à 45 ; 7 v. 19).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Le mot hébreu pessach signifie « passer par-dessus ». La fête de la Pâque avait lieu au septième mois de l’année israélite, qui fut pourtant appelé le « commencement des mois », parce qu’il marquait un nouveau commencement (Exode 12 v. 1). Avant de délivrer son peuple Israël hors d’Égypte, l’Éternel tua, lors de la dixième plaie, les premiers-nés ; mais le destructeur passa par-dessus les maisons des Israélites, dont les poteaux des portes avaient été aspergés du sang de l’agneau pascal (Exode 12 v. 13). L’agneau pascal est un type de Christ qui a pris sur lui le jugement de Dieu. En 1 Corinthiens 5 v. 7 il est dit : « Car aussi notre pâque, Christ, a été sacrifiée ». Outre cela, les Israélites devaient manger, la nuit de la Pâque, la chair de l’agneau rôtie au feu avec des herbes amères. Nous aussi, nous pouvons nous occuper du Seigneur Jésus qui est mort pour nous, et ainsi nous nourrir de lui spirituellement. Lors des fêtes de la Pâque qui ont suivi, il n’était plus nécessaire de faire aspersion du sang de l’agneau sur les portes. Le sang du Seigneur Jésus purifie du péché une fois pour toutes. Mais nous aussi devons certes nous souvenir continuellement de l’œuvre accomplie de Christ. La cène du Seigneur, que nous célébrons en son souvenir, peut être comparée aux fêtes de la Pâque ultérieures, lors desquelles Israël se souvenait de la délivrance du jugement de Dieu par le sang de l’agneau. À la suite de la Pâque, les Israélites mangeaient des pains sans levain pendant sept jours. Auparavant tout levain devait être ôté des maisons (Exode 12 v. 15 à 20). Paul applique cette fête aux croyants du temps actuel lorsqu’il écrit en 1 Corinthiens 5 v. 6 à 8 : « Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre pâque, Christ, a été sacrifiée : c’est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité ». Les sept jours de la fête des pains sans levain décrivent toute la vie du croyant après sa délivrance, vie qui doit être conduite dans la pureté et la séparation du mal à la gloire de notre Dieu. Ainsi notre vie peut être une « fête solennelle » pour lui et à sa gloire. Le premier jour de la semaine qui suit la Pâque, une gerbe de la nouvelle moisson était apportée en offrande à Dieu (Lévitique 23 v. 10 à 14). On commençait par la moisson de l’orge. Cette fête a eu son accomplissement dans la résurrection de Christ. Il est les « prémices de ceux qui sont endormis », « le premier-né d’entre les morts » (1 Corinthiens 15 v. 20 à 23 ; Colossiens 1 v. 18). Sept semaines ou cinquante jours après l’offrande de la gerbe des prémices avait lieu la fête des semaines à laquelle deux pains étaient présentés à Dieu en offrande tournoyée (Lévitique 23 v. 15 à 21). Ces pains devaient être cuits exceptionnellement avec du levain, ce qui nous montre qu’il ne s’agit pas là d’une figure de Christ, mais de ceux qui étaient autrefois des pécheurs. Cette fête a eu son accomplissement à la Pentecôte (Actes 2 v. 1 ; le nombre de « cinquante » jours correspond au mot grec pentekoste duquel s’est formé notre mot Pentecôte). Les deux pains sont une figure de l’Assemblée composée de Juifs et de Gentils qui ont été créés en un seul homme nouveau par l’œuvre du Seigneur Jésus (Éphésiens 2 v. 15). Les pains étaient faits avec du blé et représentent ainsi le fruit du grain de blé, qui a dû tomber en terre et mourir pour nous (Jean 12 v. 24). Après la fête des semaines s’écoulait un temps dont la durée n’est pas exactement déterminée. La fête des trompettes avait lieu en effet, comme la Pâque, à une date fixe, au premier jour du septième mois (Lévitique 23 v. 23 à 25). En même temps, cette fête désigne un nouveau commencement sur l’ancien fondement, car le septième mois est le premier mois de l’année civile israélite. Il faut comprendre par là que Dieu reprendra ses relations avec son peuple terrestre Israël une fois «la plénitude des nations... entrée», c’est-à-dire quand elle aura été enlevée dans le ciel par son Seigneur (cf. Romains 11 v. 25). Le son de la trompette en sera le signal (cf. Ésaïe 27 v. 13 ; Joël 2 v. 1). Dieu appellera son peuple. Non seulement Israël rentrera dans le pays de Canaan promis par Dieu, mais il sera aussi réveillé spirituellement par la parole de Dieu. Cela n’arrivera toutefois qu’après l’enlèvement de l’Église. Cette fête (hébreu jom kippur) est décrite en détail en Lévitique 16. Le dixième jour du septième mois était le seul jour auquel le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint de la tente d’assignation. La signification de cette fête pour nous, chrétiens, est donnée en Hébreux 9 et 10. Elle est un type de l’œuvre de la propitiation accomplie une fois pour toutes par Christ à la croix, mais elle est en même temps en contraste avec cette œuvre. Le sacrifice de propitiation qui avait lieu une fois l’an, et dont le sang était porté dans le lieu très saint, indiquait d’une part le caractère unique de l’œuvre de Christ ; d’autre part, il traduisait, par sa répétition continuelle, l’imperfection du type (cf. Hébreu 9 v. 24 à 26). Les deux boucs offerts en sacrifice pour le péché représentaient le sacrifice le plus important de cette fête. Après que le souverain sacrificateur avait d’abord fait propitiation pour lui-même et pour sa maison, l’un des boucs était tué et son sang apporté dans le sanctuaire. Les saintes exigences de Dieu relativement au péché étaient ainsi satisfaites et propitiation était faite pour le péché à ses yeux. Christ est la vraie propitiation pour les péchés, et cela non seulement pour ceux qui croient en lui, mais aussi pour le monde entier. À la croix il a payé la « rançon pour tous » (1 Jean 2 v. 2 ; 1 Timothée 2 v. 6). L’œuvre de la propitiation accomplie par Christ est suffisante aux yeux de Dieu pour tous les hommes. Après cela le souverain sacrificateur posait ses mains sur le second bouc et confessait tous les péchés du peuple sur cet animal qui était ensuite envoyé, chargé des péchés, « dans une terre inhabitée » et, comme le substitut pour ainsi dire du peuple, il les ôtait de devant les yeux de Dieu. Nous avons là, en type, l’œuvre de Christ comme notre substitut devant Dieu. Comme tel, il n’a porté les péchés que de ceux qui les lui ont confessés dans la repentance et par la foi. Telle est la signification de Ses paroles : «... pour donner sa vie en rançon pour plusieurs (Matthieu 20 v. 28) ». Nous devons clairement distinguer les deux côtés de l’œuvre de la rédemption qui sont exprimés dans la propitiation et dans la substitution. Toutefois le grand jour des propitiations a aussi une signification particulière pour le peuple d’Israël. Le souverain sacrificateur devait faire propitiation non seulement pour lui-même et pour sa maison (la famille du sacrificateur), mais aussi pour le peuple d’Israël. Alors que les croyants du temps actuel ont une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints (Hébreu 4 v. 16 ; 10 v. 19), Israël doit pour ainsi dire attendre jusqu’à ce que Christ, le vrai Souverain Sacrificateur, sorte du sanctuaire céleste afin d’annoncer la propitiation pour leurs péchés. Lorsqu’il apparaîtra en gloire, le résidu croyant l’acceptera comme son Messie et sera sauvé. La dernière des sept fêtes de l’Éternel est une fête du souvenir et de la joie. Elle se trouve à la fin de la vendange et, de ce fait même, à la fin de l’ensemble des récoltes (Deutéronome 16 v. 13). Les Israélites habitaient pendant sept jours dans des tabernacles (ou cabanes) faits de feuilles et de rameaux, et jouissaient des fruits de la récolte, mais ils se souvenaient aussi de leur sortie et de leur délivrance d’Égypte (Deutéronome 23 v. 40 à 43). La durée de sept jours parle d’une période complète, à savoir du règne millénaire, qui constitue la fin de toutes les voies de Dieu envers son peuple sur la terre. La fête trouve sa conclusion le huitième jour qui est appelé en Jean 7 v. 37 « la dernière journée, la grande journée de la fête ». Ce jour parle d’un nouveau commencement après le règne millénaire, c’est-à-dire de la gloire éternelle de la nouvelle création (Apocalypse 21 v. 1 à 5). La fête de Purim, célébrée le quatorzième jour du mois d’Adar, doit son origine à la délivrance des Juifs, dans le royaume perse, de devant le danger de leur extermination par Haman. Les purim sont les sorts que l’adversaire avait fait jeter auparavant (Esther 3 v. 7 ; 9 v. 26 à 28). La fête de la Dédicace mentionnée en Jean 10 v. 22 (hébreu Chanukka, consécration), célébrée le 25 du mois de Kislev, remonte au renouvellement de la dédicace du temple, en l’an 165 av. J.C., par Judas Maccabée. Elle dure huit jours. Ces deux fêtes introduites ultérieurement n’appartiennent pas aux « fêtes de l’Éternel ». Dans la Bible, le feu est souvent une image de la sainteté scrutatrice de Dieu, qui consume tout ce qui n’est pas en accord avec Dieu, mais purifie tout ce qui est fait pour sa gloire (Deutéronome 4 v. 24 ; Ésaie 10 v. 17 ; 33 v. 14 ; Hébreu 12 v. 29). Sa sainteté est non seulement exprimée par le cri « Saint, saint, saint » des séraphins ou des quatre animaux, mais aussi par les sept lampes de feu qui brûlent devant son trône et qui sont également un type du Saint Esprit (Ésaïe 6 v. 3 ; Apocalypse 4 v. 4 à 8). Lors de sa première rencontre avec Dieu, Moïse vit, comme figure d’Israël, le peuple élu de l’Éternel, un buisson en feu qui n’était pas consumé par les flammes (Exode 3 v. 2). Quand Dieu, lors de la consécration de la tente d’assignation, consuma le premier sacrifice par le feu du ciel, il donna par là son approbation au saint service qui avait été établi selon ses ordonnances sous la direction de Moïse (Lévitique 9 v. 24). Lorsque l’holocauste, l’offrande de gâteau ainsi que la graisse du sacrifice de prospérités et du sacrifice pour le péché, qui parlent en type de Christ et de son œuvre, étaient offerts (Lévitique 1 v. 9 ; 2 v. 2 ; 3 v. 5 ; 4 v. 31), le feu faisait monter une odeur agréable de ces offrandes qui glorifient Dieu. De même que l’or est purifié par le feu, de même notre foi est purifiée par l’épreuve afin que celle-ci soit à la louange, à la gloire et à l’honneur du Seigneur Jésus (1 Pierre 1 v. 7). Un jour l’ouvrage de chaque racheté sera éprouvé par le feu devant le tribunal de Christ (1 Corinthiens 3 v. 12 à 15). Tout ce qui est précieux pour lui sera récompensé et, sans mélange de faiblesse ou même de péché, resplendira éternellement à sa gloire (or, argent, pierres précieuses). En revanche, tout ce qui n’a pas de caractère durable à ses yeux (bois, foin, chaume) brûlera au feu, mais le croyant lui-même sera sauvé, « toutefois comme à travers le feu ». La sainteté de Dieu se révèle cependant aussi dans le jugement. Lui qui a les yeux trop purs pour voir le mal (Habacuc 1 v. 13), punira un jour, dans le feu éternel, inextinguible, tous les incrédules qui auront méprisé sa grâce. Le lieu des tourments éternels est appelé l’étang brûlant de feu et de soufre (Apocalypse 20 v. 15 ; 21 v. 8 ; cf. Matthieu 3 v. 12 ; 18 v. 8). La fumée causée par le feu est aussi parfois le signe du jugement et du châtiment de Dieu (Ésaïe 30 v. 27 ; 34 v. 10 ; Apocalypse 14 v. 11 ; 18 v. 9). L’espèce sauvage du figuier, qui pousse naturellement dans le bassin méditerranéen, produit trois sortes de fruits différents par an : des figues impropres à la consommation en avril et en juillet, et des figues comestibles en septembre. Le figuier de culture paraît sous deux formes : l’arbre avec des fleurs mâles et femelles, mais ne donnant pas de fruits comestibles, et celui qui porte uniquement des fleurs femelles et produit des fruits trois fois par an : les figues hâtives (avril - juin), la récolte principale (juin - novembre) et les figues tardives (septembre - janvier). De même que la vigne, le figuier est souvent employé en relation avec le peuple d’Israël comme figure du fruit et de la bénédiction (1 Rois 4 v. 25 ; Jérémie 5 v. 17 ; Jean 1 v. 49). En Osée 9 v. 10, Dieu dit : « J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert ; j’ai vu vos pères... comme le premier fruit du figuier », et en Joël 1, où il doit constater que son pays est frappé par une nation puissante, il est dit au verset 7 : « Elle a réduit ma vigne en une désolation, mon figuier en un tas de bois ». En Luc 13 v. 6 à 9, le Seigneur Jésus se sert aussi de l’image du figuier pour désigner le peuple juif incrédule qui a bénéficié des soins du Fils de l’homme et qui, dans son ensemble, est demeuré sans fruit. En Matthieu 21 v. 19, il prononce le jugement sur un figuier qui ne porte pas de fruit. Le miracle de ce figuier desséché et l’événement lors duquel les esprits immondes entrèrent dans le troupeau de pourceaux (Matthieu 8 v. 30 à 32) sont au reste les seuls signes du Seigneur dans lesquels la grâce n’est pas mise en évidence, mais le jugement est annoncé sur le peuple juif. Dans le pays de Canaan, la figue était un des sept aliments qui parlent de la bénédiction spirituelle de Dieu envers son peuple. La figue pourrait ici être considérée comme figure du fruit de la justice (Philippiens 1 v. 11 ; Hébreu 12 v. 11 ; Jacques 3 v. 18), de même que la grenade comme fruit de la sainteté et l’olive comme fruit de l’Esprit. Outre son sens premier de « descendant de sexe masculin », le mot fils, dans la Bible, a différentes autres significations. Par exemple, le vieux souverain sacrificateur Éli appelle le jeune Samuel « mon fils » pour exprimer la relation familière d’un aîné avec un jeune (1 Samuel 3 v. 6). Des expressions telles que « fils de perdition », « fils de lumière », ne se rapportent pas à la descendance, mais indiquent ce qui marque ou caractérise une personne. Au sens figuré, le mot « fils » fait ainsi allusion, le plus souvent, à une position déterminée. Le modèle parfait de la filialité (qualité de fils) est le Fils de Dieu, appelé le Fils du Père en 2 Jean 3, la Personne de la Trinité éternelle qui est devenue Homme quand l’accomplissement du temps est venu (Jean 1 v. 1 à 14 ; Galates 4 v. 4 ; cf. Matthieu 28 v. 19). Dès l’éternité passée, il était le Fils unique dans le sein du Père (Jean 1 v. 18) et il est devenu, par sa naissance d’une femme, non seulement « Fils de l’homme (à proprement parler : fils d’homme) », mais aussi d’une manière nouvelle « Fils de Dieu » (cf. Psaume 2 v. 7 ; Luc 1 v. 35). Lorsqu’il était sur la terre, toute la plénitude de la Déité s’est plu à habiter en lui et, par lui, à réconcilier toutes choses (non pas tous les hommes !) avec elle-même (Colossiens 1 v. 19 ; cf. chap. 2 v. 9). Après avoir pleinement glorifié son Dieu et Père par cette grande œuvre, il a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père (Romains 6 v. 4). Le grain de blé n’était pas seulement mort, mais il portait maintenant beaucoup de fruit semblable à lui (Jean 12 v. 24) ! Le jour de sa résurrection, il a fait immédiatement connaître à ses disciples la merveilleuse vérité qui est une des caractéristiques de la foi chrétienne : « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu (Jean 20 v. 17) ». Selon le bon plaisir de sa volonté éternelle, Dieu nous a « prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ (Éphésiens 1 v. 4) ». Pour en permettre l’accomplissement, il a fallu l’œuvre de la rédemption à la croix de Golgotha, car Dieu n’a pas de communion avec des pécheurs, mais seulement avec des rachetés qui, par la foi au Fils, lui sont rendus conformes, quant à leur position. Le mot « adopter » en Éphésiens 1 v. 5, signifie « placer dans la position de fils ». À la différence de notre position comme enfants de Dieu, à laquelle nous sommes venus par la nouvelle naissance, nous sommes des fils de Dieu par notre position en Christ qui est glorifié à la droite de Dieu et sera éternellement le premier-né entre plusieurs frères (Romains 8 v. 29). La qualité d’enfant exprime la similitude de nature; la qualité de fils, une similitude (non une égalité) de position : deux privilèges merveilleux, insondables pour le croyant ! Plus encore que la qualité d’enfant, la qualité de fils des croyants souligne l’élévation et la dignité de leur position, ainsi que la responsabilité qui y est liée (cf. Romains 8 v. 14 à 17 ; 2 Corinthiens 6 v. 18 ; Galates 4 v. 4 à 7). La fleur et la floraison sont des figures de la beauté (terrestre) et de la délicatesse, mais aussi du caractère périssable comme l’herbe (Cantique 2 v. 1 ; Matthieu 6 v. 28 et 29 ; cf. Psaume 103 v. 15 et 16 ; 1 Pierre 1 v. 24). La floraison est aussi une figure de la vraie vie spirituelle et le signe précurseur du fruit (Ésaïe 35 v. 1 et 2 ; Osée 14 v. 5 à 7). Les fleuves ou les rivières les plus souvent mentionnés dans la Bible sont l’Euphrate, le Nil et le Jourdain. En Genèse 2 v. 14, l’Euphrate (hébreu Phrath) est l’une des quatre rivières issues de la division du fleuve qui sort d’Eden. Il n’est souvent appelé que « le fleuve » (hébreu nahar ; Genèse 31 v. 21). Le Nil, le fleuve d’Égypte (Genèse 15 v. 18), est de même souvent mentionné sans son nom (Genèse 41 v. 1 ; hébreu jeor, qui signifie aussi « canal »). Les fleuves sont les artères qui conduisent la précieuse eau en grande abondance, mais ils peuvent aussi devenir menaçants par la puissance de leurs flots. Nous trouvons ces deux significations dans le langage figuré de la Bible. Le psalmiste chante : « Tu les abreuveras au fleuve de tes délices (Psaume 36 v. 8) ». Ésaïe compare la paix que Dieu donne à un fleuve ou à une rivière (Ésaie 48 v. 18 ; 66 v. 12). Le fleuve de vie évoque l’abondance et le caractère inépuisable de la bonté de Dieu envers les siens (Gen. 2, 10; Ps. 46, 4; Ézéch. 47, 1-12; Apocalypse 22 v. 2 ; cf. Zacharie 14 v. 8). Dans les régions méditerranéennes, les fourneaux pour le chauffage ne sont guère nécessaires en raison du climat chaud. En hiver, on se chauffait autrefois devant des brasiers ouverts (Ésaïe 47 v. 14 ; Jérémie 36 v. 22). Aussi dans la Bible les fours sont-ils mentionnés essentiellement en rapport avec la cuisson du pain (Lévitique 26 v. 26 ; Osée 7 v. 4) et avec le façonnage des métaux (Ézéchiel 22 v. 18 à 22). Le fourneau pour la fonte des métaux précieux est une figure de la dure captivité des Israélites en Égypte (Deutéronome 4 v. 20), mais aussi des grandes épreuves que Dieu envoie aux hommes comme discipline (Proverbes 17 v. 3 ; cf. 1 Pierre 1 v. 7). La chaleur insupportable de son feu et la fumée qui s’élève font parfois du four ou de la fournaise une figure du jugement de Dieu dans ses différentes formes (Ésaïe 31 v. 9 ; Malachie 4 v. 1 ; Apocalypse 1 v. 15). De même que la plante produit des fruits propres à la consommation, ainsi le croyant peut produire du fruit pour Dieu, comme nous le voyons par exemple dans les paraboles du semeur, de l’ivraie parmi le froment et des méchants cultivateurs (Matthieu 13 v. 8, 23 à 30 ; 21 v. 33 à 46). Le fruit spirituel est le résultat de la foi et de l’obéissance à la parole de Dieu. Le fruit pour Dieu demeure (Jean 15, 16). Déjà sur la terre il est le signe distinctif du vrai croyant (Matthieu 7 v. 16 à 20). Dans le Nouveau Testament, il est parlé de différentes sortes de fruits spirituels : du fruit de l’Esprit dans ses neuf caractères (Galates 5 v. 22), du fruit de la lumière (Éphésiens 5 v. 9) et plusieurs fois du fruit de la justice (2 Corinthiens 9 v. 10 ; Philippiens 1 v. 11 ; Hébreu 12 v. 11 ; Jacques 3 v. 18). Les sacrifices de louanges que nous pouvons offrir à notre Dieu et Père par le Seigneur Jésus et que la Parole appelle « le fruit des lèvres qui confessent son nom » (Hébreu 13 v. 15 ; cf. Osée 14 v. 2) sont un fruit particulièrement beau.
• FÊTES DE L’ÉTERNEL - Dans les fêtes de l’Éternel, l’histoire spirituelle du peuple juif et la formation de l’Assemblée sont présentées en type.
Dans l’Ancien Testament, il est fait mention de sept fêtes que l’Éternel a données à son peuple comme « saintes convocations (Lévitique 23) ». Plusieurs sont en rapport avec la récolte qui parle du fruit pour Dieu. Dans les fêtes de l’Éternel, l’histoire spirituelle du peuple juif et la formation de l’Assemblée sont présentées en type.
1. La Pâque
2. La fête des pains sans levain
3. La fête de la gerbe des prémices
4. La fête des semaines
5. La fête des trompettes
6. Le grand jour des propitiations
7. La fête des tabernacles
La fête de Purim
La dédicace du temple
![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FEU - Symbole de la pureté et de la perfection de Christ.
![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FIGUIER - Le figuier est souvent employé en relation avec Israël.
![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FILS - Plus encore que la qualité d’enfant, la qualité de fils des croyants souligne l’élévation et la dignité de leur position, ainsi que la responsabilité qui y est liée.
Lorsque Dieu appelle le peuple d’Israël son « fils premier-né », la valeur que le peuple élu avait aux yeux de Dieu est mise en évidence ; en conséquence, les Israélites, comme ensemble, appelaient Dieu leur Père (Exode 4 v. 22 ; Malachie 2 v. 10). Toutefois un Israélite n’aurait certes guère osé s’adresser à Dieu comme à son propre Père. Cette relation intime n’a été rendue possible que par la révélation du Père dans le Fils et par l’œuvre expiatoire qui y est liée (Jean 1 v. 18 ; 14 v. 6 à 9 ; Éphésiens 2 v. 18).![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FLEUR - Figures de la beauté (terrestre) et de la délicatesse.
![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FLEUVE, RIVIÈRE - Les fleuves conduisent la précieuse eau en grande abondance.
Cependant les fleuves et les rivières sont aussi souvent une figure des puissances de méchanceté (Psaume 18 v. 4 ; Ésaïe 8 v. 7 ; 43 v. 2 ; 59 v. 19 ; Luc 6 v. 48) qui peuvent certes être effrayantes, mais qui toutefois sont domptées par la puissance de Dieu (Psaume 66 v. 6 ; Cantique 8 v. 7 ; Apocalypse 12 v. 16).![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FOUR, FOURNEAU, FOURNAISE - Figure de la captivité en Égypte.
![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• FRUIT - Foi et obéissance à la parole de Dieu.
Cependant, l’incrédule produit également son fruit qui est aussi bien reconnaissable que le fruit pour Dieu (Matthieu 12 v. 33). Le péché ne porte toutefois que du fruit pour la mort (Romains 6 v. 21 ; 7 v. 4).![]() Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• FIGUIER (stérile) (1) - Que Dieu ait cherché du fruit du figuier pendant trois ans, c’est une référence touchante aux trois ans de service du Seigneur Jésus au milieu du peuple d’Israël.
Luc 13 v. 6 à 9. La parabole du figuier stérile de Luc 13 est précédée d’une leçon qui n’est pas sans importance pour la compréhension de la parabole elle-même. Elle corrige en outre une erreur qu’on rencontre souvent dans la manière de penser des gens. Deux événements avaient excité à cette époque les cœurs des Juifs. Pilate, le gouverneur romain, avait fait publiquement tuer quelques Galiléens au moment où ils étaient en train d’offrir des sacrifices au temple. Dieu ne les avait pas protégés, et leur sang avait été mêlé à leurs sacrifices. Pourquoi l’autel de Dieu ne leur avait-il offert aucune protection (Exode 21 v. 14) ? Et dans le même temps encore, la tour de Siloé s’était écroulée sur 18 personnes, qui s’étaient retrouvées ensevelies sous les décombres. Pourquoi Dieu avait-Il laissé faire tout cela ? N’était-ce pas des signes clairs du déplaisir de Dieu vis-à-vis de ces personnes ? Plusieurs pouvaient penser ainsi, mais le Seigneur dut rectifier leur manière de penser, tout comme celle de ces disciples qui Lui demandaient à propos d’un aveugle-né : « Rabbi, qui a péché : celui-ci, ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? (Jean 9 v. 1 et 2) ». Ces Galiléens et ces habitants de Jérusalem qui avaient tous trouvés la mort d’une manière si extraordinaire n’étaient pas plus mauvais que les autres gens de cette ville.
Les gens tirent leurs conclusions de ce genre d’événements spectaculaires, mais elles sont souvent fausses comme dans le cas de l’aveugle-né. Le Seigneur donne aux Juifs, et pas seulement à eux, une leçon importante : « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement (Luc 13 v. 1 à 5) ». Ces événements ne parlent pas seulement à propos des morts, mais pour les vivants. Si les hommes ne se repentent pas, et ne reçoivent pas le Seigneur Jésus par la foi, le jugement de Dieu les atteindra pareillement. Cela vaut pour la nation juive en tant que telle, comme pour chaque homme en particulier. Ce jugement comporte un aspect temporel et un aspect éternel, comme nous l’avons déjà vu en considérant la parabole du roi qui fit des noces pour son fils en Matthieu 22.
Le figuier.
Le Seigneur Jésus approfondit l’enseignement avec la parabole du figuier stérile : « Et il disait cette parabole : Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne ; et il vint y chercher du fruit, et il n’en trouva point. Et il dit au vigneron : Voici trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve point : coupe-le ; pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ? (Luc 13 v. 6 et 7) ». Le figuier est une image d’Israël, et plus précisément du Résidu juif après la déportation de 70 ans. Dieu dans Sa grâce avait ramené ce Résidu de leur exil à Babylone jusque dans le pays de la promesse, et maintenant Il attendait du fruit de sa part. Mais il n’en portait aucun.
Il est typique pour le figuier, comme pour l’amandier, de commencer par porter des fleurs, et les feuilles ne viennent qu’après. Un beau feuillage est une promesse de bons fruits. C’est pourquoi le figuier est une image frappante de la profession, c’est-à-dire de ce qu’on professe être ou posséder du point de vue religieux. Les Juifs étaient comme un figuier. Il y avait beaucoup de feuillage, de hautes revendications, comme celle d’être le peuple élu de Dieu. Mais du fruit pour Dieu, on n’en trouvait pas. Quelle différence avec le Seigneur Jésus dans Son service pour Son Dieu et Père ici sur la terre ! La description du Psaume 1 s’appliquait parfaitement à Lui : « Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point ; et tout ce qu’il fait prospère (Psaume 1 v. 3) ». Le fruit pour Dieu et la profession devant les hommes allaient de pair chez Lui, en une manière et une harmonie parfaite.
Que Dieu ait cherché du fruit du figuier pendant trois ans, c’est une référence touchante aux trois ans de service du Seigneur Jésus au milieu du peuple d’Israël. Il était Lui-même le vigneron, et pendant tout le temps de Son ministère public, Il avait fait tout ce qui était possible pour amener le figuier à porter du fruit. Mais cela avait été vain. Il devait faire monter cette lamentation : « J’ai travaillé en vain, et j’ai consumé ma force pour le néant (Ésaïe 49 v. 4) ». Ce côté du service de notre Seigneur ne nous est pas toujours bien connu. Mais il nous conduit à L’adorer quand nous pensons combien Il s’est fatigué pour le figuier qui appartenait à Son Dieu et Père, et quelle réponse Lui fut donnée. Cela n’a-t-il pas été douloureux pour Lui ? Les hommes de Juda étaient « la plante de ses délices. Et il s’attendait au juste jugement, et voici l’effusion de sang, à la justice, et voici un cri ! (Ésaïe 5 v. 7) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FIGUIER (stérile) (2) - Ici et là dans l’Écriture, il y a des indications sur des dialogues entre les personnes de la Déité.
« Et il dit au vigneron : Voici trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve point : coupe-le ; pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ? Et répondant, il lui dit : Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu’à ce que je l’aie déchaussé et que j’y aie mis du fumier ; et peut-être portera-t-il du fruit : sinon, après, tu le couperas (Luc 13 v. 7 à 9) ». Ici et là dans l’Écriture, il y a des indications sur des dialogues entre les personnes de la Déité. Ce ne sont souvent que quelques mots ou phrases qu’il nous est permis d’entendre. Mais ils sont riches d’enseignements pour nous. Déjà à la première page de nos bibles nous trouvons comme une allusion à un tel entretien : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance (Genèse 1 v. 26) ». Et quand l’homme fut tombé dans le péché, il nous est permis d’entendre juste le début d’une phrase interrompue : « Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour connaître le bien et le mal ; et maintenant, afin qu’il n’avance pas sa main et ne prenne aussi de l’arbre de vie et n’en mange et ne vive à toujours… ! (Genèse 3 v. 22) ».
Dans notre courte parabole, il nous est également permis d’écouter un dialogue entre les personnes divines, entre le Père et le Fils. Et ce qui nous touche particulièrement, c’est le caractère sous lequel le Seigneur Jésus se fait reconnaître : Il est un intercesseur, qui prête appui aux coupables. À première vue il semblerait y avoir une divergence entre le propriétaire de la vigne et le vigneron. Car le propriétaire suggère de couper l’arbre tandis que le vigneron insiste pour surseoir. Mais il n’y a en réalité aucune discordance entre les deux. Cela apparaît clairement du fait que le propriétaire est tout de suite d’accord avec la proposition du vigneron pour accorder une chance supplémentaire au figuier. Il n’y pas non plus la moindre base, ni dans cette parabole ni ailleurs dans l’Écriture, pour se figurer que seul le Seigneur Jésus serait plein de tendresse et de compassion, et qu’Il devrait détourner un Dieu courroucé de l’exercice du jugement. Car non seulement le propriétaire donne son accord à la proposition du vigneron, mais celui-ci aussi approuve l’abattage final de l’arbre. Nous ne devons pas chercher à neutraliser la colère par la miséricorde, ni la miséricorde par la colère. Les deux sont des traits essentiels de Dieu.
Le cœur du Père n’aime pas moins que le Fils, et le Fils est la parfaite expression du Père (Jean 14 v. 7 à 10). Sa parole est celle du Père, aussi bien quand elle s’adresse aujourd’hui à Israël, au monde ou à Son peuple. Le Fils est courroucé contre le péché tout comme le Père (Marc 3 v. 5 ; Jean 3 v. 36). Et si Dieu a tant aimé le monde qu’Il a envoyé Son Fils unique, c’était aussi l’expression de l’amour du Fils de venir dans le monde (Jean 3 v. 16, 19 ; 6 v. 38). Et n’est-Il pas venu pour faire la volonté de Son Père ? C’est pourquoi la parabole Le montre comme Celui qui se soucie de la vigne, et qui s’adresse au propriétaire en disant « Maître ». Néanmoins le vigneron n’agit pas et ne parle pas comme un serviteur qui se borne à exécuter des ordres, car il est autant intéressé à l’arbre que le propriétaire lui-même. Le propriétaire se comporte aussi à l’avenant.
Il y a une harmonie merveilleuse à tous égards entre les deux interlocuteurs. Ce que nous trouvons en type avec Abraham et Isaac en chemin vers la montagne de Morija, s’accomplit en perfection sur le chemin du Fils allant à la croix : « ils allaient les deux ensemble (Genèse 22 v. 8) ». Pourtant c’est là que, par Son sacrifice pour le péché, Il a apaisé la colère de Dieu contre le péché, et Il est maintenant la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier (1 Jean 2 v. 2). Oui, Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Christ Jésus, qui s’est donné Lui-même en rançon pour tous (1 Timothée 2 v. 5 et 6).
La question du propriétaire : « pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ? » nous fait connaître un autre côté important de la vérité. Le fait que l’arbre ne porte aucun fruit, n’est que l’un des côtés de la vérité, bien que ce soit déjà un côté assez sérieux. Mais un autre côté non moins important, est que, par son absence de fruit, l’arbre empêche que le propriétaire puisse cultiver d’autres plantes à sa place. Si quelqu’un dédaigne la grâce de Dieu et la position privilégiée qu’elle lui confère, il fait par là obstacle à d’autres sur leur chemin ; car il réduit à néant la révélation de la grâce de Dieu, pour ce qui concerne le témoignage extérieur. Dieu se voit dès lors obligé, tôt ou tard, de l’ôter par le jugement, ou au moins de le mettre de côté, pour tourner Sa grâce vers d’autres qui portent du fruit à la place du sien. Telles sont les voies de Dieu envers les hommes.
La fin tragique de Judas Iscariote explique ce principe. Tous les efforts de l’amour du Seigneur sont restés vains. C’est pourquoi sa demeure devait rester déserte, et sa charge de surveillant devait être prise par un autre (Actes 1 v. 20, 25). L’exemple d’Israël, comme nous le trouvons dans notre parabole, parle aussi le même langage si sérieux. Nous y reviendrons brièvement. Pourtant le Seigneur avait déjà indiqué les conséquences dans la parabole des méchants cultivateurs : « Il fera périr misérablement ces méchants, et louera sa vigne à "d’autres" cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison (Matthieu 21 v. 41) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FIGUIER (stérile) (3) - Il est important que le figuier ne soit pas déraciné, mais simplement coupé.
Nous avons vu comment le vigneron a le rôle d’intercesseur et prête son appui au figuier stérile. Quand le propriétaire parle de le couper, le vigneron réplique : « Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu’à ce que je l’aie déchaussé et que j’y aie mis du fumier ; et peut-être portera-t-il du fruit : sinon, après, tu le couperas (Luc 13 v. 8 et 9) ». Cela ne nous rappelle-t-il pas la prière de Jésus à la croix : « Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font » ? En réponse à cette prière, Pierre et les autres apôtres furent envoyés à la nation coupable avec un message renouvelé de la grâce.
L’expression cette année aussi, ou cette année encore, ne doit pas être prise au sens littéral. Elle embrasse tout l’intervalle de temps entre la descente du Saint Esprit en Actes 2 et la lapidation d’Étienne en Actes 7. Dans cette période remarquable, le Saint Esprit a opéré par les douze apôtres et par Étienne parmi le peuple juif d’une manière particulièrement remarquable. C’était de nouveau l’activité du vigneron, mais Lui était au ciel pour l’exercer, une activité intense comme les expressions mettre du fumier et déchausser le font comprendre. Nous retrouvons cette deuxième offre de la grâce dans la parabole du roi qui faisait des noces pour son fils : « Il envoya encore d’autres esclaves… (Matthieu 22 v. 4) ».
Cependant le figuier, la nation juive en tant que telle, produisit aussi peu de fruit pour Dieu pendant cette période de temps rajoutée par la grâce, que pendant les trois années où Christ séjourna et servit parmi eux. Certes la parabole laisse ouverte l’issue de la circonstance rapportée, mais nous savons par d’autres passages que le résultat de la période rajoutée fut effectivement négatif. Et c’est ainsi que le figuier fut effectivement coupé, non pas déraciné, mais bien coupé. C’est l’état de ce peuple aujourd’hui. Comme témoin particulier de Dieu, ce peuple a perdu sa place sur la terre.
Jean le baptiseur avait déjà averti précédemment, disant : « Et déjà la cognée est mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu (Matthieu 3 v. 10) ». En Romains 11 où une figure semblable, celle de l’olivier, est utilisée, nous apprenons que l’arrachage d’une branche n’est pas définitif, n’est pas pour toujours. Les branches naturelles seront greffées de nouveau sur leur propre olivier (Romains 11 v. 24). Un Résidu d’Israël fleurira à nouveau, et sera pour Dieu un champ fertile en fruits (Ézéchiel 32 v. 15).
C’est pourquoi il est si important que le figuier ne soit pas déraciné, mais simplement coupé. Les racines sont encore dans la terre. Dans le livre de Job, il y a un passage très précieux à cet égard : « Car il y a de l’espoir pour un arbre : s’il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l’odeur de l’eau il poussera, et il fera des branches comme un jeune plant (Job 14 v. 7 à 9) ».
Cela fournit l’occasion d’une dernière remarque : La parabole du figuier stérile de Luc 13 précède chronologiquement la parabole du figuier portant des feuilles de Matthieu 24 v. 32 et 33. Il s’agit en fait d’une double parabole, la deuxième étant la suite de la première. La première fois que le Seigneur s’est trouvé là, Il n’a trouvé aucun fruit en Israël. Mais avant qu’Il y revienne pour la deuxième fois, le figuier présentera des marques d’un retour de la vie, et ce sera de nouveau le signe que l’été est proche (comparer Luc 21 v. 29 à 31). Alors, oui alors, le vigneron trouvera finalement le fruit auquel Lui et Son Père aspiraient, et la parole du prophète Ésaïe s’accomplira : « Dorénavant Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera, et remplira de fruits la face du monde (Ésaïe 27 v. 6) ».
Quelle fin merveilleuse des voies de Dieu envers ce peuple ! Que Ses jugements sont insondables et Ses voies introuvables ! (Romains 11 v. 33).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILET (et les poissons) (1) - On pourrait résumer la parabole elle-même en disant qu’elle concerne « ce que font les pêcheurs », et que l’explication du Seigneur concerne « ce que font les anges ».
Nous arrivons à la dernière et sixième parabole du royaume des cieux de Matthieu 13. Pour la sixième fois, une parabole est introduite par l’expression « le royaume des cieux est semblable ». Le premier mot « Encore » insiste en outre sur la liaison avec les deux paraboles précédentes (le trésor dans le champ et la perle de grand prix). La parabole du filet et des poissons dont nous nous occupons maintenant ressemble beaucoup par sa structure et son langage à la parabole de l’ivraie du champ, la première des six paraboles. Dans les deux paraboles, il est question de bons et de méchants, et dans les deux le Seigneur introduit dans Son explication la consommation du siècle (litt. : l’achèvement de l’ère) à laquelle se rattache le jugement.
À un certain point de vue, l’interprétation de la sixième parabole du royaume des cieux (la septième parabole au total) offre les plus grandes difficultés. On ne s’étonne donc pas des différences qu’on trouve dans les commentaires. Beaucoup de commentateurs différent la scène qui s’y déroule, et que nous dépeint la parabole, au temps qui suit l’enlèvement de l’église, et ils voient, par exemple, dans les bons poissons une image des nations qui seront introduites dans le royaume au temps de la fin (Apocalypse 7 v. 9 et suiv.). Pourtant, comme nous l’avons vu avec le trésor dans le champ, l’introduction des nations dans le royaume de paix du Seigneur n’appartient pas aux mystères du Nouveau Testament, ni aux vérités cachées dans l’Ancien Testament. La difficulté principale paraît résider en ce que l’on ne reconnaît pas la différence existant entre la parabole elle-même et l’explication ajoutée par le Seigneur. Si l’on ne comprend pas que, dans Son explication de la parabole, le Seigneur va chaque fois bien plus loin que ce qu’Il a dit dans la parabole, on ne trouve pas la clef à une interprétation correcte. On a vu aussi dans la parabole de l’ivraie du champ que la parabole décrit une scène autre que celle de l’explication. Il en est de même dans cette parabole du filet et des poissons.
« Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine jetée dans la mer et rassemblant (des poissons) de toute sorte ; et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s’asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle : les anges sortiront, et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu : là seront les pleurs et les grincements de dents (Matthieu 13 v. 47 à 50) ». Commençons par considérer la parabole elle-même (v. 47 et 48), puis nous verrons ensuite l’explication ajoutée par le Seigneur (v. 49 et 50). On pourrait résumer la parabole elle-même en disant qu’elle concerne « ce que font les pêcheurs », et que l’explication du Seigneur concerne « ce que font les anges ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILET (la prise de poissons) (2) - Les serviteurs du Seigneur qui jettent le filet de l’évangile dans la mer des nations.
Nous sommes frappés ici que ce sont des pêcheurs qui sont au travail, non pas un homme, ni non plus le Fils de l’homme Lui-même. Manifestement, il faut comprendre ce mot les pêcheurs comme désignant les serviteurs du Seigneur qui jettent le filet de l’évangile dans la mer des nations (cf. Apocalypse 17 v. 15), pour gagner des âmes pour le Seigneur. Il s’agit d’une activité typique du temps du royaume des cieux et que nous devons en aucune manière perdre de vue. La mission du Ressuscité à Ses disciples dit bien : « Allez dans tout le monde, et prêchez l’évangile à toute la création (Marc 16 v. 15) ». Le Saint Esprit qui devait descendre sur eux, une fois l’œuvre de la rédemption accomplie, leur donnerait la force, et « vous serez mes témoins », avait-Il dit, « à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout de la terre (Actes 1 v. 8) ».
Avec le filet qui rassemble toute sorte de poissons, il est clair que d’un côté nous avons ici, devant nous, une œuvre de l’homme (inachevée). D’un autre côté, nous y reconnaissons la bonne nouvelle s’adressant non pas seulement à une classe d’hommes particulière, mais à tous les hommes, quelque soient leur race ou leur condition sociale ; c’est la même pensée que dans la parabole du semeur. On ne trouve pas d’indication de l’exclusion d’aucune sorte de gens, ou de nation. C’est donc le résultat de la prédication de l’évangile : des poissons de toute sorte sont rassemblés.
Cependant ce ne sont pas tous les poissons de la mer qui sont rassemblés dans le filet. Cela s’accorde avec les paroles de Jacques en Actes 15 : « Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom » (v. 14). On ne trouve dans l’Écriture ni un salut de tous les hommes ni une christianisation universelle du monde. Il est heureux que ce soit la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2 v. 4). Et aucun de ceux qui iront un jour en enfer ne pourra objecter à Dieu que lui-même aurait voulu être sauvé, mais que pourtant il n’avait pas été élu de Dieu. Le résultat de la prédication de l’évangile est donc qu’une quantité limitée de poissons va dans le filet tandis que les autres restent dans la mer.
Il n’est pas non plus parlé que la pêche recommence une nouvelle fois. Bien plutôt, la totalité de l’œuvre, qui s’est étendue sur beaucoup de siècles pendant le temps de la grâce, se trouve incluse dans le cours de cette seule pêche.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILET (le tri) (3) - On voit ici les pêcheurs occupés à séparer les bons poissons des mauvais.
Mais voilà que l’activité des pêcheurs change, et on passe manifestement à la fin de la période, un temps de crise : « … quand elle (la seine, ou : filet) fut pleine, ils la tirèrent vers le rivage ». Je ne doute point que par les mots « quand elle fut pleine », le Seigneur faisait allusion aux derniers jours du temps de la grâce. Déjà avant la mort du dernier apôtre la dernière heure avait commencé. Le fait que plusieurs antichrists soient apparus, était pour l’apôtre Jean une preuve suffisante que la dernière heure était déjà là (1 Jean 2 v. 18). L’apôtre Paul parle aussi des « derniers jours » et il les caractérise comme des « temps fâcheux (2 Timothée 3 v. 1) ». En ce temps-là, les pêcheurs ont à faire aux poissons d’une autre manière que précédemment. Ils trouvent dans leurs filets des bons et des mauvais poissons. Et en contraste avec la parabole de l’ivraie du champ où il fallait laisser croître l’ivraie avec le froment jusqu’à la moisson, on voit ici les pêcheurs occupés à séparer les bons poissons des mauvais.
À soit tout seul, ce point est déjà très remarquable. Cela montre clairement que l’état de mélange du bien et du mal n’est pas selon la pensée du Seigneur. Certes Il le supporte, comme nous l’avons vu, mais il n’est pas selon Sa pensée. Pour que ce soit bien clair, il fallait cette parabole. Mais le Seigneur ne le dit qu’à Ses disciples dans la maison. Ce n’est qu’à eux qu’il découvre Ses intentions véritables. Le filet avait bien amené toute sorte de poissons ensemble, des bons et des mauvais (sans valeur), comme on voit beaucoup de gens qui professent le christianisme, et parmi ces professants, certains sont authentiques, d’autres non. Le Seigneur veut faire une séparation entre eux, déjà ici-bas sur la terre. On voit donc ici les pêcheurs procéder à un examen. Ils comprennent ce que sont les poissons, lesquels sont bons et lesquels sont mauvais, et ils agissent en conséquence ; ils séparent les uns des autres.
Instinctivement on se rappelle la circonstance d’Actes 19. Comme quelques-uns des Juifs parlaient mal de la voie chrétienne et ne croyaient pas, Paul se retira d’eux et sépara les disciples (v. 9). La séparation du mal est un principe essentiel du Nouveau Testament, et même de toute l’Écriture (voir Exode 33 v. 7 ; 1 Thessaloniciens 5 v. 22 ; 2 Timothée 2 v. 19 ; Hébreux 13 v. 13 ; Apocalypse 18 v. 4). Dans des temps de ruine et de mélange, si nous voulons jouir de la communion du Seigneur, nous devons nous purifier du mal et de ceux qui le supportent (2 Timothée 2 v. 21). Le Seigneur ne se joindra jamais au mal. De notre côté, il est nécessaire d’avoir les sens exercés à discerner le bien et le mal et à savoir faire la différence entre les deux (Hébreux 5 v. 14).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILET (les bons poissons) (4) - Enseignement sur l’assemblée dans son caractère local.
Encore un point à la suite de ce qui précède. Les pêcheurs avaient jeté leur filet pour prendre des bons poissons. Ce sont ceux-ci qui les intéressaient. Mais leur filet a aussi pris des mauvais. Une fois celui-ci plein, ils s’asseyent (une image du soin qu’ils prennent) et ils rassemblent les bons dans des récipients (ou : vaisseaux), tandis qu’ils sortent les mauvais du filet, les jettent dehors et les y laissent. Ils s’occupent des bons, pas des mauvais. Comme habituellement les récipients sont la propriété de ceux à qui appartient aussi le filet, ce traitement des poissons jette une lumière particulière sur l’œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Il voudrait non seulement voir les Siens séparés de toute sorte de mal, mais aussi Il voudrait les voir amenés et réunis dans des « récipients », dans des communautés locales. Pour cela Il utilise ses serviteurs, qu’Il a munis de discernement et force spirituels.
N’est-elle pas heureuse cette pensée de réunir dans des récipients ? La chrétienté peut bien se détacher de plus en plus de toutes les valeurs chrétiennes, et s’éloigner de Dieu et de l’ordre de Dieu ; elle va courir toujours plus rapidement vers l’effondrement final, l’apostasie complète de Dieu. Pourtant, avant que le jugement la frappe, les serviteurs de Christ sont à l’œuvre. Instruments dans Sa main, ils amènent les croyants dans des assemblées locales, selon ce qui correspond à Sa pensée. Même si nous n’en avons qu’une indication ici, l’enseignement sur l’assemblée dans son caractère général et son caractère local est pleinement développé plus tard dans le Nouveau Testament, spécialement dans l’épître aux Corinthiens.
Les « récipients » appartiennent au Seigneur, et Ses saints y trouvent protection et bénédiction. La parabole de l’esclave fidèle et du méchant esclave de Matthieu 24 n’est-elle pas en heureuse harmonie avec la belle manière d’agir des pêcheurs ici ? Le Seigneur a du personnel, et Il prend soin de ceux qui appartiennent à Sa maison. C’est pourquoi Il a établi un esclave sur son personnel, pour qu’en Son absence, il leur donne la nourriture convenable au moment convenable. Il apprécie tellement ce service (chrétien), qu’Il dit : « bienheureux sont ces esclaves, que le maître, quand il viendra, trouvera faisant ainsi (Matthieu 24 v. 45 et 46) ». Il ne s’agit pas ici de l’annonce de l’évangile, mais du soin pris envers ceux qui sont dedans, le service au vrai sens chrétien.
Dans cette parabole de Matthieu 24 dont on vient de parler, pas plus que dans celle du filet et des poissons, on ne trouve de changement des personnes. L’esclave établi par le Seigneur sur Son personnel est le même qui vit encore à la venue du Seigneur. Il en est aussi de même dans la parabole des dix vierges. Les vierges sorties au commencement sont les mêmes que celles qui, à la venue de l’époux, entrent aux noces avec Lui. Il en est de même ici. Les pêcheurs qui ont jeté le filet dans la mer, sont les mêmes qui, quand il est plein, rassemblent les bons poissons dans les récipients. Quelle leçon faut-il en retirer ? Que l’Écriture n’a déterminé aucun espace de temps important jusqu’au retour du Seigneur pour les Siens. Il vient bientôt ! Attendons-Le donc chaque jour !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILET (action des anges) (5) - Sommes-nous conscients que nous vivons les derniers moments du temps de la grâce ?
Nous avons déjà vu que les pêcheurs sont d’abord occupés avec les bons poissons, les justes. Ils les rassemblent dans des récipients. Avec les mauvais poissons, ils n’ont rien d’autre à faire que de les jeter dehors. Mais à la consommation du siècle, c’est le contraire qui se passe : « les anges sortiront, et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu (Matthieu 13 v. 49 et 50) ». Les pêcheurs avaient séparés les bons poissons du milieu des mauvais (les professants sans vie), et ils les avaient mis dans des récipients. À l’inverse, les anges ne sont pas occupés des bons, mais des méchants. Ils les séparent du milieu des justes, et les jettent finalement dans la fournaise de feu. N’est-il pas clair qu’il s’agit de deux scènes différentes ?
Il s’ensuit que la parole du Seigneur « il en sera de même à la consommation du siècle » ne doit pas être interprétée avec l’explication qui suit, comme s’Il avait dit « de la même manière que décrit dans la parabole, les choses se passeront aussi à la consommation du siècle ». Bien plutôt, avec le « de même », le Seigneur amène à ce qu’Il a encore à dire, à savoir ce qui doit se passer à la consommation du siècle : « les anges sortiront… ». Cependant, entre les événements dans la parabole et dans l’explication, il y a un parallèle : les deux ont lieu aux derniers jours. Les pêcheurs développent leur activité quand le filet est plein, c’est-à-dire au moment de la fin du temps de la grâce. Les anges entrent en action quand est achevé (= consommé) le siècle dans lequel le royaume des cieux existe en mystère.
Quand le Seigneur Jésus dans Son grand discours prophétique de Matthieu 24 en vient à parler de la venue du Fils de l’homme, Il leur montre le même ordre : « Alors deux hommes seront au champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; deux femmes moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée (Matthieu 24 v. 40 et 41) ». Ceux qui seront « pris », seront emportés pour le jugement, tandis que ceux qui seront « laissés » seront laissés ici pour le royaume. À l’enlèvement des saints qui aura eu lieu auparavant, ce sera exactement l’inverse : ceux qui seront enlevés sont les croyants, et ils iront avec le Sauveur dans la maison du Père ; mais ceux qui resteront, sont les incrédules, et ils resteront ici, pour être jugés.
Quand nous considérons ces événements sérieux, nous ne voulons pas nous contenter d’un exposé aussi précis que possible, mais nous voulons laisser s’exercer sur nos cœurs l’impression reçue. Il faut nous demander : sommes-nous prêts pour la venue du Seigneur ? Sommes-nous conscients que nous vivons les derniers moments du temps de la grâce ? Nous soucions-nous de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne craignent pas les pleurs et les grincements de dents ? Réalisons-nous la séparation selon Dieu de toute sorte de mal ? Avons-nous un attachement particulier pour ceux qui sont dedans, et exerçons-nous notre service envers eux ? Tout ce que le Seigneur a exprimé est tout à fait pratique et utile pour nous-mêmes, et aussi pour que ce soit utile à d’autres.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (les deux ) (1) - Exemple de ce qu’il y a deux manières d’entendre.
« Mais que vous en semble ? Un homme avait deux enfants ; et venant au premier, il dit : Mon enfant, va aujourd’hui travailler dans ma vigne. Et lui, répondant, dit : Je ne veux pas ; mais après, ayant du remords, il y alla. Et venant au second, il dit la même chose ; et lui, répondant, dit : Moi j’y vais, seigneur ; et il n’y alla pas. Lequel des deux fit la volonté du père ? Ils lui disent : Le premier. Jésus leur dit : En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l’avez pas cru ; mais les publicains et les prostituées l’ont cru ; et vous, l’ayant vu, vous n’en avez pas eu de remords ensuite pour le croire (Matthieu 21 v. 28 à 32) ».
Cette parabole est un autre exemple de ce qu’il y a deux manières d’entendre. Nous l’avons déjà vu dans des paraboles précédentes. Les deux fils entendent le commandement du père. L’un refuse d’obéir, mais le regrette plus tard, et fait finalement la volonté de son père. L’autre promet d’obéir, mais ne tient pas sa promesse. Il est autant désobéissant que s’il avait refusé d’obéir dès le début. Mais par sa promesse de faire la volonté du père, il trompe les autres : ils le prennent pour un fils obéissant. Le père peut-il être content d’une attitude si entièrement opposée à la promesse faite, et qui, finalement, n’est rien d’autre que de l’hypocrisie ?
Si nous regardons le contexte, l’explication de la parabole n’est pas difficile. En fait, le Seigneur la donne lui-même. Dans l’image du fils qui regrette sa désobéissance initiale, et qui finit par aller, Il parle des « publicains et des prostituées ». Ce sont de tels pécheurs notoires que la prédication du précurseur du Seigneur avait amenés à la conviction de leurs péchés, et elle les avait introduits dans le royaume de Dieu.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (les leçons ) (2) - La propre justice rend les hommes hypocrites, mais en outre elle les aveugle sur le besoin de se repentir.
Mais les conducteurs du peuple ressemblaient au deuxième fils, l’honorant de leurs bouches, mais n’y allant pas. Comme le peuple d’Israël disait autrefois à Moïse : « Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons », eux aussi prétendaient obéir à Dieu. Ils se donnaient une apparence de piété, mais au fond de leurs cœurs, ils ne s’intéressaient pas à la volonté du « père », qu’ils n’ont d’ailleurs jamais faite.
C’est une leçon sérieuse que nous avons à apprendre ici. Non seulement la propre justice rend les hommes hypocrites, mais en outre elle les aveugle sur le besoin de se repentir. C’est ce qui est tragique, c’est le piège insidieux auquel se font prendre, non pas tellement les « publicains et les prostituées », mais surtout les hommes « religieux ». Ils n’ont jamais manqué ni ne manquent jamais de bonnes résolutions. Beaucoup ont déjà dit : « J’y vais, Seigneur », mais ils n’ont jamais mis un pied sur le chemin de l’obéissance qui commence par la repentance envers Dieu. Et c’est ainsi que les « publicains et les prostituées » en arrivent à précéder les hommes religieux dans le royaume de Dieu.
Ce que le Seigneur dit des conducteurs spirituels en Israël en particulier, et des hommes religieux en général, nous parle aussi à nous, enfants de Dieu. Mettons-nous bien dans la tête que Dieu voudrait que nos paroles et nos actes soient en accord les uns avec les autres, de même que ce que nous promettons avec ce que nous faisons effectivement. C’est là l’enseignement de notre parabole. D’autres paraboles montrent la nécessité qu’il y ait accord à d’autres égards. Dans la parabole du « serviteur impitoyable », nous avons dû apprendre qu’il faut un accord entre le pardon dont nous avons fait l’expérience, et celui que nous devons accorder à notre frère. Qu’il doive y avoir également accord entre ce que nous entendons et ce que nous faisons, c’est ce que nous enseigne la parabole des « deux maisons ». La nécessité de l’accord entre notre racine et notre fruit était le sujet de la parabole du « semeur ». Car c’est seulement dans la mesure où nous « poussons des racines en bas » que nous pouvons « porter du fruit en haut (voir 2 Rois 19 v. 30) ».
Notre parabole nous montre donc deux sortes d’hommes. Une rébellion franche contre le père, mais ensuite la repentance, c’est ce qui caractérise les premiers. Une profession fausse, et jamais de regrets, voilà ce qui caractérise l’autre. Dans la peau duquel des deux « fils » te ranges-tu ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (1) - Ces deux fils du père ne représentent pas des enfants de Dieu déjà « nés de nouveau » par la grâce de Dieu, mais des hommes naturels dans leur position et leur responsabilité devant Dieu.
Cette parabole part de la vie de la famille. Elle comprend deux parties comme on peut aisément s’en rendre compte en comparant les versets 24 et 32. Dans la première partie il est question du comportement du plus jeune fils (15 v. 11 à 24), et dans la seconde partie il s’agit du comportement du fils aîné (15 v. 25 à 32). Dans chacune de ces parties, on voit le père : dans la première partie, il reçoit le fils perdu, et dans la seconde, il supplie instamment le fils propre-juste : « Et il dit : Un homme avait deux fils (Luc 15 v. 11) ».
Cette phrase introductive de la parabole indique l’origine de l’homme en tant que créature : c’est une créature de Dieu, et il a son origine en Dieu. Je dis « indique » parce que nous n’avons pas ici d’enseignement, mais bien une allusion à ce sujet. La doctrine elle-même sur le sujet se trouve dans l’épître aux Éphésiens (4 v. 6) : « un seul Dieu et père de tous, qui est au-dessus de tous et partout et en nous tous ». Ce que veut nous dire ce passage, c’est que, comme Créateur, Il est Dieu et Père de tous les hommes. C’est aussi dans ce sens que Paul disait à l’Aréopage d’Athènes : « et il a fait d’un seul sang toutes les races des hommes… car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit : Car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu… (Actes 17 v. 26 à 29) ». En Luc 3 v. 38, l’origine d’Adam est rattachée directement à Dieu : « d’Adam, de Dieu ».
Le fait que nous provenions de la main de Dieu en tant que créature de Dieu, qu’Il ait jadis soufflé dans les narines de l’homme une respiration de vie (Genèse 2 v. 7), ce n’est pas du tout une question secondaire. Si elle était si secondaire, le diable ne l’aurait pas tant combattue par la théorie de l’évolution, par laquelle il cherche à mettre Dieu de côté en tant que Créateur, aux yeux des hommes. Effectivement, notre responsabilité vis-à-vis de notre Créateur réside dans le fait que nous avons été créés à l’image de Dieu et selon Sa ressemblance (Genèse 1 v. 26), et que nous sommes ainsi des créatures de Dieu douées d’intelligence et de raison. Nous ne sommes pas seulement responsables directement et personnellement vis-à-vis de Dieu parce que, dans Sa bonté, Il nous a confié en tant que Ses créatures, des dons et des capacités, mais parce que, ayant été formés à Son image, nous sommes responsables de manifester Dieu dans ce monde par le moyen de ces capacités ; car l’« image » signifie la « représentation ». C’est pourquoi tout homme Lui doit l’obéissance.
L’homme peut ne pas comprendre grand-chose de la Bible, et même ne rien avoir entendu au sujet de Christ ; mais le fait reste qu’Il a un Créateur qui lui a fait connaître Sa puissance éternelle et Sa divinité par le moyen de la création visible, et ce fait rend l’homme responsable devant Dieu, et le rend inexcusable (lire Romains 1 v. 18 à 25).
Encore un point pour prévenir des pensées erronées : Ces deux fils du père ne représentent pas des enfants de Dieu déjà « nés de nouveau » par la grâce de Dieu, mais des hommes naturels dans leur position et leur responsabilité devant Dieu, à qui ils doivent leur existence. L’homme né dans ce monde n’est pas du tout « né de Dieu », bien qu’il ait Dieu pour Créateur. Ni le fait d’avoir des parents chrétiens, ni le fait d’avoir été baptisé chrétiennement, ne fait de lui un enfant de Dieu, c’est-à-dire quelqu’un né de Dieu. Il faut en plus la conversion, le fait de se tourner vers Dieu en croyant, comme nous le verrons au cours de notre parabole.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (2) - S’éloigner de Dieu pour ne faire que sa propre volonté, c’est le principe du péché.
« et le plus jeune d’entre eux dit à son père : Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s’en alla dehors en un pays éloigné ; et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche (Luc 15 v. 12 et 13) ». Le principe et le secret du péché sont mis ici très fortement en relief : Le plus jeune fils voulait s’en aller loin du père pour pouvoir faire entièrement sa propre volonté. Le principe du péché n’est pas proprement une vie de débauche ; elle en est plutôt le résultat. Mais s’éloigner de Dieu pour ne faire que sa propre volonté, c’est le principe du péché ; c’est l’iniquité (une marche sans loi, sans frein) selon le langage de 1 Jean 3 v. 4. Le premier acte du jeune homme est la source de tout son malheur ; il tourne le dos au père pour disposer de sa vie sans lui, et être heureux sans lui.
En fait, c’est le chemin, l’histoire de tout homme. Depuis que le péché est entré dans le monde par le premier homme, l’homme va son chemin, comme Caïn, loin de la face de Dieu, pour faire ce qui lui plait (Genèse 4 v. 16). N’est-ce pas extrêmement sérieux ? Où qu’on regarde dans le monde, on voit ce principe à tout bout de champ, c’est lui qui régit le monde. Combien de jeunes gens, aujourd’hui, répudient littéralement tout lien avec le foyer paternel, et le quittent dès que possible pour avoir leur indépendance, c’est-à-dire pour faire leur propre volonté. Ce principe d’indépendance de Dieu et de propre volonté imprègne le monde tout entier, à tous les niveaux et dans tous les domaines. C’est le péché au sens propre.
Nous sommes profondément meurtris si nos enfants nous traitent comme le plus jeune fils a traité son père. Mais, l’avons-nous mérité de leur part ? Avons-nous négligé de leur apporter beaucoup d’amour et de soins ? Et voilà maintenant qu’ils nous tournent froidement le dos ! Le père de notre parabole était-il un homme dur, sans amour, dont on cherchait à s’enfuir au plus vite ? Le reste de l’histoire montre tout le contraire. Cependant le jeune homme était très pressé de partir loin. « Peu de jours après » dit l’Écriture. Le père n’a-t-il pas dû souffrir de cette situation ? Nous sommes tous allés, chers amis, sans exception, par ce triste chemin ; nous avons tous péché contre Dieu, et nous Lui avons pour ainsi dire tourné le dos, pour nous en aller notre propre chemin : « Nous nous sommes tournés chacun vers notre propre chemin (Ésaïe 53 v. 6) ». Le psalmiste David nous éclaire, pour ainsi dire, sur ce « peu-de-jours-après », en disant que « les méchants se sont égarés dès la matrice » (= dès le ventre de leur mère), qu’« ils errent dès le ventre (Psaume 58 v. 3) ». Y avons-nous déjà pensé ? Avons-nous déjà eu sur ce sujet les sentiments convenables pour Dieu ?
Nous arrivons maintenant à un autre point. En tant qu’hommes, nous faisons des différences entre les pécheurs, et ces différences existent effectivement. Nous n’avons pas tous vécu dans la débauche, bien que quelques-uns d’entre nous, nous étions tels (1 Corinthiens 6 v. 11). D’autres ont eu une conduite extérieurement tout à fait honorable. Mais si nous regardons la racine de notre péché, et si nous considérons le cœur de l’homme, ces différences disparaissent totalement. En ce qui concerne l’état de l’âme du plus jeune fils, il n’était pas un plus grand pécheur lorsqu’il désirait manger des gousses des pourceaux que quand il tournait le dos à son père. Le mal réside dans le cœur qui voulait être heureux sans son père.
Il en est ainsi pour tout homme par nature : son cœur, et par suite sa volonté, sont aliénés de Dieu. Répétons-le : chacun ne s’est pas livré pareillement à la débauche, mais nous sommes tous allés dans un pays éloigné pour vivre loin de Dieu. Et le Seigneur Jésus prend justement en exemple ce jeune fils dégradé pour montrer jusqu’où la grâce de Dieu peut aller.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (3) - Dieu permet à l’homme de faire ce qu’il veut de ce qu’Il lui a confié.
Le père n’avait pas défendu à son plus jeune fils de s’en aller. Au contraire nous lisons : « il leur partagea son bien (15 v. 12) ». C’est ainsi que Dieu n’empêche pas l’homme de choisir sa propre volonté. Toutefois, Il le met à l’épreuve en lui remettant son bien : on allait voir ce qu’il en ferait. L’homme est responsable de ses actes. En un sens, Dieu permet à l’homme de faire ce qu’il veut de ce qu’Il lui a confié. Mais cela ne fera que manifester où se dirige son cœur. Combien cette pensée nous sonde ! Le sage prédicateur l’exprime de cette manière : « Seulement, voici, j’ai trouvé que Dieu a fait l’homme droit (n’est-ce pas un grand « bien » ?) ; mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnements (Ecclésiaste 7 v. 29) ».
Le jeune homme se figurait être tout à fait bien dans le « pays éloigné », éloigné de Dieu. Mais était-il heureux ? Il avait du bien, et il le dilapidait. Quand on vit au-dessus de ses moyens, on parait riche et heureux aux autres. Mais l’est-on réellement ? Cela ne tarde pas à mal tourner. J’ai dit que les hommes ont emporté un « bien » provenant de leur Créateur, et qu’ils Lui en sont redevables et qu’ils en sont responsables vis-à-vis de Lui. Dieu les a dotés d’un esprit, d’une âme, d’un corps avec des capacités qui font clairement voir que tout cela provient de la main d’Un bien plus grand qu’eux. Et maintenant Dieu veut qu’ils utilisent ces capacités à Le glorifier « de peur que tu ne donnes ton honneur à d’autres, et tes années à l’homme cruel ; de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien… et que tu ne gémisses à ta fin, quand ta chair et ton corps se consumeront ; et que tu ne dises : Comment ai-je haï l’instruction, et mon cœur a-t-il méprisé la répréhension ? (Proverbes 5 v. 9 à 12) ».
Or les hommes sans Dieu ne tiennent pas compte de ces avertissements et gaspillent leurs forces à des buts de propre volonté, à des projets vains, en bref pour le péché. Il leur arrive dans cette situation de dégager une certaine gaîté et une certaine insouciance, en sorte qu’on pourrait presque croire qu’ils sont vraiment heureux. Ils se hâtent de passer de joie en joie, d’aventure en aventure.
Mais c’est justement ce qui montre qu’ils sont dans le « pays éloigné ». Ils sont à la chasse au bonheur justement parce qu’ils ne l’ont pas encore trouvé. Pauvres gens ! Ils papillonnent de fleur en fleur. Ils ornent leurs fêtes et leurs maisons, mais quant à leur âme, ils vivent au-dessus de leurs moyens, et ils se minent eux-mêmes. Laissez-les donc seuls ne serait-ce qu’un jour, et vous verrez combien ils sont dans le creux et le vide. Il suffit que Dieu porte un peu atteinte à leur santé, et leur âme éprouve tout le néant et la vanité de leurs efforts.
Les hommes de ce monde sont très sensibles quand on leur parle de leur bonheur ; car leur bonheur n’est pas réel, leur gloire n’est pas authentique et leur joie est passagère. Tout est creux et ne supporte pas la réflexion. Les plus grands comiques et farceurs, qui font rire des milliers de gens, si l’occasion est donnée de voir derrière leur façade extérieure, ce sont les plus tristes et les plus solitaires des gens. Ils dilapident « leur bien » avec leurs fans, et quand vient la « famine » pour eux, ils se trouvent soudain seuls. C’est ce que décrivent les versets suivants : « Et après qu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là ; et il commença d’être dans le besoin. Et il s’en alla et se joignit à l’un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l’envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient ; et personne ne lui donnait rien (Luc 15 v. 14 à 16) ».
L’homme qui tourne le dos à Dieu, malgré toute sa prétendue sagesse, malgré tout son savoir et ses efforts, toute sa chasse aux plaisirs et au bonheur, le voilà qui se dégrade moralement toujours plus. Il s’appauvrit dans son âme. Tôt ou tard, comme le plus jeune fils, il commence à être dans le besoin, et il se retrouve finalement auprès des « troupeaux de pourceaux ». Le diable ne donne rien, il ne fait que prendre. C’est pourquoi il n’y a aucune satisfaction réelle dans le « pays éloigné ».
N’as-tu encore rien éprouvé de semblable ? Tu t’étais représenté une soirée très belle, et à vrai dire tout avait été gai et charmant. Mais ce qu’il en est resté, c’est l’insipide, un sentiment de vide, même si le péché ne s’y rajoutait pas pour charger la conscience. Non, ce monde n’a rien qui peut réellement satisfaire ton âme, ou la rassasier : « Tout est vanité et poursuite du vent (Ecclésiaste 2 v. 17) ».
Je suis convaincu que c’est Dieu qui a suscité la famine dans le pays éloigné pour que le plus jeune fils « revienne à lui-même ». Mais celui-ci ne repense pas encore à son père, quand le besoin ne se fait encore sentir de manière trop sensible. Non, il se tourne vers l’homme pour avoir de l’aide : il se joint à l’un des citoyens de ce pays-là. Ce citoyen le connaît bien, car il a beaucoup contribué à lui faire gaspiller son bien. Certainement celui-là l’aidera, car il est lui-même tombé dans le besoin. Ah ! le diable et le monde sont de mauvais rémunérateurs, et même extrêmement mauvais ! Ils font tout payer très cher, ils ne donnent rien, et ils ne rendent jamais. Ils exigent un prix élevé pour leurs demi-mesures, pour leurs solutions de remplacement, pour leurs semblants de bonheur : c’est le prix de l’âme, et ensuite ils abandonnent l’homme nu et affamé. « Il désirait remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient ; et personne ne lui donnait rien (15 v. 16) ». C’est une expérience cruelle : « personne ne lui donnait rien ». Ne l’as-tu pas faite, toi aussi ? Il n’y en a qu’UN qui peut réellement donner, qui veut donner : c’est Dieu. Mais on ne veut pas de Lui.
On se dit heureux tant que tout va comme on veut, tant qu’on est en bonne santé et qu’on a du succès. Mais que vienne la « famine », la maladie, la détresse, les revers, et le prétendu bonheur s’écroule comme un château de cartes. Ce qui est bouleversant, c’est que même la « famine » n’amène pas les hommes à Dieu. « Tu les as frappés, mais ils n’en ont point ressenti de douleur ; tu les as consumés, ils ont refusé de recevoir la correction ; ils ont rendu leurs faces plus dures qu’un roc, ils ont refusé de revenir (Jérémie 5 v. 3) ». L’homme cherche refuge auprès de l’homme, auprès de la chair, mais non pas auprès de Dieu. Le tout dernier auquel on pense, c’est Dieu. Y a-t-il quelque chose qui montre mieux à quel point l’homme est éloigné de Dieu ? Oh, il n’y a rien de plus de misérable, rien de plus pitoyable, hormis la damnation éternelle, que d’habiter dans le « pays éloigné » !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (4) - Nous arrivons ici à un tournant significatif dans la vie du jeune homme : il revient à lui-même.
« Et étant revenu à lui-même, il dit : Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim ! Je me lèverai et je m’en irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes mercenaires (Luc 15 v. 17 à 19) ».
Nous arrivons ici à un tournant significatif dans la vie du jeune homme : il revient à lui-même. C’est sans aucun doute l’œuvre de Dieu dans Sa bonté. C’est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, non pas la peur de Dieu (Romains 2 v. 4). C’est Dieu Lui-même qui fait naître chez lui la conscience de son véritable état. Maintenant il ne voit pas seulement qu’il est dans le besoin (cela ne suffit guère pour conduire à Dieu), mais qu’il périt. C’est là qu’il faut en arriver dans le pays éloigné : se rendre compte qu’on périt de faim.
Mais la bonté de Dieu fait encore autre chose, quelque chose de très précieux : elle réveille dans l’âme la conscience qu’heureusement il y a du pain, assez de pain, dans la maison du père à laquelle il a autrefois tourné le dos avec tant d’ingratitude, et même il y en a plus qu’assez pour les ouvriers (mercenaires). La bonté de Dieu attire le cœur de celui qui sait qu’« il périt ici ». Et ainsi la grâce produit dans le cœur le désir d’aller à Dieu. « Je me lèverai et je m’en irai vers mon père ».
Le fils perdu ne prend pas la bonne résolution de s’améliorer avant de pouvoir se présenter devant son père. Nombreux, malheureusement, sont ceux qui font l’inverse. Ils ne commencent pas par reconnaître leur état misérable, et quand ils le reconnaissent, ils veulent d’abord se sauver eux-mêmes, pour pouvoir se présenter devant Dieu avec leurs propres forces. Ils devront tous apprendre un jour la vérité du proverbe selon lequel « le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions ».
Non, le fils perdu est venu à bout de lui-même, sa conscience est réveillée et son cœur attiré. La bonté de Dieu a éveillé la confiance en son père dans son for intérieur, et il est tout à fait prêt à s’en aller vers son père, comme il dit. Il exprime pour ainsi dire les mêmes paroles qu’Éphraïm : « Car, après que j’ai été converti, je me suis repenti ; et, après que je me suis connu, j’ai frappé sur ma cuisse ; j’ai été honteux, et j’ai aussi été confus, car je porte l’opprobre de ma jeunesse (Jérémie 31 v. 19) ». C’est le point auquel il faut tous que nous en arrivions un jour, si nous ne voulons pas rester éternellement loin de Dieu ; et c’est ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner ici.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (5) - Conversion, repentance et confession.
Se lever et s’en aller vers son père, c’est ce que l’Écriture appelle en bien des passages, la conversion. « Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés (Actes 3 v. 19) », dit Pierre à ses compatriotes juifs. L’apôtre Paul annonce aussi aux hommes « de se repentir et de se tourner vers Dieu, en faisant des œuvres convenables à la repentance (Actes 26 v. 20) ». On se convertit de quelque chose vers ou à quelque chose : « pour qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu ; pour qu’ils reçoivent la rémission des péchés (Actes 26 v. 18) », « comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai (1 Thessaloniciens 1 v. 9) ».
Nous voyons ce principe présenté dans l’histoire du fils perdu d’une manière qui se grave facilement dans nos mémoires. Jusqu’à présent il avait tourné le dos à son père, et son visage s’était tourné de son père vers les choses du monde. Mais maintenant il se détourne du monde, et son visage se dirige vers son père. Il n’a pas encore le père, il ne sait pas encore comment il le recevra ; autrement dit, il n’a encore aucune paix, mais il veut aller à lui. « Et se levant, il vint vers son père (15 v. 20) ». C’est la conversion.
La conversion, si elle est authentique, est toujours accompagnée de la repentance. La repentance ne veut pas dire des exercices de repentance. La repentance est un changement de sentiments, et elle est toujours accompagnée d’une tristesse d’âme selon Dieu en rapport avec son propre état et ses propres voies. Aussi lisons-nous : « Car la tristesse selon Dieu opère une repentance à salut dont on n’a pas de regret (2 Corinthiens 7 v. 10) ». Il ne s’agit pas non plus d’un changement purement logique de ses sentiments, comme on change de chemise, mais on a honte de soi-même, on a honte d’avoir déshonoré Dieu si profondément. Cette tristesse d’âme conduit tout à fait naturellement à une confession du péché devant Dieu : « et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de tes ouvriers (mercenaires) (15 v. 18 et 19) ». Qu’il est difficile pour l’homme de faire une confession pareille ! Combien il faut souvent de temps, combien d’expériences amères il faut d’abord traverser, avant d’en arriver finalement à se condamner soi-même et à avouer sa culpabilité !
Mais le chemin du salut passe par la confession de la culpabilité ; cette confession est le fruit qui convient à la repentance.
« Quand je me suis tu » a dû confesser David, « mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour… Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas couvert mon iniquité ; j’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché (Psaume 32 v. 3, 5) ». Le fils de David, le sage Salomon exprime cette vérité par le Saint Esprit de la manière suivante : « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde (Proverbes 28 v. 13) ».
« De la bouche on fait confession à salut (Romains 10 v. 10) », dit l’Esprit de Dieu par le moyen d’un autre homme de Dieu, l’apôtre Paul. Et combien est précieuse et assurée la promesse de Dieu que nous trouvons dans la première épître de Jean : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité (1 Jean 1 v. 9) » ! Même si nous n’avons pas encore épuisé toute la plénitude de ces versets, retenons-en déjà ceci : Ce qui suit la confession des péchés, c’est la rémission (le pardon) des péchés, de tous les péchés. Dieu est fidèle et juste quand Il nous pardonne les péchés. Il y a un point que je dois souligner ici, même s’il dépasse le cadre de notre parabole :
Le chemin vers Dieu passe par Golgotha.
Le Père pardonne (remet) les péchés à cause du nom de Son Fils (« par son nom » 1 Jean 2 v. 12), qui a accompli l’œuvre d’expiation de notre culpabilité à la croix. Et Il ne pardonne qu’à celui qui croit en Son Fils, Jésus Christ : « crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison » - « Tous les prophètes lui rendent témoignage, que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés (Actes 16 v. 31 ; 10 v. 43) ». Christ est le chemin vers Dieu, et personne ne vient au Père que par Lui (Jean 14 v. 6). La rédemption ne se trouve que dans le Christ Jésus (Colossiens 1 v. 14). « Et il n’y a de salut en aucun autre ; car aussi il n’y a point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés (Actes 4 v. 12) ». « Ce n’est rien moins et rien d’autre que le sang de Jésus Christ qui nous purifie de tout péché (1 Jean 1 v. 7) ».
Revenons maintenant à la confession du plus jeune fils ; elle comprend plusieurs points auxquels il n’y a rien à redire ; c’était une confession authentique, une preuve de la foi et de la vie nouvelle, et le père la reçoit. Cela devrait encourager tous ceux qui sont repentants. Les sentiments du fils ne vont pas encore très en profondeur, car non seulement il n’était effectivement plus digne d’être appelé son fils, mais il avait mérité de rester éloigné pour toujours de la maison du père, et d’être jeté dans les ténèbres de dehors. Il n’était plus « digne » de rien d’autre. Le plus jeune fils ajoute encore : « Traite-moi comme l’un de tes ouvriers (mercenaires) » ; ceci montre que dans une mesure il était encore rempli d’un esprit légal, car en vérité il ne se connaissait pas lui-même, ni ne connaissait son père et son amour. Il n’en avait pas entièrement fini avec lui-même, et il n’était pas encore arrivé à reconnaître que seule la grâce, et rien d’autre que la grâce ne devait et ne pouvait remédier à sa situation. Mais au fond de son cœur, il y avait une véritable conscience de son péché et de sa culpabilité, même si cette conscience était encore bien faible ; et comme il se confiait en la bonté du père, il se mit en route pour venir devant son père avec la confession de sa culpabilité.
Cher lecteur, dis-moi si tu as déjà parcouru ce chemin ? Le diable veut à tout prix te retenir de t’y engager. Il veut exciter ton orgueil ; il te dit qu’il n’est pas nécessaire de t’incliner : si seulement les gens étaient tous aussi bons que toi ! Ou bien il cherchera à insuffler le doute en toi pour que tu ne sois pas sûr si Dieu veut vraiment t’avoir et te recevoir. Pourtant, regarde combien le père rend facile au fils de venir à lui. Regardons cela d’un peu plus près.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (6) - Le père ne fait pas le moindre reproche au fils, mais il se jette à son cou, alors qu’il est revêtu de haillons, et le couvre de baisers. Il l’accueille tel qu’il est, et l’aime malgré tout.
« Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers (Luc 15 v. 20) ». Il n’est pas dit du fils qu’il « courut ». Son pas était peut-être plutôt hésitant maintenant qu’il était en chemin vers son père. L’incertitude et la honte devaient se mêler à l’espérance, et son pas se ralentir. Mais le père « courut », courut en avant vers son fils, qui venait à lui en haillons. Il l’avait déjà vu quand il était encore loin. Manifestement, il l’attendait depuis longtemps. L’état misérable de son fils dégradé n’était qu’une raison pour lui d’être ému à son sujet. Ni rancune, ni colère ni le moindre reproche !
« Il ne reproche rien », à l’occasion de maintes défaillances plus tard sur son chemin, combien l’auteur de ces lignes a souvent expérimenté et goûté la grâce « que le Seigneur est bon (1 Pierre 2 v. 3) ». Non, le père ne fait pas le moindre reproche au fils, mais il se jette à son cou, alors qu’il est revêtu de haillons, et le couvre de baisers. Il l’accueille tel qu’il est, et l’aime malgré tout. Merveilleuse grâce, amour merveilleux de Dieu dont nous avons ici l’esquisse ! « Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés (Éphésiens 2 v. 4) ». Cet amour de Dieu envers nous, a été démontré en ce que « Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous (Romains 5 v. 8) ». Nous nous souvenons instinctivement des paroles précieuses du même chapitre (Romains 5 v. 20) : « Là où le péché abondait, la grâce a surabondé ». C’est une vérité infinie que nous ne pouvons jamais saisir en entier, mais que nous pouvons croire : DIEU EST POUR NOUS (Romains 8 v. 31). Que Dieu, dans toute Sa grâce, soit aussi juste, beaucoup de passages de l’Écriture en rendent témoignage (par exemple Romains 3 v. 21 à 26 ; 1 Jean 1 v. 9).
Notons bien : avant que le fils ait pu tant soit peu commencer la confession qu’il avait prévue, son père se jette à son cou, et le couvre de baisers. C’est un amour vraiment immérité, la grâce ! Alors le fils dégage sa conscience : « père, j’ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ». Ne sommes-nous pas frappés de ce qu’il ne dit pas « traite-moi comme l’un de tes mercenaires » ? L’aurait-il pu en face d’un tel amour ? Impossible ! Cela aurait été une sous-estimation de l’amour de son père. Apprenons cependant ceci dans notre cœur : Dieu nous traite selon l’amour de Son cœur, parce qu’Il est amour, non pas parce que nous sommes aimables ! Nous pensons souvent que Dieu devrait agir selon ce que nous comprenons de Lui, selon ce que nous ressentons de Lui. Et si nous pensons à notre misère, nous disons volontiers : « traite-moi comme l’un de tes mercenaires ». Cela a bien une apparence d’humilité, mais cela restreint la grandeur de Dieu dans Son amour d’une manière insupportable.
Les gens, et même les vrais enfants de Dieu ont souvent de la difficulté à propos de la grâce de Dieu, parce qu’ils se mettent sur un terrain légal, et qu’ils jugent ainsi de Dieu et de Ses actes d’après eux-mêmes. Ainsi par exemple, beaucoup de vrais chrétiens se contenteraient tout à fait d’un « petit coin au ciel », de n’importe quelle petite place modeste, là. Or celui qui a de telles pensées méconnaît Dieu, et il ne sait pas encore ce qu’est réellement Son amour. Dieu agit d’après ce que Lui ressent et pense, oui, d’après ce que Lui est. Un « petit coin au ciel » correspond-il à la merveilleuse grandeur de Sa grâce et de Son amour ? Une place modeste, pour ne pas dire médiocre, ne témoignerait-elle pas continuellement à l’encontre de Son amour, comme cela aurait été le cas si le père avait donné à son fils à son retour la place d’un ouvrier (mercenaire) ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (7) - Le retour du fils perdu ne produit pas seulement de la joie au ciel, mais aussi sur la terre, dans la maison du père.
« Mais le père dit à ses esclaves : Apportez dehors la plus belle robe, et l’en revêtez ; et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds ; et amenez le veau gras et tuez-le ; et mangeons et faisons bonne chère ; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère (Luc 15 v. 22 à 24) ». C’est la joie de Dieu de ramener le pécheur et de le recevoir. C’est Sa joie de pardonner tous ses péchés. Certes le pécheur a besoin du pardon des péchés, il l’obtient par la foi en Christ et en Son œuvre, et il a toute raison de s’en réjouir. Or ici, comme dans les deux paraboles précédentes, il ne s’agit pas tant de la joie du pécheur, mais de la joie de Dieu Lui-même. « Il fallait faire bonne chère et se réjouir » lisons-nous un peu plus loin. C’est le père lui-même qui se réjouit, et il se réjouit avec ses serviteurs. Le retour du fils perdu ne produit pas seulement de la joie au ciel, mais aussi sur la terre, dans la maison du père. Car nous ne devons pas déplacer cette scène au ciel. Elle n’est pas une image de ce que nous vivrons au ciel ; mais c’est plutôt l’esprit du ciel, si l’on peut dire, que nous pouvons déjà respirer ici-bas sur la terre, et qui aboutit à l’adoration. C’est la joie de Dieu de nous avoir dans Sa présence.
Nous chrétiens, combien nous sommes peu souvent en état de nous élever à ces pensées ! Nous sommes beaucoup occupés de ce que nous étions, et de ce que nous sommes maintenant par grâce. C’est correct en soi ; la confession du fils, aussi, était correcte ; mais l’amour du père l’empêche de parler davantage, et c’est Lui, le père, qui parait au premier plan, c’est Lui qui parle et qui agit. Il ne parle pas au fils, mais aux serviteurs : « Apportez la plus belle robe, et l’en revêtez ». C’est la joie du père de donner, et de donner sans mesure. Maintenant rien n’est trop bon pour le fils de retour. La plus belle robe, l’anneau, les sandales, tout est apporté (nous allons le voir bientôt) à celui qui est encore dehors, à l’extérieur de la maison, là où son père l’a rencontré.
C’est incontestablement très significatif. Le père ne fait pas apporter la plus belle robe, pour ne se jeter à son cou et le couvrir de baisers qu’après l’en avoir revêtu. Non, il court à sa rencontre et l’embrasse alors qu’il est encore dans ses haillons. La grâce et le cœur de Dieu sont donc parfaitement ouverts au pécheur repentant, sans qu’il y ait à attendre aucune prestation préalable. Ah ! que tout lecteur de ces lignes puisse se réfugier dans les bras grand ouverts du « Père », sur Son cœur ! Et qu’il le fasse maintenant, immédiatement ! Lui aussi sera alors reçu sans condition, et il pourra vivre dorénavant ce qu’on va maintenant voir en image avec le fils perdu, mais retrouvé.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (8) - Le fils doit être amené dans la maison du père, c’est-à-dire dans la communion intime avec lui et avec son foyer.
Cet amour qui a reçu le fils perdu dans son état de misère, l’amène maintenant dans la maison du père. Mais quelque chose d’autre doit se passer. « Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez, et mettez un anneau à sa main, et des sandales à ses pieds ». Maintenant qu’il ne s’agit plus seulement de l’accueil et du pardon des péchés ; maintenant que le fils doit être amené dans la maison du père, c’est-à-dire dans la communion intime avec lui et avec son foyer, il faut le revêtir de la plus belle robe que le père a pour lui. Le plus jeune fils n’avait jamais porté auparavant cette plus belle robe ; comme l’anneau et les sandales, ce que seuls les enfants de la maison portaient, cette plus belle robe est un témoignage de la relation de grâce dans laquelle il est maintenant introduit. Il ne doit pas se trouver dans la maison du père comme un serviteur : ce serait un rappel continuel de son péché. Non, c’est comme fils qu’il doit y être. Il doit être, dans la maison du père, un témoignage continuel à ce que sont l’amour et la grâce du père, à ce que celui-ci pense de son fils retrouvé, et à la joie qu’il a de l’honorer ainsi.
Merveilleuse grâce de Dieu ! Elle nous revêt de Christ. Non seulement elle nous libère de nos haillons, mais elle nous revêt de Christ. La plus belle robe que Dieu a pour nous, c’est Son propre Fils (Galates 3 v. 27), c’est Christ qu’Il a livré à la mort pour les pécheurs. Dieu ne nous a pas seulement pardonné par le (à cause du) nom de Son Fils (1 Jean 2 v. 12), mais nous sommes devenus « justice de Dieu » en Lui (2 Corinthiens 5 v. 21). Ce sont en fait des vérités infinies, et, faisons-y attention, elles ont finalement pour but la glorification de Son Fils.
Mais ce n’est pas tout, et ce n’est pas suffisant. « Amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chère ». Le veau gras est aussi une image de Christ, comme nourriture de Son peuple. Dieu a Sa joie profonde dans la Personne et dans le sacrifice de Son Fils, notre Seigneur ; et nous sommes rendus dignes de participer déjà maintenant à cette joie. C’est ce dont nous avons une image ici dans ces paroles « mangeons et faisons bonne chère ».
Naturellement, la joie du Père en Son Fils Jésus Christ est parfaite. La nôtre, du point de vue de la jouissance pratique, est très déficiente. Mais quant au principe, c’est la même joie : la joie du Père au sujet de Son Fils. En fait, c’est la communion dont nous pouvons nous réjouir dans la maison du Père, ce domaine de bénédictions où la grâce de Dieu nous a introduits. « Or notre communion est avec le Père, et avec Son Fils Jésus Christ » dit l’apôtre Jean, à quoi il ajoute « nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie (1 Jean 1 v. 3 et 4) ». Dans notre parabole aussi, la joie est le résultat de la communion avec le Père et avec Son Fils : « et ils se mirent à faire bonne chère ». C’est une joie commune, c’est la joie de la communion.
Il est parlé du commencement de cette joie, mais nous n’entendons pas dire qu’elle ait une fin. Nous apprenons la raison de cette joie et son point de départ, mais c’est tout ce qu’il en est dit. C’est comme si le Seigneur voulait laisser à notre foi et à notre intelligence spirituelle le soin de conclure qu’elle n’aura jamais de fin. Effectivement, elle ne finira jamais. Elle trouvera son plein accomplissement au ciel quand nous verrons et adorerons l’« Agneau comme immolé (Apocalypse 5) ».
« Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère (Luc 15 v. 24) ». Notez l’expression du Seigneur : le fils était « mort ». J’insiste spécialement là-dessus parce que nous l’avons déjà vu avec la « drachme perdue ». Bien que vivant, le fils était mort, mort pour le père. Ainsi l’homme loin de Dieu est mort pour Dieu. Mais par la grâce de Dieu le fils est éveillé à une vie nouvelle, il est « passé de la mort à la vie (Jean 5 v. 24) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FILS (prodigue) (9) - Le fils aîné murmurait contre la grâce dont le père avait usé en faveur du plus jeune fils.
La joie et la gaîté remplissaient la maison du père. Mais aux v. 25 à 32 de notre parabole, le Seigneur Jésus montre une autre scène où l’on voit au dehors des nuages noirs s’amonceler à l’horizon. Le frère aîné revient des champs à la maison et entend la musique et les danses. Il s’informe de la raison, et on lui dit : « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré sain et sauf (15 v. 27) ». « Ton frère », « ton père », ces expressions auraient dû éveiller des sentiments heureux, mais voilà le contraire qui arrive : colère et opposition surgissent chez lui. Il se fâche et ne veut pas entrer. Pourquoi donc ?
C’était un propre-juste. Le Seigneur Jésus s’en sert comme image de tous ceux qui n’ont pas de relation vivante avec Dieu, mais qui pensent qu’ils peuvent se présenter devant Dieu avec leur propre justice.
Ce fils aîné murmurait contre la grâce dont le père avait usé en faveur du plus jeune fils. Les pharisiens et les scribes étaient le même genre de gens. Eux aussi s’étaient scandalisés de ce que le Seigneur recevait les pécheurs et mangeait avec eux. Eux-mêmes n’entraient pas dans le royaume des cieux, et ils ne laissaient pas entrer ceux qui le voulaient (Matthieu 23 v. 13). « Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer (15 v. 28) » : cela a toujours été l’attitude des Juifs propres-justes. Quand plus tard, l’apôtre Paul annoncera la parole de la grâce de Dieu, ce seront les Juifs qui seront ses opposants continuels. En voici un exemple tiré des Actes (13 v. 45) : « mais les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et contredirent à ce que Paul disait, contredisant et blasphémant ».
Le propre-juste n’a aucun cœur pour la bonté de Dieu envers les perdus. Il a de la haine pour la grâce parce qu’il ne la veut pas et ne la connaît pas, et parce qu’il pense ne pas en avoir besoin. C’est pourquoi il n’a aucune part à la joie de la grâce ; elle lui est insupportable. Par le fait que le fils aîné était « aux champs », le Seigneur Jésus indique que l’homme religieux, propre-juste, n’est pas seulement loin de la maison du Père, mais qu’il est aussi actif, et qu’il veut mériter le ciel quelle qu’en soit la manière. La parole du fils aîné le souligne encore plus : « Voici tant d’années que je te sers, et jamais je n’ai transgressé ton commandement (15 v. 29) ». Toutes les nombreuses personnes qui se vantent d’une profession chrétienne, et qui cherchent à satisfaire Dieu par toute la peine qu’elles se donnent, sont sur ce terrain de l’autosatisfaction et de la propre justice.
Les Juifs sous la loi se mettaient aussi sur ce terrain-là. Comme nation, ils avaient été mis au bénéfice d’une rédemption extérieure et d’une relation extérieure avec Dieu, et c’était la seule nation sur la terre à avoir une telle position. C’est aussi la raison pour laquelle le père dit au fils aîné qui personnifie cette nation : « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi (15 v. 31) ». Ce fils aîné représente aussi tous ces gens qui, de manière déplorable, pensent ne pas avoir besoin de la grâce de Dieu, et pouvoir se tenir devant Dieu sur la base de leurs propres œuvres.
Malgré la bonté du Père et son insistance, il n’a pas été possible de le décider à changer d’attitude. Enflé de sa bonne opinion de lui-même, il est en colère et reproche au père de ne jamais lui avoir donné un chevreau pour faire bonne chère avec ses amis. « Avec ses amis », non pas avec son père ! Combien cela est caractéristique ! L’amitié du monde n’est-elle pas inimitié contre Dieu (Jacques 4 v. 4) ? Ainsi le propre-juste a l’audace de prendre la parole contre Dieu, de condamner ce qu’Il fait, et de L’accuser d’injustice. Il se considère lui-même comme quelqu’un qui L’a servi depuis déjà de nombreuses années, et qui n’a jamais transgressé aucun commandement de Dieu.
Un de mes lecteurs se trouverait-il encore sur ce terrain ? Serais-tu d’avis que Dieu peut se satisfaire de toi parce que tu fais tant de bonnes œuvres « sur le champ » de l’amour chrétien du prochain, parce que tu t’efforces tant d’être « noble, secourable et bon » ? Oh ! alors tu n’as pas besoin d’un Sauveur. Pas TOI ! Car le Seigneur Jésus n’est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs (Luc 5 v. 32). Réfléchis bien à ce que le fils aîné, propre-juste, selon le tableau dressé par notre parabole, n’est jamais entré dans la maison du père. Préfères-tu rester dehors, dehors pour toujours ? « Dehors sont les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge (Apocalypse 22 v. 15) ».
Certes, le Seigneur Jésus ne parle pas ici de jugement, parce que dans cette parabole, Il décrit le jour de la grâce. Mais soyons assurés que quiconque refuse la grâce, sera condamné au jour du jugement. Il faut que tu en viennes à voir tes prétendues justices comme Dieu les voit, comme un « vêtement souillé (Ésaïe 64 v. 6) » ! Nous préférons détourner les regards du fils aîné, et les porter encore une fois sur le plus jeune fils, autrefois perdu, et maintenant retrouvé. Revêtu de la plus belle robe, il est entré dans la maison du Père, pour ne plus la quitter jamais. Un bonheur sans fin en partage : être amené du pays éloigné jusque dans la maison du Père où il y a une plénitude de joie, et cela pour l’éternité !
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• FRUIT - De quelle nature est le fruit que nous portons ?
« Chaque arbre se connaît à son propre fruit » nous dit Luc 6 v. 44. De quelle nature est le fruit que nous portons ? Dans ses paraboles, le Seigneur souligne que « le Père » cherche du fruit. Dans celle des cultivateurs (Matthieu 21 v. 33 à 41 ; Marc 12 ; Luc 20), le maître envoie ses esclaves pour recevoir du fruit de sa vigne, mais n’obtient rien. II envoie même son « fils unique », mais ne recueille pas une grappe de plus. La vigne n’a-t-elle rien rapporté ? Au contraire, mais les cultivateurs ont gardé le fruit pour eux.
N’est-ce pas trop souvent notre image ? Combien n’avons-nous pas reçu du Seigneur ? À quoi et pour qui employons-nous tous ces avantages ? Pour Lui ou pour nous-mêmes ? Pourtant « il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui qui pour eux est mort et a été ressuscité ! (2 Corinthiens 5 v. 15) ». Comme d’entre les morts étant faits vivants, nous sommes appelés à nous livrer nous-mêmes à Dieu, et nos membres comme instruments de justice (Romains 6 v. 13). Le faisons-nous ? Ou tout notre travail, nos membres et nous-mêmes, sont-ils réservés à notre seul et égoïste usage ?
Dans la parabole du « figuier stérile (Luc 13 v. 6 à 9) », le maître vient chercher du fruit, mais n’en trouve point. Les cultivateurs n’ont pas ici gardé le fruit pour eux-mêmes, mais l’arbre n’en a pas produit. Avec patience, le maître est revenu trois ans de suite : sans résultat ! « Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ? » Le figuier serait coupé, n’était l’intercession du vigneron, type du Seigneur Jésus, qui va encore prendre soin de l’arbre et voir s’il ne portera quand même pas quelque fruit. Sommes-nous sûrs, quant à nous-mêmes, « d’occuper utilement la terre » ?
La parabole du semeur avait rappelé que tous ne produisent pas du fruit dans la même mesure, mais l’un trente, l’un soixante et l’un cent. En Jean 15, le Seigneur montre que le Père ôte le sarment qui ne porte pas de fruit. S’il y a du fruit, le Père nettoie le sarment afin qu’il porte plus de fruit. Si nous demeurons en Christ, il y aura beaucoup de fruit et le Père sera glorifié. Dans la parabole des cultivateurs, le Fils est l’envoyé du Père ; dans celle du figuier stérile, l’Intercesseur ; ici, la source même de tout fruit, le vrai cep ; mais toujours c’est le Père qui cherche du fruit et qui, s’il y en a, est glorifié.
Le fruit se marque davantage dans ce que l’on est (Galates 6 v. 22 à 23), dans l’attitude, le caractère, la personnalité. Le service se traduit par des actes : ce que l’on fait. Mais les deux vont ensemble et ne peuvent être séparés : « portant du fruit en toute bonne œuvre ». Ce que nous faisons compte, mais plus encore, comment nous l’accomplissons. L’activité, ou la soi-disant activité, pour le Seigneur, de quelqu’un qui ne porterait pas de fruit, dont la conduite démentirait l’activité, serait un bien mauvais témoignage, sinon un piège. Par contre, même dans l’inaction forcée (maladie ou prison), où ne resterait peut-être que le service de la prière, éventuellement de la correspondance, la semence qui a pris racine dans le cœur ne pourrait-elle rapporter du fruit au centuple ?
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• FOI (vivre par) - La foi est comme une ancre ; elle établit réellement une personne.
« Mais le juste aura la vie et vivra par la foi (Romains 1 v. 17) ». C'est la règle normale pour la vie des croyants. Nous sommes enclins à vivre de l'excitation des joies visibles et des bénédictions évidentes. Mais la Parole de Dieu dit que « le juste aura la vie et vivra par la foi ». Beaucoup de croyants désirent avoir la révélation de Dieu ; ils aspirent à une transformation noble, et à des expériences de « troisième ciel ». Certains peuvent parfois les rencontrer, mais les justes doivent vivre par la foi. L'union dans la vie qu'a vécue par exemple Madame Guyon se retrouve rarement de nos jours. Elle a dit que son expérience était telle qu'il lui était impossible de vivre autrement. Elle n'a pu atteindre cet état que par la foi et l'abnégation.
De nombreux croyants sont profondément attristés parce qu'ils n'ont pas un sentiment conscient de la présence de Dieu. En conséquence, ils crient à Dieu de tout leur être, cherchant Dieu comme le cerf cherche un courant d'eau. La foi ne consiste pas à toucher la présence de Dieu. Ce n'est pas L'aimer dans l'excitation ou s'exprimer dans l'exubérance. Le juste vivra par la foi, par la foi seule. La foi est comme une ancre ; il établit une personne. La foi est réelle ; c'est une « justification », la foi est aussi une « conviction des choses qu'on ne voit pas ». Elle est donc palpable.
Ceux qui marchent par la foi peuvent avoir une joie extérieure. Mais ce n'est pas ce qu'ils recherchent ; ce n'est pas leur but. La foi peut faire ce que rien d'autre ne peut faire. Premièrement, cela peut plaire à Dieu : « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire (Hébreux 11 v.6) ». C'est la vie de notre Seigneur Jésus, car il a dit : « Je fais toujours les choses qui lui plaisent (Jean 8 v. 29) ».
Deuxièmement, elle porte du fruit : « Qui par la foi a vaincu des royaumes, accompli la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, été fortifié dans la faiblesse, devenu puissant à la guerre, mis en déroute les armées des étrangers. Les femmes ont reçu leurs morts par la résurrection... (Hébreux 11 v. 31 à 35) ». Cependant, même si certains résultats sont obtenus, il faut continuer à avancer résolument par la foi. Il nous faut croire en Dieu et avoir foi que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres.
En vivant par la foi, la gloire serait tout autour de nous. Cependant, ceux qui vivent par la foi ne verront pas eux-mêmes cette gloire. De nombreuses leçons de foi sont très profondes et essentielles. Moïse ne s'est pas rendu compte que son visage brillait, mais ceux qui ont vu cette gloire ont été bénis. Un fait immuable est que ceux qui vivent par la foi doivent se tourner vers le Seigneur Jésus : « ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi (Hébreux 12 v. 2) ». Si quelqu'un fait cela, cela se reflétera dans ses paroles, sur son visage, et son attitude influencera autour de lui. Cette vie est bien au-delà de toute description, les justes vivront par la foi.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• FOI (obéissance) (1) - On ne peut être réellement chrétien sans avoir une foi profonde et entière dans le Dieu vivant.
La foi va de l’avant dans l’obéissance à la Parole de Dieu, s’élève au-dessus des circonstances et fait confiance au Seigneur pour qu’Il pourvoie à tous ses besoins. Celui qui désire accomplir des exploits pour Dieu doit d’abord se confier totalement à Lui. « Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu’ils comptaient sur la présence de Dieu avec eux » — Hudson Taylor
Maintenant, la foi véritable s’appuie toujours sur quelque promesse de Dieu, quelque passage de sa Parole. C’est une chose très importante. Le croyant commence par lire ou entendre une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit s’empare de cette promesse et l’applique à son cœur et à sa conscience d’une façon toute personnelle. Le chrétien comprend alors que Dieu lui a parlé directement. Avec une confiance absolue dans l’honnêteté de Celui qui lui a fait une promesse, il accepte de considérer ce qui a été promis comme si c’était déjà un fait accompli, alors même, humainement parlant, que la chose paraît impossible.
Ou peut-être s’agit-il d’un ordre plutôt que d’une promesse. Pour la foi, cela ne fait aucune différence. Si Dieu commande, Il donne les qualités nécessaires pour exécuter l’ordre. S’Il ordonne à Pierre de marcher sur les eaux, Pierre peut avoir l’assurance que le pouvoir dont il a besoin lui sera accordé (Matthieu 14 v. 28). S’Il nous ordonne de prêcher l’Évangile à toute créature, nous pouvons compter sur la grâce nécessaire (Marc 16 v. 15).
La foi n’opère pas dans le domaine du possible. La gloire de Dieu n’éclate pas dans ce qui est humainement possible. La foi commence là où la capacité humaine finit : « Le domaine de la foi commence où les probabilités cessent et où la vue et les sens ne peuvent plus atteindre » (Georges Muller).
La foi dit : « Si impossible est la seule difficulté, alors cela peut être fait ».
« La foi fait entrer Dieu en scène, et dès lors, elle ne sait absolument pas ce que signifie le mot difficulté, en fait, elle se rit des impossibilités. Au jugement de la foi, Dieu est la réponse suprême à toutes les questions, la solution définitive de chaque difficulté. Elle fait tout dépendre de Lui ; c’est pourquoi la foi n’accorde pas la moindre importance au fait qu’il s’agisse de six cent mille euros ou de six cents millions d'euros, elle sait que Dieu peut tout. Elle trouve toutes ses ressources en Lui. L’incrédulité dit : Comment une telle chose pourrait-elle se faire ? Elle est pleine de « COMMENT », mais la foi a une seule réponse à des milliers de « Comment », et cette réponse c’est Dieu » (C. H. Mackintosh).
Humainement parlant, il était impossible à Abraham et Sara d’avoir un enfant. Mais Dieu avait promis, et pour Abraham il n’existait plus qu’une seule impossibilité, que Dieu ait menti : « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit « telle sera ta postérité ». Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet Il peut aussi l’accomplir (Romains 4 v. 18 à 21) ».
« La foi, la foi puissante s’empare des promesses et regarde à Dieu seul. Elle se rit des impossibilités et s’écrie : Cela sera ! » Notre Dieu est le Dieu qui se joue des impossibilités (Luc 1 v. 37). Rien n’est trop difficile pour Lui (Genèse 18 v. 14) : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu (Luc 18 v. 27) ». La foi se saisit de la promesse : « Tout est possible à celui qui croit (Marc 9 v. 23) », et exulte avec l’Apôtre Paul en disant : « Je puis tout par celui (Christ) qui me fortifie (Philippiens 4 v. 13) ».
Le doute voit les obstacles — La foi, le chemin !
Le doute voit les ténèbres de la nuit — La foi, la lumière du jour !
Le doute craint de faire un pas — La foi s’élance vers les sommets.
Le doute interroge : « Qui croit ? » — La foi répond : « Moi ! »
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
• FOI (obéissance) (2) - On ne peut être réellement chrétien sans avoir une foi profonde et entière dans le Dieu vivant.
Parce que la foi a trait au surnaturel et au divin, elle ne semble pas toujours « raisonnable ». Pour Abraham, ce n’était pas toujours « raisonnable ». Pour Abraham, ce n’était pas faire preuve de « bon sens » que de partir sans savoir où il allait, par simple obéissance à l’ordre de Dieu (Hébreux 11 v. 8). Ce n’était pas très « malin » de la part de Josué d’attaquer Jéricho sans faire usage d’armes offensives (Josué 6 v. 1 à 20). Les gens du monde ne manqueraient pas de se moquer de telles « insanités ». Et pourtant, cela a réussi !
En fait, la foi est très raisonnable. Qu’y a-t-il de plus raisonnable pour une créature que d’avoir confiance en son Créateur ? Est-ce être insensé que de croire en Celui qui ne peut ni mentir, ni faillir, ni errer ? Mettre sa confiance en Dieu est la chose la plus sensée, la plus sage et la plus raisonnable qu’un homme puisse faire. Il n’est pas question d’un saut dans le noir. La foi réclame des points d’appui solides et elle les trouve dans la Parole infaillible de Dieu. Jamais personne n’a mis ni ne mettra sa confiance en Lui en vain. La foi au Seigneur ne comporte pas le moindre risque.
La foi glorifie vraiment Dieu ; elle Lui rend justice en Lui attribuant la place qui Lui convient comme étant Celui qui est absolument digne de confiance. D’autre part, l’incrédulité déshonore Dieu ; elle Le fait menteur (1 Jean 5 v. 10). Elle met des entraves au Saint d’Israël (Psaume 78 v. 41).
La foi donne aussi à l’homme la place qui lui convient, celle d’un humble suppliant, prosterné dans la poussière devant le Souverain Maître de l’univers. La foi est opposée à la vue. Paul nous rappelle que « nous marchons par la foi et non par la vue (2 Corinthiens 4 v. 7) ». Marcher par la vue veut dire s’appuyer sur des choses visibles, avoir des réserves pour l’avenir, utiliser les ressources de l’intelligence humaine pour s’assurer contre des risques invisibles. Marcher par la foi, au contraire, c’est se reposer sur Dieu seul, à tout instant. C’est un perpétuel état de dépendance de Dieu.
La chair se refuse à adopter une position de complète dépendance envers un Dieu qu’elle ne voit pas. Elle essaye de se prémunir contre des pertes éventuelles. Si elle ne peut prévoir, elle fait de la dépression nerveuse. Mais la foi, elle, va de l’avant dans l’obéissance à la Parole de Dieu, s’élève au-dessus des circonstances et fait confiance au Seigneur pour qu’Il pourvoie à tous ses besoins. Tout disciple qui prend la détermination de vivre par la foi peut être assuré que celle-ci sera mise à l’épreuve. Tôt ou tard il arrivera à la limite de ses ressources humaines. Dans une situation désespérée, il sera tenté de faire appel aux hommes. Mais s’il a réellement mis sa confiance dans le Seigneur, il se tournera vers Lui seul.
« Faire connaître mes besoins à un être humain, directement ou indirectement, constitue un abandon de la vie de la foi, et une atteinte positive à l’honneur de Dieu. C’est en fait une trahison à son égard. Cela revient à dire que Dieu m’a déçu et que j’en suis réduit à attendre du secours des hommes. C’est abandonner la source vive pour se tourner vers des citernes crevassées. C’est placer la créature entre mon âme et Dieu et, par-là, dérober à mon âme une riche bénédiction et à Dieu l’honneur qui Lui est dû » (C. H. Mackintosh).
L’attitude normale du disciple est de désirer que sa foi augmente (Luc 17 v. 51). Il a déjà fait confiance à Christ pour son salut. Maintenant il essaye de soumettre toujours davantage les détails de sa vie au contrôle de Dieu. Au fur et à mesure qu’il rencontre la maladie, les difficultés, les drames et les chagrins. Il en arrive à connaître Dieu d’une façon nouvelle et plus intime et sa foi en est fortifiée. Plus il fait l’expérience que Dieu est digne de confiance, et plus il est désireux de se fier à Lui pour attendre de Lui de plus grandes choses.
Puisque la foi vient de ce qu’on entend et que ce que l’on entend vient de la Parole de Dieu, le disciple devrait se saturer des Saintes Écritures — les lire, les étudier, les mémoriser, les méditer jour et nuit. Elles sont sa carte et sa boussole, son guide et son réconfort, sa lampe et sa lumière.
Dans la vie de la foi, il y a toujours du chemin à parcourir. Lorsque nous lisons le récit des choses qui ont été accomplies par la foi, nous nous rendons compte que nous sommes semblables à des petits enfants qui jouent au bord d’un océan sans bornes.
Les exploits de la foi nous sont rappelés dans Hébreux 11. Ils s’enflent en un majestueux crescendo du verset 32 au verset 40 : « Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d’autres furent livrés aux tourments et n’acceptèrent point de délivrance afin d’obtenir une meilleure résurrection, d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection ».
Un mot pour terminer. Nous avons déjà dit qu’un disciple qui marche par la foi doit s’attendre à être considéré comme un rêveur ou un fanatique par les gens du monde et même par d’autres chrétiens. Mais il est bon de rappeler que la foi qui rend capable de marcher avec Dieu, rend capable aussi de ne pas attacher trop d’importance aux pensées des hommes !
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William MacDonald.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
G
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• GÉNISSE ROUSSE - Une forme exceptionnelle du sacrifice pour le péché.
Les vaches étaient rarement offertes en sacrifice. Cependant en Nombres 19, il était ordonné par Dieu qu’une génisse rousse, sans tare et qui n’avait point porté le joug, soit égorgée hors du camp et qu’il soit fait aspersion de son sang sept fois droit devant la tente d’assignation. Puis l’animal devait être brûlé, en même temps que du bois de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate étaient jetés au milieu du feu. La cendre était gardée en un lieu pur comme élément constitutif de l’eau de séparation.
Lorsqu’un Israélite s’était souillé en touchant un cadavre, un homme pur devait mettre de l’eau vive sur la cendre et, au moyen de l’hysope, il devait en faire aspersion sur les personnes ou sur les objets souillés. Le sacrifice de la génisse rousse était une forme exceptionnelle du sacrifice pour le péché, qui toutefois avait pour but non pas l’expiation des péchés, mais la purification de ceux qui appartenaient au peuple de Dieu au milieu duquel habitait l’Éternel. Le lavage des pieds en Jean 13 porte aussi ce caractère. Par la parole de Dieu, le Saint Esprit fait sentir la souillure à l’âme et la conduit à la confession, qui a pour conséquence le pardon et la purification de toute iniquité en vertu de l’œuvre expiatoire accomplie par Christ (1 Jean 1 v. 9 ; cf. Éphésiens 5 v.26).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• GERME - Les passages cités se rapportent au Messie à venir.
Dans l’Ancien Testament il y a deux mots hébreux de sens analogue qui sont traduits par « germe » ou « rejeton » : zemach (Ésaïe 4 v. 2 ; Jérémie 23 v. 5 ; 33 v. 15 ; Zacharie 3 v. 8 ; 6 v. 12) et nezer (Ésaïe 11 v. 1). Il est aisé de discerner que les passages cités se rapportent au Messie à venir, le Seigneur Jésus, qui selon Ésaïe 53 v. 2 « montera devant lui comme un rejeton, et comme une racine [hébr. schoresch] sortant d’une terre aride » (cf. Ésaïe 11 v. 10). Par sa désobéissance envers Dieu, Israël a perdu tous ses droits ; toutefois, quand l’accomplissement du temps est venu, Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils, « né de femme, né sous la loi », afin qu’il rachète ceux qui ne pouvaient être justifiés sous la loi et leur donne, oui, à tous ceux qui croient en lui, l’adoption (Galates 4 v. 4).
Les paroles de Matthieu 2 v. 23, «... en sorte que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen », ne se trouvent dans aucun livre prophétique de l’Ancien Testament. Matthieu les applique à la ville de Nazareth, où vécut Jésus. L’écrivain inspiré aura eu devant les yeux les prophéties mentionnées ci-dessus concernant le Germe de l’Éternel, le Messie, et, par l’Esprit, aura remplacé le substantif hébreu plus fréquemment utilisé zemach de Zacharie 6 v. 12 : « Voici un homme dont le nom est Germe... » par le substantif nezer en Ésaïe 11 v. 1, qui rappelle le nom de la ville méprisée de Galilée, Nazareth, lequel, de son côté, remonte à la même racine étymologique.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• GRAISSE - La graisse des animaux offerts en sacrifice parle en type de la force intérieure du Seigneur Jésus par laquelle il s’est offert en sacrifice à Dieu.
La graisse (hébreu chelev) d’un animal sain est sa réserve de force. Au sens positif, la graisse parle ainsi de la force intérieure cachée, de l’énergie et de ce qu’il y a de meilleur. Quand Abel offrit à Dieu le premier sacrifice mentionné dans la Bible, il apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse (Genèse 4 v. 4). En revanche, Caïn apporta les fruits de ses propres efforts sur le sol maudit par Dieu. Le sacrifice d’Abel exprime déjà la pensée que la graisse fait partie de la meilleure partie. Aussi en Nombres 18 v. 12, le mot hébreu pour la graisse est-il traduit par « le meilleur ». De plus il était spécifié dans la loi : « Toute graisse appartient à l’Éternel (Lévitique 3 v. 16) », et dans le même passage, il est dit deux fois que la graisse du sacrifice de prospérités était le pain de l’Éternel (Lévitique 3 v. 11). Ainsi la graisse des animaux offerts en sacrifice parle en type de la force intérieure du Seigneur Jésus par laquelle il s’est offert en sacrifice à Dieu.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• GRENADE - Symbole du fruit spirituel dans la sainteté.
 La grenade est un fruit très doux, de la grosseur d’une pomme. Il provient du Proche-Orient. Sur les bords tout autour de la robe du souverain sacrificateur israélite alternaient la reproduction d’une grenade et d’une clochette qui évoquent respectivement le fruit et le témoignage (Exode 28 v. 34). Les vêtements parlaient de la sainteté de Dieu et du service sacerdotal dans son sanctuaire (cf. Exode 28 v. 36). Des reproductions de grenades décoraient aussi le temple de Jérusalem (1 Rois 7 v. 18 et suiv.). Ainsi la grenade peut être considérée comme un symbole du fruit spirituel, particulièrement du fruit dans la sainteté (Jean 15 v. 1 à 8 ; Romains 6 v. 22), que peuvent porter tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et vivent en communion avec lui.
La grenade est un fruit très doux, de la grosseur d’une pomme. Il provient du Proche-Orient. Sur les bords tout autour de la robe du souverain sacrificateur israélite alternaient la reproduction d’une grenade et d’une clochette qui évoquent respectivement le fruit et le témoignage (Exode 28 v. 34). Les vêtements parlaient de la sainteté de Dieu et du service sacerdotal dans son sanctuaire (cf. Exode 28 v. 36). Des reproductions de grenades décoraient aussi le temple de Jérusalem (1 Rois 7 v. 18 et suiv.). Ainsi la grenade peut être considérée comme un symbole du fruit spirituel, particulièrement du fruit dans la sainteté (Jean 15 v. 1 à 8 ; Romains 6 v. 22), que peuvent porter tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et vivent en communion avec lui.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• GRENOUILLE - Elle parle certainement des influences démoniaques.
Par la laideur, aux yeux de l’homme, de sa nudité, la grenouille est peut-être une figure de l’impudicité sexuelle. Mais elle parle certainement des influences démoniaques, c’est-à-dire de deux dangers très proches l’un de l’autre. Lors de la deuxième plaie en Égypte, les grenouilles « montèrent » sur le pays, c’est-à-dire montèrent des lieux profonds de la terre (Exode 8 v. 1 à 7). En Apocalypse 16 v. 13, trois esprits immondes « comme des grenouilles » sortent de la bouche du dragon (Satan), de la bête (du chef de l’Empire romain) et du faux prophète (de l’Antichrist).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• GUILGAL - Le dépouillement des caractères du vieil homme.
Des trois ou quatre lieux différents, dans le pays de Canaan, qui portent le nom de Guilgal, celui qui est situé à l’ouest du Jourdain, « à l’extrémité orientale de Jéricho (Josué 4 v. 19) », est le plus significatif pour l’histoire d’Israël. Le nom hébreu signifie « cercle, roue, revirement, roulement ». Après la traversée du Jourdain, le peuple y dressa son premier camp dans le pays de Canaan et Josué y reçut de Dieu l’ordre de circoncire les fils d’Israël, car aucun d’entre eux ne l’avait été durant les quarante ans de voyage dans le désert. Une fois la circoncision exécutée à Guilgal, Dieu dit à Josué : « Aujourd’hui j’ai roulé de dessus vous l’opprobre de l’Égypte ». Ici le nom de Guilgal est lié au « roulement » de l’opprobre (Josué 5 v. 2 à 9). Si le passage à travers le Jourdain est un type de notre mort et de notre résurrection spirituelle avec Christ, ce dont rendent témoignage les douze pierres dans le Jourdain et sur l’autre rive (cf. Colossiens 2 v. 20 ; 3 v. 1),
La circoncision à Guilgal est alors l’expression de la mortification des membres, c’est-à-dire des manifestations de la chair, et du dépouillement des caractères du vieil homme (Colossiens 3 v. 5 à 9). C’est la réalisation pratique du fait que nous avons dépouillé le vieil homme. Aussi Guilgal était-il également le lieu de la force, auquel Josué retournait toujours (Josué 9 v. 6 ; 10 v. 6 à 15, 43 ; 14 v. 6).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
• GRENADES ET CLOCHETTES D'OR - Ces deux choses existaient le jour de la Pentecôte.

Les « grenades » et les « clochettes d'or » (Exode 28 v. 33 et 34) qui se trouvent sur les bords de la robe donnent à entendre que tout vrai fruit et tout vrai témoignage doivent être soutenus par le service sacerdotal et la grâce de Christ, et que de plus, ils sont célestes en caractère. Ces paroles : « Elle ne se déchirera pas (Exode 28 v.32) », donnent la pensée d'unité, et l'huile de l'onction descendait sur les grenades et les clochettes d'or. Ces deux choses existaient le jour de la Pentecôte ; des fruits de grâce céleste étaient portés par les saints, et quel son de clochettes d'or se faisait entendre alors ! Tout cela s'effectuait dans la puissance de l'onction, témoin vivant à Christ dans le ciel.
« Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service; et on en entendra le son quand il entrera dans le lieu saint, devant l'Éternel, et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas (Exode 28 v. 35) ». Le son de Christ doit être entendu pendant qu'Il est caché aux yeux des hommes, le son de tout ce qui se rapporte à « Son entrée » et le son de tout ce qui se rapportera à « Sa sortie » (Exode 28 v. 35). Tout cela doit être maintenu en témoignage.
Pensez à l'amour désintéressé qui conduisit tous les croyants à être en un même lieu, ayant toutes choses communes. « Nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui ; mais toutes choses étaient communes entre eux (Actes 4 v. 32) ». L'égoïsme naturel du cœur humain avait été déplacé par l'énergie de l'amour divin. Je crois que nous pouvons voir là les grenades, fruit plein de l'énergie de la vie. Aaron Je ne connais pas de fruit qui soit, plus que la grenade, rempli de graines, plus rempli de puissance productive. Il n'y a rien qui soit aussi énergique et aussi fécond que l'amour divin.
Il nous est dit qu'alors, « les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus; et une grande grâce était sur eux tous (Actes 4 v. 32 et 33) » : Ceci correspond, semble-t-il, aux clochettes d'or. Elles se firent entendre tout d'abord, le jour de la Pentecôte et depuis, elles n'ont pas cessé de rendre leur son. L'évangile est annoncé par le Saint Esprit envoyé du ciel et un témoignage est rendu à tout ce qui est en rapport avec la présence de Christ à la droite de Dieu. Bientôt, « il sortira (Exode 28 v. 35) », pour introduire le monde à venir et à cet égard aussi, le son de Christ se fait entendre.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• GUERRE (du chrétien) (1) - Le véritable christianisme est très loin de la façon habituelle de vivre de la chrétienté moderne.
Il est impossible de lire le Nouveau Testament, même de façon superficielle, sans remarquer que l’image de la guerre est souvent utilisée pour décrire le programme de Christ sur la terre. Il n’a rien de commun avec la recherche du luxe et des plaisirs que l’on rencontre partout aujourd’hui. Il se présente bien plutôt comme un combat acharné, un conflit incessant contre les forces de l’enfer. Nul disciple n’est digne de ce nom s’il ne se rend pas compte que la bataille est engagée et qu’il n’est plus question de tourner les talons.
En temps de guerre, l’unité doit se manifester. Ce n’est pas le moment de se permettre de vaines querelles, des jalousies partisanes, une quelconque infidélité. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C’est pourquoi les soldats de Christ doivent être unis. Le chemin de l’unité passe par l’humilité. Cette vérité est enseignée clairement dans Philippiens 2. Il faut au moins être deux pour se battre : « C’est par l’orgueil que viennent les disputes » ; où l’orgueil est absent, les disputes ne peuvent éclater. La guerre impose une vie d’austérité et de sacrifice. Dans les guerres de quelque importance, on instaure invariablement un vaste système de rationnement. Il est grand temps que les chrétiens comprennent que nous sommes en guerre et que les dépenses doivent être réduites au minimum pour que le maximum de nos ressources puisse être jeté dans la bataille.
Tous ne comprennent pas cela aussi clairement qu’un jeune disciple : R. M. En 1960, alors qu’il était président de classe dans un collège chrétien, on envisagea d’engager des dépenses pour la traditionnelle soirée des élèves, les vestes d’uniforme et l’achat du cadeau de la classe. Plutôt que d’approuver de telles dépenses qui ne contribueraient pas directement à la propagation de l’Évangile, R M. préféra démissionner de son poste de président. Voici la lettre qu’il fit circuler parmi ses camarades le jour où sa démission fut annoncée :
Chers amis,
Puisque la question de la soirée des élèves, des vestes d’uniforme et du cadeau de la classe est venue devant le Conseil de Direction, j’ai été amené, en tant que président, à considérer quelle devait être l’attitude chrétienne à l’égard de ces choses, je pense qu’en ce qui nous concerne, nous éprouverions une plus grande joie si nous nous donnions nous-mêmes, avec notre argent et notre temps, entièrement à Christ pour les autres. Nous ferions ainsi l’expérience de la réalité de ses paroles : « Celui qui perd sa vie à cause de Moi la retrouvera ».
Pour les chrétiens, le fait de dépenser leur argent et leur temps à des choses qui n’ont pas pour effet de rendre un témoignage précis devant les incroyants ou même de servir à l’édification de ses enfants en Lui, me semble inconciliable avec le fait que 7.000 personnes meurent de faim chaque jour et plus de la moitié des habitants du monde n’ont jamais entendu parler de l’unique espérance du genre humain. Dieu ne serait-il pas davantage glorifié si nous prenions à cœur de contribuer à faire pénétrer l’Évangile dans ces 60 pour cent du monde qui n’ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ou même simplement dans beaucoup de maisons du voisinage, au lieu de nous rassembler pour être entre nous, limitant notre cercle social à ceux qui partagent nos opinions et gaspillant du temps et de l’argent à rechercher notre propre désir ?
Puisque je connais des besoins précis et des possibilités d’intervention dans lesquels de l’argent pourrait être utilisé à la gloire de Jésus-Christ en apportant aide et secours à ceux qui sont auprès comme à ceux qui sont au loin, il m’est impossible de donner mon accord pour que les fonds de la classe soient dépensés inutilement pour nous-mêmes. Si j’étais l’un de ceux qui sont dans la détresse, comme je sais qu’il en existe tant, j’exigerais que ceux qui le peuvent fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire connaître l’Évangile et me soulager dans ma misère.
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ( Matthieu 7 v. 12) » ; « Mais si quelqu’un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? ( 1 Jean 3 v. 17) ».
C’est pourquoi, dans l’amour et la prière pour qu’il vous soit donné de voir le Seigneur Jésus se donnant Lui-même tout entier (2 Corinthiens 8 v. 9), je vous soumets par la présente ma démission de président de la classe 63.
En Lui avec vous. R.M.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William Macdonald.
• GUERRE (du chrétien) (2) - La guerre du chrétien impose des souffrances.
Si, aujourd’hui encore, des jeunes gens sont prêts à donner leur vie pour leur patrie, à combien plus forte raison les chrétiens devraient-ils être prêts à perdre leur vie pour l’amour de Christ et de l’Évangile ! Une foi qui ne coûte rien ne vaut rien. Si le Seigneur Jésus représente quelque chose pour nous, Il devrait être tout pour nous et aucune considération de sécurité personnelle ou de crainte de la souffrance ne devrait nous détourner du service que nous Lui devons.
Lorsque l’Apôtre Paul chercha à défendre son apostolat contre les attaques de ses détracteurs, il ne fit pas appel à l’honorabilité de la famille dont il était issu, ni à sa science ou à son rang social. C’est bien plutôt sur les souffrances qu’Il avait endurées pour l’amour du Seigneur Jésus-Christ qu’il attira l’attention : « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore ; par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et a la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises (2 Corinthiens 11 v. 23 à 28) ».
Dans le message qu’il adresse à son fils en la foi, Timothée, il l’adjure en ces termes : « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ (2 Timothée 2 v. 3) ».
La guerre réclame une obéissance absolue. Un fidèle soldat agira selon les ordres de ses supérieurs sans poser de questions et immédiatement. Il serait absurde de penser que Christ pourrait se satisfaire de moins. En tant que Créateur et Rédempteur, Il est en droit d’attendre de ceux qui ont décidé de Le suivre au combat une obéissance prompte et complète à ses ordres.
La guerre exige de l’adresse dans l’usage des armes. Les armes du chrétien sont la prière et la Parole de Dieu. Il doit s’adonner à la prière fervente, confiante et persévérante. C’est le seul moyen par lequel les forteresses de l’ennemi peuvent être renversées. Il doit aussi être habile à manier l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. L’ennemi va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’inciter a lâcher cette épée. Il va jeter le doute sur l’inspiration des Écritures. Il va tenter de faire ressortir de prétendues contradictions. Il va lui opposer des arguments tirés de la science, de la philosophie et des traditions humaines. Mais le soldat de Christ doit tenir ferme, en démontrant que son arme est efficace par l’usage qu’il en fait à temps et à contre temps.
Les armes du chrétien peuvent sembler ridicules à l’homme du monde. Le plan de campagne qui a amené la chute de Jéricho ne serait-il pas tourné en dérision par les chefs militaires d’aujourd’hui ? La faiblesse de l’armée de Gédéon ne les ferait-elle pas sourire ? Et que dire de la fronde de David, de l’aiguillon de Schamgar et de cette armée invraisemblable des fous de Dieu à travers les siècles ? Le chrétien sait que Dieu n’est pas du côté de ceux qui peuvent aligner le plus grand nombre de divisions, mais bien plutôt qu’Il aime à se servir de ce qui est faible, pauvre et méprisable pour sa gloire.
La guerre requiert une connaissance de l’ennemi et de sa stratégie. Il en est ainsi dans la guerre que mène le chrétien : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes (Éphésiens 6 v. 12) ». Nous savons que « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres (2 Corinthiens 11 v. 14 et 15) ».
Un soldat chrétien entraîné sait que ce n’est pas de la part d’un buveur, d’un voleur ou d’une prostituée qu’il rencontrera la plus forte opposition, mais bien plutôt de ceux qui font profession d’être ministres de la religion. Ce furent les chefs religieux qui clouèrent le Christ à la croix. Ce furent les chefs religieux qui persécutèrent l’Église primitive. C’est de la main de ceux qui se prétendaient serviteurs de Dieu que Paul eut à subir les plus féroces attaques. Il en a toujours été ainsi depuis. Les ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Ils parlent un langage religieux, ils portent des vêtements religieux et ils agissent avec une piété affectée, mais leur cœur est rempli de haine pour Christ et pour l’évangile.
La guerre requiert de la fermeté : « Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé (2 Timothée 2 v. 4) ». Le disciple de Christ apprend à être intransigeant à l’égard de tout ce qui pourrait venir se placer entre son âme et une complète consécration au Seigneur Jésus-Christ. Il sera bref sans être injurieux, ferme sans être discourtois. Il n’a qu’une seule passion. Tout le reste doit être maintenu en sujétion.
La guerre réclame du courage en face du danger : « C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme… (Éphésiens 6 v. 13 et 14) ».
On a souvent fait remarquer que l’armure du soldat chrétien, dans Éphésiens 6 v. 13 à 18, ne prévoit rien pour le dos et par conséquent rien qui le protège en cas de retraite. Pourquoi, d’ailleurs, battrait-il en retraite ? Si « nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés (Romains 8 v. 37) », si la victoire est assurée avant même que le combat n’ait été engagé, comment pourrions-nous jamais avoir la pensée de tourner les talons ?
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par William Macdonald.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
H
• HANCHE, REINS - Figure de la disposition à agir et du départ.
Les reins ou la hanche sont souvent employés comme figure du siège de la force et de l’énergie. Ces mots sont fréquemment en rapport avec la ceinture qui entoure les hanches et rassemble le vêtement ample, mais qui sert aussi de support pour les armes, spécialement pour l’épée (Exode 12 v. 11 ; 2 Samuel 20 v. 8 ; 1 Rois 12 v. 10). Ainsi les reins ceints sont également la figure de la disposition à agir et du départ.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HERBE, FOIN - Figure de la fragilité et du caractère éphémère de l’homme.
L’herbe, semblablement à la fleur, est une figure de la fragilité et du caractère éphémère de l’homme. Au psaume 90 v. 5 et 6, la vie de l’homme est comparée à l’herbe : « Comme un torrent tu les emportes ; ils sont comme un sommeil, au matin, comme l’herbe qui reverdit : au matin, elle fleurit et reverdit ; le soir on la coupe, et elle sèche ». En Ésaïe 40 v. 6, l’homme même est assimilé à l’herbe : « Toute chair est de l’herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L’herbe est desséchée, la fleur est fanée... » Dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi l’herbe comme figure de ce qui est éphémère (Matthieu 6 v. 30 ; 1 Pierre 1 v. 24 et 25). Cela s’applique aussi à l’herbe séchée en foin.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HOLOCAUSTE - Type saisissant du don du Fils de Dieu par le Père.
L’holocauste (hébreu ‘olah) est le plus élevé de tous les sacrifices de l’Ancien Testament. Aussi est-il cité en premier lieu dans l’énumération des différentes offrandes que les Israélites pouvaient ou devaient apporter (Lévitique 1). Il est déjà mentionné en Genèse 2 v. 22, lors du sacrifice d’Isaac, type saisissant du don du Fils de Dieu par le Père. L’holocauste devait être entièrement offert sur l’autel et être fumé comme « odeur agréable à l’Éternel » (le même verbe est aussi employé pour l’encens). À la différence des autres sacrifices, aucun homme ne pouvait manger quelque chose de l’holocauste, car il était destiné exclusivement à Dieu.
Selon son commandement, deux agneaux devaient être offerts chaque jour comme «holocauste continuel» à l’entrée de la tente d’assignation, l’un le matin et l’autre le soir, de telle sorte que l’odeur agréable monte continuellement vers l’Éternel. L’holocauste continuel, type de la bonne odeur incessante que le sacrifice de Christ répand devant Dieu, était le fondement de l’habitation de Dieu au milieu des fils d’Israël (Exode 29 v. 38 à 46). Les holocaustes étaient aussi apportés lors de toutes les fêtes de l’Éternel. L’holocauste nous présente la pensée de la propitiation en rapport avec les saintes exigences de Dieu, le sacrifice pour le péché, en revanche, en rapport avec nos besoins.
Christ, qui par son sacrifice à la croix est l’accomplissement de tous les sacrifices typiques, s’est livré lui-même comme holocauste « à Dieu, en parfum de bonne odeur », selon Éphésiens 5 v. 2 ; et par la foi en lui, nous avons aussi été « rendus agréables dans le Bien-aimé (Éphésiens 1 v. 6) ». Les holocaustes décrits en Lévitique 1, qui étaient apportés par les Israélites comme sacrifices volontaires, parlent par conséquent de l’adoration des rachetés. Nous pouvons apporter à Dieu, le Père, des « sacrifices de louanges » et des « sacrifices spirituels » (Hébreu 13 v. 15 ; 1 Pierre 2 v. 5). Celui qui présentait l’offrande exprimait son acceptation devant l’Éternel en posant sa main sur la tête de l’animal (cf. imposition des mains); de même nous pouvons nous aussi, dans la conscience de notre position parfaite en Christ, nous approcher du Père. Les différents degrés d’offrande (taureau, mouton, chèvre, colombe) parlent de l’intelligence plus ou moins grande de l’œuvre de la rédemption ; il est cependant dit chaque fois : « Un sacrifice par feu, une odeur agréable à l’Éternel ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HOMME, MÂLE - Il est « l’image et la gloire de Dieu ».
Abstraction faite de sa signification « être humain de sexe masculin » qui le différencie de la femme, l’homme est fréquemment le symbole de la force dans laquelle est réalisée une position conférée par Dieu. Ainsi pour l’holocauste et pour le sacrifice pour le péché d’un chef en Israël, une bête mâle était prescrite (Lévitique 1 v. 3 à 10 ; 4 v. 23), pour le sacrifice pour le péché de quelqu’un du peuple, une bête femelle (Lévitique 4 v. 28), alors que pour le sacrifice de prospérités, les deux étaient permises (Lévitique 3 v. 1 à 6). Dans le Nouveau Testament, il nous est dit : « Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez hommes, affermissez-vous (1 Corinthiens 16 v. 13) ». Ici l’homme est vu comme symbole de la force et de la fermeté. Cependant selon l’ordre de la création, l’homme est aussi le chef de la femme, car il est « l’image et la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 11 v. 3 à 7 ; Éphésiens 5 v. 23). Déjà dans l’Ancien Testament, une mise en garde est faite contre le mélange des positions, voulues de Dieu, de l’homme et de la femme : « La femme ne portera pas un habit d’homme, et l’homme ne se vêtira pas d’un vêtement de femme; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu (Deutéronome 22 v. 5) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HUILE, OLIVIER, OLIVE - Les aromates dans l’huile de l’onction parlent des gloires de Christ.
L’huile, obtenue par le broyage ou le pressurage des olives, était déjà dans l’Antiquité un produit important, qui était utilisé, selon la Bible, pour l’alimentation, l’éclairage et l’onction. Elle fournissait la lumière au chandelier dans la tente d’assignation (Exode 27 v. 20 ; Lévitique 24 v. 2 ; cf. Zacharie 4 v. 1 à 6 ; Apocalypse 11 v. 4). Les sacrificateurs (Exode 29 v. 7 à 21), les rois (1 Samuel 10 v. 1 ; 16 v. 13) et les prophètes (1 Rois 19 v. 16) étaient oints d’huile. L’huile est un type de la lumière, mais plus particulièrement de l’onction du Saint Esprit (Luc 4 v. 18 ; Actes 10 v. 38 ; 2 Corinthiens 1 v. 21 ; 1 Jean 2 v. 20 à 27). Ce fait, révélé seulement dans le Nouveau Testament, est déjà suggéré par l’onction de David pour roi d’Israël, car immédiatement après, l’Esprit de l’Éternel l’a saisi et est demeuré sur lui (1 Samuel 16 v. 13). Pour l’huile de l’onction, qui était utilisée lors de la consécration des sacrificateurs et de la tente d’assignation dans l’Ancien Testament, on devait prendre des « aromates les plus excellents » : 500 sicles de myrrhe franche, 250 sicles de cinnamome aromatique, 250 sicles de roseau aromatique, 500 sicles de casse et un hin d’huile d’olive (Exode 30 v. 22 à 33). « L’huile de l’onction sainte » ainsi obtenue ne pouvait pas plus que l’encens composé être produite ou utilisée à d’autres fins.
Les aromates dans l’huile de l’onction parlent des gloires de Christ que les croyants peuvent discerner. Nous le voyons en ce que pour ces aromates une mesure humaine et précise est indiquée. Même si la mesure était « le sicle du sanctuaire », elle demeurait néanmoins une mesure humaine. Pour la créature, tout a une mesure et une fin. Nous connaissons en partie. L’Ecriture sainte ne dit que du Seigneur que Dieu ne donne pas l’Esprit par mesure (Jean 3 v. 34) ; mais en raison de notre faiblesse, le Saint Esprit, représenté par « un hin d’huile », ne peut nous faire discerner et manifester que partiellement les perfections du Seigneur Jésus.
L’olive est mentionnée comme l’un des fruits du pays de Canaan (Deutéronome 8 v. 8). Elle est certes un type du fruit de l’Esprit (Galates 5 v. 22). L’olivier est parfois une figure de la place bénie qu’Israël prend sur la terre en relation avec son ancêtre Abraham (Jérémie 11 v. 16). En raison de leur incrédulité, Dieu a arraché les Juifs, dans le temps présent, comme des branches et a enté les nations à leur place (Romains 11 v. 16 à 24).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HOMME, MÂLE - Il est « l’image et la gloire de Dieu ».
Abstraction faite de sa signification « être humain de sexe masculin » qui le différencie de la femme, l’homme est fréquemment le symbole de la force dans laquelle est réalisée une position conférée par Dieu. Ainsi pour l’holocauste et pour le sacrifice pour le péché d’un chef en Israël, une bête mâle était prescrite (Lévitique 1 v. 3 à 10 ; 4 v. 23), pour le sacrifice pour le péché de quelqu’un du peuple, une bête femelle (Lévitique 4 v. 28), alors que pour le sacrifice de prospérités, les deux étaient permises (Lévitique 3 v. 1 à 6). Dans le Nouveau Testament, il nous est dit : « Veillez, tenez ferme dans la foi ; soyez hommes, affermissez-vous (1 Corinthiens 16 v. 13) ». Ici l’homme est vu comme symbole de la force et de la fermeté. Cependant selon l’ordre de la création, l’homme est aussi le chef de la femme, car il est « l’image et la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 11 v. 3 à 7 ; Éphésiens 5 v. 23). Déjà dans l’Ancien Testament, une mise en garde est faite contre le mélange des positions, voulues de Dieu, de l’homme et de la femme : « La femme ne portera pas un habit d’homme, et l’homme ne se vêtira pas d’un vêtement de femme; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu (Deutéronome 22 v. 5) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HUILE (onction) - Huile typifiant le Saint-Esprit de filiation, par lequel nous, la vraie « sacrificature royale », sommes scellés comme fils de Dieu.
Sous la Loi, l'onction était la cérémonie par laquelle les sacrificateurs étaient installés dans leur service. Ils étaient oints pour leur charge avec un onguent particulier appelé l’ « Huile de l'onction sainte ». Cette huile n'était employée que pour les sacrificateurs, et il n'était permis à personne d'autre d'en avoir ou d'en fabriquer (Exode 30 v. 25 à 33, 38). Cette huile typifie le Saint-Esprit de filiation, par lequel nous, la vraie « sacrificature royale », sommes scellés comme fils de Dieu. Les consacrés seuls, les sacrificateurs, peuvent être oints ainsi.
Aaron, le Souverain Sacrificateur type, représentait Jésus, la Tête, et l'Église comme membres du Corps, le grand Souverain Sacrificateur-antitype. Aaron n'étant qu'un homme pécheur comme les autres, avait besoin de se laver afin de représenter convenablement la pureté de l'antitype, Jésus qui fut sans péché, et celle de son Église, purifiée par son précieux sang, et le lavage d'eau par la Parole, Ephésiens 5 v. 26.
Après s'être lavé, Aaron était revêtu des saints vêtements pour « gloire et pour ornement » (Exode 28), et, en dernier lieu, l'huile d'onction était répandue sur sa tête (Exode 29 v. 7). Chaque article de ce glorieux habillement était typique des qualités et des pouvoirs du grand Libérateur, Tête et Corps, tels que Dieu les discernait, regardant dans l'avenir, au temps de la « manifestation des Fils de Dieu » et l'accomplissement en eux de Ses promesses.
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• HUILE (du chandelier) - Cette huile qui produit la lumière est l’évocation évidente du Saint Esprit et de ses directions dans le croyant et dans l’assemblée.

C’était de l’huile « d’olive pure broyée (Exode 27 v. 20) », qu’il ne faut pas confondre avec l’huile de l’onction sainte ni avec l’encens composé. L’huile broyée résulte du broyage des olives dans un mortier, ce qui traduit les souffrances de Christ.
Cette huile qui produit la lumière est l’évocation évidente du Saint Esprit et de ses directions dans le croyant et dans l’assemblée. Comment pourrait-on œuvrer dans le lieu saint sans cette lumière ? Dans la vie de l’assemblée, il n’y a pas d’autre puissance active autorisée. En tout et pour tout, il n’y a que deux puissances qui peuvent agir dans le croyant, ou bien l’Esprit, ou bien la chair ; or la chair est mise de côté. Dieu veuille que ce soit le cas pratiquement. Nous avons bien besoin de le demander car nous éprouvons de la difficulté à réaliser et manifester cette dépendance du Saint Esprit. La seule source qui permet tout service dans le sanctuaire, c’est la lumière du Saint Esprit. L’entretien de cette flamme produite par l’huile consumée nécessite les soins du Souverain sacrificateur, afin que la lumière ne soit pas altérée par des impuretés qui pourraient s’y introduire (Exode 30), venant de l’extérieur.
Par la description de ce chandelier, nous découvrons donc la plénitude de la lumière et de l’action de l’Esprit dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu. Il y avait des choses qui ne devaient pas s’arrêter pendant la nuit. Principalement le chandelier devait briller toute la nuit comme aussi le feu de l’holocauste ne devait pas s’éteindre pendant la nuit (Levitique 6 v. 2 et 6).
Dans la nuit morale et spirituelle d’un christianisme expirant, nous n’avons pas d’autre lumière que celle que le Saint Esprit nous communique par la Parole et de la part de Celui qui en est la source. Du soir au matin, jusqu’à ce que l’aube se lève et que les ombres fuient, nous sommes assurés de bénéficier de cette lumière que nous donne le Saint Esprit. Il le fera jusqu’au moment de cette scène où il entretiendra la louange des saints glorifiés dans la sainte cité que la gloire illumine, et de laquelle l’Agneau est la lampe, car « il n’y aura plus de nuit là (Apocalypse 21 v. 25) ».
Lorsque nous serons introduits dans la dernière demeure, la partie céleste du royaume, quel en sera le chandelier ? « La cité n’a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’a illuminée, et l’Agneau est sa lampe ». Il n’y aura pas de lampe à entretenir, car nous serons à la source intarissable de la lumière, abreuvés au fleuve de ses délices (Psaume 36 v. 8). Son amour sera comme un fleuve de lumière, qui alimentera l’éternelle et parfaite adoration de nos âmes (Apocalypse 21 v. 2, 22 et 23).
Source : « COMPILATION DE COMMENTAIRES » - par Bible-foi.com.
• HUIT - Chiffre du nouveau commencement divin.
Huit est le chiffre du nouveau commencement divin. Après le septième jour, le sabbat, vient, avec le huitième jour, le premier jour d’une nouvelle semaine, le dimanche. C’est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus et le jour caractéristique de la période actuelle de la grâce (Jean 20 v. 1 v. 19). La fête des tabernacles, d’une durée de sept jours, est une figure du règne millénaire, lorsque Israël vivra dans la paix et la joie (Lévitique 23 v. 33 à 43). À cette fête succédait toutefois un huitième jour durant lequel devait régner le repos. Nous y trouvons une indication du repos éternel des croyants dans le ciel. En cette « dernière journée, la grande journée de la fête », le Seigneur Jésus mentionne en Jean 7 v. 37, en parlant du don du Saint Esprit, une des bénédictions particulières données maintenant déjà aux croyants de la nouvelle création.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• HUMILITÉ - Le but n’en est pas de dominer sur ses frères, mais uniquement de mieux les servir.
Luc 14 v. 7 à 11). Invité chez l’un des principaux des pharisiens, le Seigneur Jésus « observait comment les conviés choisissaient les premières places ». Celui auquel rien n’est caché connaît les motifs qui amènent l’un ou l’autre à prendre moralement parmi ses frères telle ou telle place. Il observe, il sonde, il pèse les cœurs. À la table du festin, chacun a pris le siège qui lui paraît devoir correspondre à son rang. L’hôte n’est pas encore entré (verset 10) et les invités s’assoient où bon leur semble. Quelle sera l’estimation du Maître lorsqu’il viendra ? Dans la parabole, il fait asseoir à la dernière place l’orgueilleux qui avait choisi la première, et fait monter plus haut celui qui, plein d’humilité, s’était assis au bas de la table.
Ne pouvons-nous pas concevoir aussi une image parallèle : chacun a pris la place de son choix ; l’Hôte divin, à son arrivée, au lieu de s’asseoir à la place d’honneur, va se mettre à l’autre extrémité de la table ! Ainsi celui qui avait choisi la dernière place, se trouve être tout près de lui ; et l’autre qui s’était estimé digne d’être à sa droite ou à sa gauche, se trouve assis tout en bas. Nul ne peut récriminer puisque chacun avait personnellement estimé quelle place devait lui revenir. « Quiconque s’élève, sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé ».
Le Seigneur lui-même nous en a donné l’exemple ; il dit à ses disciples : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». À ce moment-là, il n’était même plus à table, puisqu’il s’en était levé (Jean 13) pour laver leurs pieds. Un frère peut être plus doué qu’un autre. (« Qu’as-tu que tu ne l’aies reçu ? ») Le but n’en est pas de dominer sur ses frères, mais uniquement de mieux les servir. En Luc 22, le Seigneur avait à peine institué la Cène qu’il arriva entre les disciples une contestation pour savoir lequel d’entre eux serait estimé le plus grand ; et Jésus de leur dire : « Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert ». L’apôtre ajoutera : « Que dans l’humilité, l’un estime l’autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres (Philippiens 2 v. 3 à 4) ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• HYSOPE - L’hysope jouait un rôle lors de la purification en Israël.
Le mot hysope recouvre vraisemblablement différentes plantes dont l’identité n’est pas tout à fait certaine. L’hysope jouait un rôle lors de la purification en Israël. En Exode 12 v. 22, le sang de l’agneau pascal devait être mis au moyen d’un bouquet d’hysope sur les poteaux et le linteau de la porte, afin que le jugement de Dieu sur les premiers-nés passe par-dessus les Israélites. Pour la purification du lépreux, outre l’hysope, du bois de cèdre et de l’écarlate étaient aussi utilisés (Lévitique 14 v. 4) ; ils étaient également employés lorsqu’on brûlait la génisse rousse dont la cendre était nécessaire pour la préparation de l’eau de purification (Nombres 19 v. 6) ; un homme pur devait ensuite tremper de l’hysope dans cette eau et en faire aspersion sur les personnes ou les objets souillés (v. 18).
Ce dernier passage explique les paroles de David : « Purifie-moi du péché avec de l’hysope, et je serai pur (Psaume 51 v. 7) ». La déclaration que le roi Salomon a parlé « sur les arbres, depuis le cèdre qui est sur le Liban, jusqu’à l’hysope qui sort du mur (1 Rois 4 v. 33) », aide à comprendre l’association du bois de cèdre et de l’hysope. Vu que le cèdre est une figure de la puissance et de l’orgueil, il faut voir dans l’hysope, apparemment insignifiante, la faiblesse humaine et la vanité. Ni l’un ni l’autre ne sont toutefois propres au service de Dieu; il ne peut employer que des cœurs renouvelés, purifiés par le sang de Christ. Peut-être la présentation de l’éponge emplie de vinaigre et mise sur de l’hysope est-elle aussi une marque du mépris du soldat pour le Sauveur crucifié en faiblesse (Jean 19 v. 29) ?
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
I
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• IMPOSITION DES MAINS - Signe d’identification ou de communion.
L’imposition des mains revêtait une telle importance dans l’Ancien Testament qu’il est parlé en Hébreux 6 v. 2, de « la doctrine... de l’imposition des mains » à laquelle nous ne devons pas retourner. Chez les premiers chrétiens, l’imposition des mains jouait un certain rôle, non prépondérant. Il en était autrement pour le peuple d’Israël. Lors de l’offrande des sacrifices d’animaux (à l’exception des oiseaux), celui qui présentait le sacrifice posait sa main sur la tête de l’animal et s’identifiait ainsi avec lui avant de l’égorger (Exode 29 v. 10). Lors de l’holocauste, cet acte, désigné par les mots « agréé pour lui (celui qui présente l’holocauste) », signifiait l’identification avec la valeur du sacrifice pour Dieu (Lévitique 1 v. 4) ; lors du sacrifice de prospérités, l’imposition des mains était l’expression de la communion devant Dieu (Lévitique 3, 2, 8, 13), et lors du sacrifice pour le péché, par cet acte le péché était transféré sur la victime qui devait mourir à la place du pécheur (Lévitique 4 v. 4 ; cf. chap. 16 v. 21). Les mains étaient aussi posées sur des hommes, par exemple sur les Lévites lors de leur consécration de la part des fils d’Israël (Nomb. 8, 10); et avant sa mort, Moïse posa sa main sur Josué pour le confirmer comme son successeur désigné par Dieu (Nombres 27 v. 18 ; Deutéronome 34 v. 9).
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons également l’imposition des mains comme signe d’identification ou de communion. Dans sa grâce, le Seigneur Jésus a imposé les mains aux petits enfants en disant : « Laissez venir à moi les petits enfants ; ne les en empêchez pas; car à de tels est le royaume de Dieu (Marc 10 v. 13 à 16) ». Les autres passages se trouvent en Actes 6 v. 6 ; 8 v. 17 ; 13 v. 3 ; 1 Timothée 4 v. 14 ; 5 v. 22 ; 2 Timothée 1 v. 6. La communion pouvait être aussi exprimée en donnant la main droite, tel que cela se pratique aujourd’hui (Galates 2 v. 9).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• ISAAC - Type du Seigneur Jésus.
Isaac, le fils d’Abraham et de Sara né selon la promesse, est un type du Seigneur Jésus. Comme Lui, il est appelé le fils unique (c’est-à-dire unique dans son genre) et bien-aimé (Genèse 22 v. 2 ; Hébreux 11 v. 17 ; Jean 1 v. 18 ; Colossiens 1 v. 13). Mais lorsque, sur le commandement de Dieu, il allait être offert en holocauste, contrairement à notre Seigneur, il fut épargné au dernier moment (Romains 8 v. 32). Pourtant c’est en Isaac premièrement que la résurrection a été vue en figure (Hébreux 11 v. 17). Après la mort de sa mère, Isaac, seul patriarche à n’avoir eu qu’une femme, a épousé Rebecca. Nous voyons en elle un type de l’Assemblée (Genèse 24 ; cf. Galates 4 v. 21 à 26). C’est aussi dans l’histoire d’Isaac qu’apparaît pour la première fois dans la Bible le mot « aimer » : d’abord en Genèse 22 v. 2, dans l’amour du père pour son fils, puis au chapitre 24 (v. 67), dans l’amour de l’époux pour son épouse.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• IVRAIE - Employée par Job comme figure de la malédiction.
De même que les épines, l’ivraie est employée par Job comme figure de la malédiction (Job 31 v. 40). Le Seigneur Jésus se sert de la parabole de l’ivraie parmi le froment pour caractériser l’activité du diable (Matt. 13, 24 et suiv.). Après qu’un homme a semé de la bonne semence dans son champ, son ennemi vient et sème de l’ivraie parmi le froment. L’ivraie est une graminée qui croît dans les champs de céréales du Proche-Orient. Ses épis ressemblent à ceux du blé, et ses grains abritent un champignon vénéneux. Du fait que les grains ont aussi la même grosseur et la même forme que ceux du blé, le criblage ne permet pas de les séparer les uns des autres et ils corrompent ainsi la farine. Le diable a commencé déjà très tôt à semer son ivraie corruptrice et il le fait aujourd’hui encore. Les épîtres du Nouveau Testament nous montrent ses tentatives d’introduire un « évangile différent », le judaïsme (Galates 1 v. 6 et suiv.), de répandre des doctrines philosophiques « selon les éléments du monde, et non selon Christ (Galates 2 v. 8) », et d’amener les hommes à changer « la grâce de notre Dieu en dissolution » et à renier « notre seul Maître et Seigneur, Jésus Christ (Jude 4) ». Ainsi la chrétienté est devenue pour l’homme un mélange inextricable de froment et d’ivraie, de vérité divine et de doctrines fausses et mauvaises, de vrais croyants et d’incrédules. L’étonnement des esclaves en voyant l’ivraie est compréhensible, car la présence, dans le royaume, d’hommes qui ne sont pas de vrais fils du royaume est contraire à la pensée de Dieu. Aussi le semeur dit-il aux esclaves qui savent très bien distinguer l’ivraie du froment et qui veulent l’arracher : « Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu’à la moisson (Matthieu 13 v. 30) ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• INTENDANT (économe) (1) - Dieu a pourvu l'homme de capacités qu’il doit utiliser pour glorifier son Créateur.
« Et il dit aussi à ses disciples : Il y avait un homme riche qui avait un économe ; et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et l’ayant appelé, il lui dit : Qu’est-ce que ceci que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton administration ; car tu ne pourras plus administrer (Luc 16 v. 1 et 2) ». Que le Créateur ait confié à l’homme des biens, la parabole du fils prodigue l’a déjà montré. Outre l’esprit, l’âme et le corps, Dieu l’a pourvu de capacités qu’il doit utiliser pour glorifier son Créateur. Dans cette mesure il est un administrateur (ou : intendant) de Dieu ; mais il n’a pas répondu à ce devoir. Le fils prodigue gaspilla (ou : dissipa) son bien, tout comme l’administrateur injuste le fit avec l’avoir de son maître. L’un l’a fait dans un pays éloigné, l’autre dans la maison de son Maître.
Cette dernière indication laisse penser qu’outre le point de vue général, l’administrateur injuste est aussi en particulier une image d’Israël. Dieu avait donné la loi à ce peuple dans un domaine établi par Lui, et avec elle les promesses et le service divin (Romains 9 v. 4 et 5). Mais ce peuple a, lui aussi, été infidèle vis-à-vis des biens extraordinaires qui lui avaient été confiés. Au lieu de transmettre aux peuples de la terre la connaissance qu’ils avaient reçue du seul vrai Dieu, ils violèrent la loi de Dieu, tombèrent dans l’idolâtrie et tuèrent finalement leur propre Messie, alors qu’Il était venu à eux comme une lumière pour la révélation des nations et la gloire du peuple d’Israël (Luc 2 v. 32).
À la suite de cela, ils furent destitués de leur administration. Dieu ne les a plus considérés comme Ses administrateurs. Déjà le prophète Osée avait dû crier au peuple : « vous n’êtes plus mon peuple, et moi, je ne suis plus à vous (Osée 1 v. 9) ». Mais ce n’est pas seulement Israël en particulier que Dieu ne considère plus comme Ses administrateurs, mais aussi l’homme en général. Il a perdu cette position par sa propre infidélité. Malgré tout, sa responsabilité subsiste vis-à-vis de son Créateur, car Dieu l’a encore laissé en possession des biens terrestres.
Même si dans notre parabole, la destitution de l’administrateur injuste de son poste d’administrateur est imminente pour lui, comment va-t-il agir entre temps avec les biens qui appartiennent à son maître, non pas à lui ? Comment va-t-il utiliser les possibilités et capacités qui lui restent ? C’est alors qu’intervient une application de la parabole à laquelle nous ne nous serions pas attendus de cette manière.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• INTENDANT (économe) (2) - Dieu a pourvu l'homme de capacités qu’il doit utiliser pour glorifier son Créateur.
« Et l’économe dit en lui-même : Que ferai-je, car mon maître m’ôte l’administration ? Je ne puis pas bêcher la terre ; j’ai honte de mendier : je sais ce que je ferai, afin que, quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leurs maisons. Et ayant appelé chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? » Et il dit : Cent baths d’huile. Et il lui dit : Prends ton écrit, et assieds-toi promptement et écris cinquante. Puis il dit à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Et il dit : Cent cors de froment. Et il lui dit : Prends ton écrit, et écris quatre-vingts (Luc 16 v. 3 à 7) ».
Tandis que les paroles introductives de la parabole sont fort brèves, la prudence de l’administrateur est largement dépeinte. On entend ses réflexions, et on voit sa décision rapide et comment il l’a aussitôt traduite dans les faits. Il n’a pas non plus perdu beaucoup de temps pour échapper aux conséquences amères de sa destitution de fonction. Il est vrai qu’il exclut d’emblée deux possibilités. Il n’envisage pas de gagner sa vie en bêchant, car il n’a pas la force pour un travail aussi dur. Il a honte d’avoir tout juste de quoi vivre en mendiant. Finalement, il occupait jusqu’alors une position influente ; devrait-il maintenant avouer qu’il a sombré si bas ? Non, il ne se pose même pas la question !
N’avons-nous pas ici un tableau de l’homme naturel ? D’un côté il est entièrement sans force pour répondre aux exigences de Dieu, « alors que nous étions encore sans force (Romains 5 v. 6) ». C’est une des constatations les plus humiliantes que l’homme, qu’il soit Juif ou païen, ne possède aucune force pour faire le bien et pour laisser le mal. D’un autre côté, il a honte d’admettre son véritable état. Sa fierté lui interdit d’adopter une attitude de demandeur. Ce sont là les deux raisons principales pour lesquelles les gens refusent l’évangile et haïssent la grâce de Dieu. Car la grâce met en relief que nous sommes sans force, et qu’on ne peut la recevoir qu’en tant que suppliant, sans la mériter.
Mais l’administrateur arrive alors à une décision qui n’est pas typique de tout le monde. C’est pourquoi on peut parler d’un virage inattendu. Pour la plupart, les gens ne s’engagent justement pas dans les réflexions sur lesquelles l’administrateur a médité dans sa prudence. Ils vivent beaucoup plutôt dans l’insouciance du jour, sans réfléchir à ce qui arrivera au moment où les richesses (le Mammon) viendront à manquer (16 v. 9).
Pourtant l’administrateur, aussi injuste fût-il, pensait à ce qui allait se passer « après ». Que fallait-il faire, réfléchissait-il, pour que les gens le « reçoivent dans leurs maisons » quand il serait destitué de son administration ? C’est cela qui constituait sa prudence : il ne s’occupait pas du présent, mais dirigeait ses pensées vers l’avenir. Sans aucun doute, il aurait pu s’enrichir sur les biens de son maître tant qu’il en avait encore le pouvoir, mais il ne l’a pas fait. Il a plutôt cherché à transformer les débiteurs de son maître (il devait y en avoir beaucoup), en ses propres débiteurs, pour assurer son propre avenir. Il fit donc un usage des biens de son maître qu’on ne peut bien sûr pas qualifier de juste, mais de prudent.
Il n’est cité que deux exemples de débiteurs. Il semble qu’il s’agissait dans la parabole, non pas d’un fermier responsable de terres, mais d’un marchand, une sorte de commerçant en gros, devant des sommes d’argent considérables à son maître pour des quantités correspondantes d’huile et de blé fournies par ce maître. Autrement on ne peut guère expliquer que l’un ne devait à son maître que de l’huile, et l’autre que du blé (ou : froment). En outre 100 baths d’huile correspondent à environ 4000 litres et 100 cors de blé à environ 40 mètres cubes. L’administrateur remit « libéralement » à ces deux débiteurs une partie considérable de leur dette. Il fit la même chose avec « chacun des débiteurs de son maître ».
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• INTENDANT (économe) (3) - Le maître ne peut s’empêcher de reconnaître la prudence de son économe injuste.
« Et le maître loua l’économe injuste parce qu’il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents, par rapport à leur propre génération, que les fils de la lumière (Luc 16 v. 8) ». Que le comportement de l’administrateur ait été injuste, cela n’est nullement passé sous silence. Il est expressément appelé, selon la traduction littérale, administrateur de l’injustice, ce qui ne signifie naturellement rien d’autre qu’administrateur injuste ; mais cette expression insiste spécialement sur l’injustice de cet homme et de ses agissements.
Mais pourquoi son maître le loue-t-il, et à quel sujet le loue-t-il quand il apprend la réalité de toute l’affaire ? En fait, il ne peut s’empêcher de reconnaître la prudence de son administrateur injuste. Celui-ci avait finalement sacrifié le présent à l’avenir, ce qui n’est pas banal du tout, et est pour cela digne de louange. On remarque bien que l’administrateur n’est pas loué pour son injustice, mais « parce qu’il avait agi prudemment ». Il avait su se faire des amis avec ce qui ne lui appartenait pas en vue du temps qui arriverait « après ».
Les gens n’agissent-ils pas en général de manière diamétralement opposée, et ne sacrifient-ils pas l’avenir au présent ? Leurs pensées ou leurs visées sont surtout tournées vers des événements et des évolutions présents, et si quand même ils se soucient de l’avenir, ce n’est alors qu’en vue d’un avenir dans ce monde. Leur prudence ne va pas plus loin. Ils vivent pour ce monde, et ce qui vient après ne les intéresse pas. C’est pourquoi ils sont appelés fils de ce monde. L’homme riche dans le dernier paragraphe du chapitre sera comme un fils de ce monde, tandis que le pauvre Lazare était un vrai fils de la lumière. Mais une fois morts, qu’arriva-t-il ? Nous le verrons en son temps.
D’habitude on tire de ceci que la parabole se termine par la louange du maître au sujet de l’administrateur injuste. Pourtant ce n’est qu’à partir du v. 9 que le Seigneur Jésus applique la parabole à Ses disciples. Entre deux, il y a cette remarque de 16 v. 8 « car les fils de ce siècle (ou : monde) sont plus prudents, par rapport à leur propre génération, que les fils de la lumière » ; elle appartient encore à la parabole.
Certes cette phrase n’ajoute rien au récit, mais la parabole est ainsi replacée dans son ensemble dans une juste lumière pour les auditeurs. Elle parle de la prudence des fils de ce monde par rapport à leur « génération ». Ils s’entendent à obtenir des avantages pour eux-mêmes, et ils ne s’embarrassent pas de scrupules de conscience ou de questions morales. En cela ils sont sans aucun doute supérieurs aux fils de la lumière.
Le personnage principal de notre parabole, l’administrateur, est directement la personnification de l’injustice, du début à la fin. Ce n’est pas par hasard que son injustice a donné son titre à la parabole, la parabole de ‘l’économe injuste’. Et pourtant le Seigneur profite de la prudence de cet homme pour nous communiquer des enseignements importants.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• INTENDANT (économe) (4) - Traçons une deuxième ligne parallèle, la ligne de l’application à nous les enfants de Dieu.
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très-petit, est fidèle aussi dans ce qui est grand ; et celui qui est injuste dans ce qui est très-petit, est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? Et si, dans ce qui est à autrui, vous n’avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre ? (16 v. 9 à 12) ».
Il n’y a guère de parabole qui ait donné lieu à plus de commentaires contradictoires que celle-ci : comme si on pouvait s’acheter le ciel avec des richesses injustes ! Les exposés fantaisistes et se contredisant souvent les uns les autres proviennent pour la plupart de ce qu’on oublie à qui le Seigneur s’adressait avec cette parabole. Le v. 1 dit expressément « et il dit aussi à ses disciples », ce qui veut dire que les paroles du Seigneur ne concernent pas la manière dont on devient disciple, mais elles s’adressent à des gens qui le sont déjà. Nous ne devons donc pas interpréter de travers les explications du Seigneur comme si elles traitaient de la manière dont on parvient à la vie éternelle, dont on accède au ciel. Ensuite, on fait souvent l’erreur de prendre tel ou tel détail de la parabole comme base de son interprétation, au lieu de voir la parabole comme un tout. Considérons encore une fois la ligne de la parabole, et traçons à côté une deuxième ligne parallèle, la ligne de l’application à nous les enfants de Dieu ! La correspondance est manifeste.
En image, cette correspondance s’exprime sous forme de deux flèches parallèles dirigées dans le même sens.
L’homme est l’administrateur, nous le sommes aussi. Des biens lui sont confiés, à nous aussi. Il s’agit de richesses (ou : Mammon) injustes, c’est aussi notre cas. Il s’en fait des amis avec, c’est aussi ce que nous devons faire. Elles viennent à manquer, pour nous aussi. Mais alors un contraste apparaît : les fils de ce monde recherchent des maisons terrestres, les fils de la lumière recherchent des tabernacles éternels, des habitations célestes. Cela retourne la flèche en sens contraire. En fait, les uns sont motivés par l’injustice, les autres au contraire, par la justice. Dans ce cas, en image, cela fait symboliquement deux flèches parallèles dirigées en sens contraire.
Entrons maintenant d’encore plus près dans les paroles du Seigneur. Il parle de Mammon injuste (richesses injustes), l’expression littérale étant Mammon de l’injustice, comme il avait parlé précédemment d’administrateur de l’injustice. Autrement dit, Mammon comme désignation (dévalorisante) des richesses et des biens terrestres est caractérisé par l’injustice. L’explication de ce qualificatif ne réside pas seulement dans ce que la possession terrestre peut facilement conduire à l’injustice ; ce serait certainement un sens trop faible. L’argent et les richesses ne sont-ils pas marqués par la tache d’avoir circulé dans les mains d’hommes déchus et pécheurs, et d’avoir servi d’une manière pécheresse à des desseins de péché ? sans parler de ce qu’ils ont souvent été acquis de manière injuste.
Une deuxième comparaison suit. Les richesses (= le Mammon) injustes ne sont pas seulement ce qui est très petit, mais elles sont aussi fausses, superficielles, fugaces, trompeuses ; c’est pourquoi le Seigneur les met maintenant en contraste avec les vraies : « Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? (16 v. 11) ». Il arrive un moment où les richesses (le Mammon) viennent à manquer (16 v. 9) : quelle folie, dès lors, d’y mettre son cœur ! Notre vraie richesse est spirituelle, elle est dans le ciel. Tout ce qui est en rapport avec Christ glorifié, c’est les vraies richesses.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• INTENDANT (économe) (5) - Traçons une deuxième ligne parallèle, la ligne de l’application à nous les enfants de Dieu.
Le Seigneur achève Ses enseignements avec les paroles suivantes : « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre : vous ne pouvez servir Dieu et les richesses (Luc 16 v. 13) ». Il nous arrive trop souvent de nous illusionner en croyant qu’on peut ménager la chèvre et le chou. C’est un grand danger de nos jours, de penser que d’un côté on pourrait servir le Seigneur, et de l’autre nos intérêts mondains. Le Seigneur dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, que nous ne pouvons pas servir Dieu et les richesses (Mammon).
Croyons-nous vraiment que Dieu nous ait donné la vie éternelle pour gagner le plus d’argent possible ? N’oublions-nous pas parfois que nous avons été achetés à un prix très élevé, le prix de Son sang (1 Corinthiens 6 v. 20) ? Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C’est pourquoi notre maître ne peut être qu’unique. Si nous n’y prenons pas garde, les richesses (Mammon) vont croître facilement pour devenir l’élément dominant dans notre vie, sans que nous n’en ayons bien conscience. On comprend bien que nous devons répondre à nos obligations terrestres avec fidélité et soin, mais c’est toute autre chose que de diriger nos pensées sur la multiplication de notre avoir terrestre. Prenons au sérieux la parole de notre Seigneur et Rédempteur ! Si nous servons les richesses (Mammon) sous une forme ou sous une autre, nous ne pouvons pas servir Dieu.
Servir signifie servir comme esclave. Nous ne pouvons pas être esclave de Dieu et en même temps esclave des richesses (Mammon). Le Seigneur explicite cela du point de vue d’un esclave, car deux maîtres pourraient arriver à s’entendre sur l’usage partagé d’un même esclave. Mais il est impossible à un esclave ou un domestique, de servir deux maîtres. Ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Autrement dit, dans son cœur et ses pensées il n’y aura qu’un seul des deux maîtres qu’il considérera comme son maître réel, et c’est à lui qu’il consacrera son service de cœur. L’autre ne sera servi qu’extérieurement ; ce ne sera qu’un service apparent.
Effectivement, dans notre cas, il ne peut y avoir qu’un Seigneur et Maître dans notre cœur. Nous nous imaginons certes souvent en train d’accorder le service apparent à l’autre maître, Mammon, tandis que nous servirions Dieu en réalité. Cependant le danger se trouve exactement en sens inverse : que nous servions Mammon de cœur et que nous cherchions à cacher cela par un service apparent vis-à-vis de Dieu.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• INVITATION (aux noces) - Dans Matthieu, les esclaves du roi transmettent son invitation, figure des serviteurs que le Seigneur envoie.
Matthieu 22 v. 1 à 10 ; Luc 14 v. 16 à 23). Trois fois dans Matthieu « les esclaves » , trois fois dans Luc « l’esclave » , renouvellent l’invitation au grand souper. Tout est prêt, venez ! À la croix, Christ a tout accompli. Son œuvre est parfaite. Acceptez l’invitation de sa grâce. C’est le travail de l’évangéliste ; il n’est pas limité à ceux auxquels le Seigneur a demandé de consacrer tout leur temps à répandre la parole. L’évangélisation ne s’improvise pas. Il ne suffit pas de convoquer une réunion et de répandre des invitations. Les esclaves sont exhortés à « amener » les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Ceux-ci n’auraient jamais pu venir d’eux-mêmes ; il faut les conduire, les aider, les transporter. Inviter à brûle-pourpoint des personnes à écouter la Parole juste le jour de la réunion d’évangélisation n’aura guère d’effet. Il faut les avoir suivies et entourées auparavant, avoir gagné leur confiance afin de pouvoir les inviter au moment voulu ; la réunion passée, on continuera à les encourager, en leur montrant la vie divine en action.
Travail merveilleux de la grâce qu’a commencé le Seigneur lui-même, dont le prophète pouvait dire dans sa vision : « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de Celui qui apporte de bonnes nouvelles (Ésaïe 52 v. 7) ». Lorsque plus tard l’apôtre montrera la nécessité de répandre l’évangile « comment croiront-ils en Celui dont ils n’ont point entendu parler ? », il citera le même verset en disant : « Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix » (Romains 10 v. 15) ».
Dans Matthieu, les esclaves du roi transmettent son invitation, figure des serviteurs que le Seigneur envoie ; en Luc 14, un seul esclave est à l’œuvre. Ne s’agit-il pas là plutôt du Saint-Esprit, le seul qui peut « contraindre » d’entrer (Jean 16 v. 8) et opérer dans les cœurs ? Aucun des serviteurs ne verra son invitation acceptée si le divin Serviteur n’a pas agi dans les consciences et dans les cœurs.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• IVRAIE (dans le champ) (1) - Les enfants de Dieu connaissent Dieu, le Véritable. Ils ont Sa nature et sont rendus par-là capables de porter du fruit pour Lui.
Dans la parabole du semeur, l’adversaire ravit ce qui est bon ; dans la parabole de l’ivraie du champ, il ajoute quelque chose de mauvais. Ces deux activités sont dangereuses, et il les exerce les deux : « Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l’ivraie parmi le froment, et s’en alla (Matthieu 13 v. 25) ». Voilà maintenant quelque chose de bien sérieux devant nous : le Seigneur a un ennemi, le diable (12 v. 39), et celui-ci se sert du manque de vigilance des hommes pour faire du mauvais travail. Il marche « sur les talons » de Celui qui a semé la bonne semence dans Son champ, et il sème l’ivraie au milieu du froment. Le mot grec pour semer est ici renforcé par un préfixe, ce qui lui donne le sens de « inonder de semence » : l’ennemi inonde de semence le froment déjà semé dans le sol. Pour cela il se sert d’une mauvaise herbe, l’ivraie, très semblable au froment dans la première phase de croissance, et qui mêle ses racines à celle du froment. Ce n’est que quand les épis sont visibles qu’on peut différencier l’ivraie du froment (13 v. 26 et 27).
Si satan ne peut déraciner les fils du royaume, il peut quand même les disperser. C’est ce que montre clairement Jean 10. Le Seigneur Jésus dit, dans ce passage, que le voleur vient « pour voler, tuer et détruire (Jean 10 v. 10) ». Cela ne signifie pas qu’il y arrive effectivement, quoique ce soit son intention ; car personne ne peut ravir une de Ses brebis de Sa main ni de la main de Son Père (Jean 10 v. 28 et 29). Mais quand Il parle du loup, Il dit quand même qu’il ravit et disperse les brebis (Jean 10 v. 12) ; c’est ce que nous retrouvons dans notre parabole.
Comme les fils du royaume sont le résultat de la Parole de Dieu, ainsi les fils du méchant sont le résultat d’enseignements faux et mauvais. L’expression « fils du méchant » est même effrayante en soi ; elle est à comparer avec « fils de Bélial » (2 Samuel 23:6) et « fils de perdition » (Jean 17:12). « Comme Caïn était du méchant » (1 Jean 3:12), ainsi ces gens sont de leur père le diable (Jean 8:44).
L’image de la ‘mauvaise herbe’, ou ‘ivraie’, ne se rapporte pas seulement à des personnes non converties. Ce sont bien plutôt des personnes que Satan a introduit dans le royaume des cieux pour détruire la moisson de Dieu sur la terre. C’est ainsi qu’il se trouve aujourd’hui dans la chrétienté (non pas dans l’assemblée !) des fils du méchant à côté des fils du royaume. Cela se traduit chez ces derniers par une sérieuse mise à l’épreuve et par une détresse intérieure. Et voilà que le champ chrétien est recouvert ‘d’ivraie’ au point qu’on peut à peine encore reconnaître le ‘froment’. Ce n’est pas le ‘froment’ qui caractérise le ‘champ’, mais ‘l’ivraie’. N’est-il pas tout à fait caractéristique que, quand les disciples demandent l’explication de la parabole, ils ne disent pas (13:36) « expose-nous la parabole du "froment" du champ », mais « expose-nous la parabole de "l’ivraie" du champ » ? Nous allons revenir sur ce point.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• IVRAIE (manque de vigilance) (2) - L’ennemi est coupable, mais il tire parti du manque de vigilance chez les chrétiens.
En fait, c’est le manque de vigilance qui a, en premier lieu, permis à l’adversaire un travail de cette ampleur. Il est frappant que le Seigneur Jésus ne dit pas : « quand la nuit vient, son ennemi vint aussi », mais « pendant que les hommes dormaient… ». Il veut assurément nous faire connaître par là non seulement la ruse et la malice de l’adversaire, mais Il veut nous signaler un sérieux manquement. Le semeur lui-même ne dormait certes pas (comp. Psaume 121 v. 4), mais les hommes, eux, dormaient. Sans aucun doute l’ennemi est coupable, mais il tire parti du manque de vigilance chez les chrétiens. Déjà au commencement de l’histoire de l’église, quand les choses étaient encore largement en bon état, le Seigneur devait déplorer : « j’ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour (Apocalypse 2 v. 4) ». L’abandon des meilleures affections pour le Seigneur est la clef de toute la ruine dans la chrétienté. Sans cela, l’ennemi n’aurait pas pu réussir dans son œuvre méchante. Et comme la dispensation de la grâce a commencé par l’assoupissement, ainsi elle se termine par la tiédeur, l’absence total d’amour pour le Seigneur (Apocalypse 3 v. 16).
Combien nous avons besoin aujourd’hui, au temps de la fin, d’une vigilance multipliée afin qu’au moins dans notre vie et notre domaine, il y ait, avant la moisson, une séparation positive entre le bien et le mal. Car il doit être complètement clair pour nous que le processus de semer du mal par-dessus le bien se poursuit encore aujourd’hui sans interruption. Ne devons-nous pas nous plaindre que l’état spirituel de nous, les croyants, est très bas ? Ne s’est-il pas introduit dans bien des domaines de notre vie un mélange de ce qui est spirituel avec ce qui est du monde ?
C’est la raison pour laquelle nous trouvons ici « pendant que les hommes dormaient ». C’est pourquoi la Parole de Dieu nous avertit à multiples reprises contre la tendance au sommeil. « Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres (1 Thessaloniciens 5 v. 6) » ; « et encore ceci : connaissant le temps, que c’est déjà l’heure de nous réveiller du sommeil (Romains 13 v. 11) ». Si nous avons conscience, et si nous souffrons, de ce que notre défaillance et notre manque de vigilance ont facilité la tâche à l’adversaire pour s’introduire, il y a encore un plus profond sujet de tristesse en ce que le Seigneur Jésus parle de « Son ennemi ». Il nous nomme « Ses frères », et voilà qu’Il désigne l’adversaire comme « Son ennemi ». Il fait de nos affaires, Ses affaires de notre ennemi, Son ennemi. Le combat que nous avons à combattre est en réalité Son combat. L’ennemi auquel nous avons affaire, est en réalité Son ennemi. Aussi faut-il que nous regardions à Lui qui peut pourvoir à tout le nécessaire pour le combat (comp. Éphésiens 6 v. 10 à 18).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• IVRAIE (l’arracher ?) (3) - Le mal doit subsister à côté du bien dans le royaume des cieux jusqu’à la moisson.
C’est la question qui préoccupait les esclaves du maître : « Et les esclaves lui dirent : Veux-tu donc que nous allions et que nous la cueillions ? Et il dit : Non, de peur qu’en cueillant l’ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu’à la moisson (Matthieu 13 v. 28 à 30) ». C’est une bonne chose que les esclaves, s’apercevant maintenant du mal commis, n’aient pas agi à leur guise, mais aient montré leur dépendance en s’enquérant de la volonté du maître : « veux-tu donc… ? ». N’était-ce pas le plus important dans une telle situation ? Ils avaient leur propre idée sur la manière d’en finir avec le mal, mais c’était seulement humain et charnel, et cela aurait conduit à un désastre encore plus grand. Ce n’était que corriger une faute par une faute supplémentaire. En fait on peut se demander ce qui était le plus à craindre, la première faute ou la réponse charnelle proposée. Nombreux sont les cas où l’utilisation de mauvais moyens a conduit à plus de malheur que la faute initiale.
Mais le Seigneur qui pense toujours au bien du froment répondit négativement à la proposition des esclaves qui partait d’une bonne intention : « Non, de peur qu’en cueillant l’ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle ». Il savait bien ce que le zèle aveugle de la chair occasionnerait. Il aimait trop Son froment pour l’exposer au danger d’être arraché avec l’ivraie. Non, Il prendrait Lui-même l’affaire en main, et ne se fiait pas à Ses esclaves.
Tout cela touche notre cœur. Aujourd’hui le Saint Esprit habite dans l’assemblée ; or c’est Lui qui « retient » (2 Thessaloniciens 2 v. 7) le plein développement du mal, et là-dessus le jugement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (1 Timothée 2 v. 4). C’est pourquoi nous devons « estimer que la patience » de notre Seigneur avec le monde « est salut » (2 Pierre 3 v. 15), et nous ne devons pas l’interpréter à tort comme étant de l’indifférence ou de l’impuissance. Dieu ne s’occupe pas aujourd’hui de jugement. Il agit en grâce, et appelle les gens hors du monde, pour les conduire des ténèbres à Sa merveilleuse lumière.
Pour toutes ces raisons, le mal doit subsister à côté du bien dans le royaume des cieux jusqu’à la moisson. Les esclaves, à cause de leur inattention, n’avaient pas pu empêcher l’introduction du mal. Maintenant qu’il était là, il ne fallait pas chercher à l’ôter de force. Même si le caractère originel du royaume des cieux était détruit, et même irrémédiablement, cet état de mélange devait, selon les pensées de Dieu, subsister jusqu’à la fin. C’est ce qui fait le caractère de la dispensation présente, en ce qui concerne la présentation extérieure du royaume des cieux.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• IVRAIE (moisson) (4) - Le mal doit subsister à côté du bien dans le royaume des cieux jusqu’à la moisson.
L’expression au temps de la moisson est un premier exemple de cette manière particulière de parler du Seigneur. Il n’utilise pas cette expression dans l’explication, mais Il dit : « la moisson est la consommation du siècle, et les moissonneurs sont des anges » (13 v.39). Au temps de la moisson paraît désigner le temps qui précède immédiatement la moisson, sans qu’on puisse pourtant le séparer de la moisson elle-même. Ce temps englobe une certaine période, au cours de laquelle différents processus se déroulent, tant pour l’ivraie que pour le froment. Ce qui détermine l’époque, c’est l’état du froment, sa maturité, non pas l’état de l’ivraie. Autant l’ivraie marque de son empreinte toute la période du royaume des cieux, autant elle n’est pas décisive pour déterminer quand le temps de la moisson est venu. Toute la question, c’est le froment. Dieu laisse Son froment arriver à maturité dans ce monde, et quand il est mûr, le temps de la moisson est arrivé.
Le premier événement de cette période doit être que l’ivraie est cueillie et liée en bottes. Remarquons bien qu’il n’est pas dit dans la parabole, que l’ivraie est brûlée au temps de la moisson, mais il n’est mentionné que l’intention pour laquelle elle est mise en bottes : « pour la brûler ». La mise au feu elle-même dans une fournaise fait partie de la moisson, du jugement (comparer les v. 40 à 42). La mise en bottes décrit manifestement une préparation de l’ivraie pour le jugement. Le froment n’a besoin d’aucune préparation préalable pour être assemblé dans le grenier. La mise en bottes correspond-elle à l’émergence de grandes unions mondiales, ou plutôt à une forte croissance de sectes anti-chrétiennes et de faux enseignements dans les derniers jours ? je laisse la question ouverte. Je penche plutôt pour la seconde suggestion.
Au temps de la moisson, le froment est assemblé dans le grenier du Seigneur. L’explication n’en dit pas un mot. Il est bien dit dans cette explication, que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père (13 v. 43), mais nous ne voyons pas d’assemblage du froment dans le grenier céleste. Ce sont effectivement des scènes différentes, ou des événements différents, dont le Seigneur parle. Assembler le froment dans le grenier, ce n’est pas la même chose que le resplendissement des justes dans le royaume de leur Père. Même la mise en bottes pour être brûlé, ce n’est pas la même chose que cueillir de son royaume tous les scandales et les jeter dans la fournaise de feu.
Même si l’enlèvement des saints (1 Thessaloniciens 4 v. 15 à 17 ; 1 Corinthiens 15 v. 23, 51, 52) n’est pas l’objet de notre parabole, il s’agit d’une vérité qui n’était alors pas encore révélée, il y a quand même place pour lui dedans. Le Seigneur s’exprime d’une manière qu’il y trouve place. D’un côté Il laisse parfaitement la place pour la pensée que le froment est assemblé dans Son grenier avant que l’ivraie soit brûlée. En fait, assembler le froment dans le grenier de Dieu inclut le fait d’amener « à la maison » les croyants qui constituent le froment à cette époque-là. Car la première partie de la parabole décrit précisément l’état de choses tel qu’il est maintenant : du froment et de l’ivraie côte à côte dans le champ. Mais d’un autre côté les paroles du Seigneur laissent aussi ouverte la possibilité qu’il y ait encore des saints sur la terre après l’enlèvement de l’église.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• IVRAIE - Le Seigneur a donné Lui-même l’interprétation prophétique de cette parabole.
En Lévitique 19 v. 19, il était dit : « Tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences ». Voici un champ bien ensemencé, mais « pendant que les hommes dorment », l’ennemi vient, sème l’ivraie parmi le froment et s’en va. Dans la parabole du semeur, l’ennemi ravit la parole. Ici, il vient semer la mauvaise graine. Quand les hommes se réveillent, il n’y paraît rien. Les jeunes pousses de blé croissent et grandissent et seulement « lorsque la tige monte et produit du fruit », « l’ivraie aussi paraît ».
On a lu tel livre, assisté à tel spectacle. Il ne semble en avoir résulté aucun mal, sauf peut-être le sentiment pénible d’un temps gaspillé ; mais plus tard, l’ivraie germe. Telle erreur a été entendue, on a cru s’en rendre compte et l’écarter, mais, plus tard, elle réapparaît. Des parents ont élevé leurs enfants dans la crainte du Seigneur, leur ont enseigné la parole ; ceux-ci l’ont lue et ont fréquenté les réunions. Puis, à un certain âge, jaillissent dans leur esprit toutes sortes de raisonnements, de doutes ou de convoitises diverses. D’où cela vient-il ? disent les parents. N’avons-nous pas enseigné nos enfants ? Bien sûr, mais à un moment ou à un autre, l’ennemi a su semer l’ivraie. On n’y voyait rien pendant quelque temps, quelques mois, quelques années, et maintenant se montre le funeste résultat de son travail. Récolte compromise, sève gaspillée, sol épuisé ! Qu’en sera-t-il au temps de la moisson ? L’ivraie sera brûlée ! Comme le bois, le foin, le chaume de 1 Corinthiens 3. Ne devons-nous pas répéter : Prenons garde !
La croissance normale (Marc 4:26 à 29).
Une brève parabole suit celle du semeur, pour nous montrer que la croissance est tout naturellement le fruit de la vie : « La terre produit spontanément du fruit, premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et puis le plein froment dans l’épi ». Pas d’effort à faire, d’énergie humaine à déployer pour à tout prix porter du fruit. Il faut laisser la vie agir. Mais, pour qu’elle croisse, la semence a dû germer et prendre racine, et les obstacles, roc, épines, être écartés. Il s’agit d’étendre ses racines vers le courant (Psaume 1 ; Jérémie 17 v. 8) et de laisser la lumière d’en-haut éclairer l’âme. Le fruit n’est pas produit en un jour. La croissance est lente et progressive. Pour la maturité, il faut la patience (Luc 8 v. 15).
En 2 Timothée 2 v. 6, le laboureur a travaillé premièrement ; en Jacques 5 v. 7, il attend le fruit précieux de la terre ; et, si nous pensons au divin Laboureur, Ésaïe 53 v. 11 ajoute qu’Il verra du fruit du travail (labeur) de son âme.
La croissance anormale.
Le grain de moutarde (Matthieu 13 v. 31 ; Marc 4 v. 31 ; Luc 13 v. 19). Une plante habituellement de petite taille, à peine un buisson, « a pris sa croissance et… devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches ». Indépendamment de sa portée prophétique quant au développement de la chrétienté dans le monde, cette parabole ne contient-elle pas un avertissement pour nous à ne pas vouloir nous élever, dominer, nous placer au-dessus des autres, devenir « un grand arbre » ? (Luc 13 v. 19). Tels les oiseaux dans les branches, l’ennemi aurait tôt fait de s’introduire, amenant de funestes résultats dans la vie de celui qui a voulu s’élever au-dessus de ses frères.
Le levain (Matthieu 13 v. 33 ; Luc 13 v. 20 à 21).
Dans l’offrande de gâteau, aucun levain n’avait place. La fine farine nous parle avant tout de Christ ; le levain que la femme prend et y cache, des fausses doctrines ou mauvais enseignements concernant Sa personne ; ailleurs le levain est figure du mal moral (1 Corinthiens 5 v. 6), comme aussi doctrinal (Galates 5 v. 9). Il produit cette enflure intérieure de la chair, du « moi », qui conduit, soit à l’hypocrisie (le levain des pharisiens), soit à la corruption, danger d’autant plus grand qu’il s’étend rapidement à « la pâte tout entière » .
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).
 ÉTUDE DE LA BIBLE
ÉTUDE DE LA BIBLE
IMAGES COMPARAISONS SYMBOLES BIBLIQUES
D'après les textes originaux hébreu
« Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien ; l’Ancien Testament est ouvert dans le Nouveau ».
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
J
• Remmers Arend
Images et symboles bibliques
• JARDIN - Image d’un lieu particulièrement protégé.
Dans la Bible, le jardin est souvent une image d’un lieu particulièrement protégé, de bénédiction pour l’homme et de joie pour Dieu. Nous le voyons déjà dans le jardin d’Eden. La fiancée du Cantique des cantiques est comparée à un jardin clos et à un paradis (Cantique 4 v. 12 et 13). Un jardin arrosé est par conséquent une magnifique figure de croyants qui vivent séparés pour leur Seigneur seul, trouvent leur force et leur secours auprès de lui, la source de l’eau de la vie, et en même temps portent du fruit pour lui. Dans le Cantique des cantiques il est dit plus loin : « Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu’il mange ses fruits exquis ».
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• JÉRUSALEM - La ville a une importante signification symbolique non seulement pour Israël, mais aussi pour nous.
Le nom signifie « fondation (ou héritage) de paix ». Jérusalem est mentionnée pour la première fois en Josué 10 v. 1 comme ville du roi Adoni-Tsédek. Toutefois on peut vraisemblablement voir Jérusalem déjà en Salem où régnait le roi Melchisédec, sacrificateur de Dieu (Genèse 14 v. 18 ; Psaume 76 v. 2). La ville a plusieurs noms : ville sainte (Néhémie 11 v. 1), ville de Dieu (Psaume 46 v. 4), ville de l’Éternel (Ésaïe 60 v. 14), ville du grand Roi (Matthieu 5 v. 35), ville de justice, cité fidèle (Ésaïe 1 v. 26), ville de vérité (Zacharie 8 v. 3), Ariel = « lion de Dieu, foyer de Dieu (Ésaïe 29 v. 1) », Jéhovah-Shamma = « l’Éternel est là » (Ézéchiel 48 v. 35 ). Jérusalem est devenue la capitale d’Israël sous David, et le temple de Dieu y fut construit sous Salomon. Là était le lieu que l’Éternel avait choisi pour y faire habiter son nom (Deutéronome 12 v. 5 ; 1 Rois 11 v. 32 à 36 ; Psaume 132 v. 13 et 14). Par conséquent, la ville a une importante signification symbolique non seulement pour Israël, mais aussi pour nous. Elle est souvent identifiée à Sion.
Dans le livre de Néhémie, Jérusalem est une figure de la communion des croyants dans la proximité immédiate de la maison de Dieu, séparés du monde ennemi par la muraille qui garde la bénédiction et refoule le péché. Dans le Nouveau Testament, Jérusalem est mentionnée plusieurs fois au sens figuré. En Galates 4 v. 25 et 26, la « Jérusalem de maintenant » est une figure du judaïsme attaché à la loi, qui se trouve dans la servitude spirituelle sous la loi de Sinaï (cf. v. 4, 5) ; en revanche, la « Jérusalem d’en haut » est l’expression des bénédictions, de la joie et de l’espérance que tous les croyants de tous les temps ont en commun. Déjà Abraham, le père des croyants, attendait cette « cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l’architecte et le créateur (Hébreux 11 v. 10) », et nous la connaissons aussi (Hébreux 12 v. 22 ; 13 v. 14). En revanche, la «nouvelle Jérusalem» future, mentionnée en Apocalypse 3 v. 12 et 21 v. 2 et suivants, est l’épouse de l’Agneau, l’Assemblée.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• JEZABEL, JESABEL - Livrée elle-même à la prostitution (c’est-à-dire à l’idolâtrie) et aux enchantements.
Jézabel, la femme du roi israélite Achab, était une fille d’Ethbaal, roi de Sidon, ville portuaire phénicienne sur la Méditerranée (1 Rois 16 v. 31). Les Sidoniens étaient des idolâtres comme les autres Cananéens, et, par son mariage avec Jézabel, Achab est devenu un adorateur de Baal. Jézabel ne s’est pas seulement livrée elle-même à la prostitution (c’est-à-dire à l’idolâtrie) et aux enchantements, mais elle a poussé son mari à des formes d’idolâtrie telles qu’aucun autre roi d’Israël ne les avait pratiquées (1 Rois 21 v. 25 ; 2 Rois 9 v. 22). Elle a exterminé les prophètes de l’Éternel et voulait aussi faire mourir Élie, parce qu’il avait tué les prophètes de Baal (1 Rois 18, 4; 19, 2). De plus elle a influencé, à l’arrière-plan, le gouvernement de son mari (1 Rois 21). Enfin, elle trouva la mort, sur l’ordre du roi Jéhu, en étant précipitée de la fenêtre de son palais et mangée par les chiens (2 Rois 9 v. 30 à 37).
Dans le Nouveau Testament, Jézabel (=Jésabel) est décrite comme une femme qui se dit prophétesse, mais quitte sa place subordonnée et, par ses enseignements, égare les esclaves de Dieu « en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles (Apocalypse 2 v. 20) ». Cela parle d’autorité usurpée et d’incitation à l’idolâtrie dans le sein de l’Église de Dieu.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• JOSEPH - Image de la vie et la mort du Seigneur Jésus.
Joseph était le onzième fils de Jacob, l’ancêtre d’Israël. L’histoire de sa vie est décrite dans les chapitres 37 à 50 de la Genèse et remplit ainsi presque un tiers du premier livre de la Bible. Joseph est une des rares personnes de l’Ancien Testament dont la vie est relatée en détail, mais desquelles pas un seul péché n’est mentionné. Aucun personnage biblique ne montre dans sa vie autant de conformité avec le Seigneur Jésus que Joseph. Il était le fils bien-aimé du père, prédestiné à régner et par conséquent haï de ses frères. Lorsqu’il fut envoyé par le père vers ceux-ci, ils tinrent conseil pour le faire mourir et le vendirent à des gens des nations. Il fut emmené comme esclave en Égypte et condamné sur la base de fausses accusations. Tout cela correspond dans beaucoup de détails à la vie et à la mort du Seigneur Jésus. Il fut finalement libéré et obtint les plus grands honneurs. Cependant ses frères n’en ont rien su.
À cette époque, il reçut pour épouse une femme d’entre les nations. Là aussi nous voyons des parallèles avec la glorification du Seigneur, son rejet et le fait qu’il n’a pas été reconnu par son peuple terrestre Israël, et la formation de son Assemblée. Les sept années de famine parlent de la grande tribulation à venir par laquelle le peuple de Juda sera amené à la repentance et finalement à reconnaître le Christ (Messie) venant en gloire. Enfin toute la famille de Jacob descend en Égypte pour y demeurer « dans la meilleure partie du pays » sous la domination de Joseph. Il en sera de même pour Israël dans le Millénium.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• JOUG - Le joug est souvent la figure de l’assujettissement.
Le joug est la partie du harnais, constituée le plus souvent par une pièce de bois, placée sur la nuque (ou sur le front) d’un bœuf attelé comme bête de trait. Le joug peut être utilisé pour un seul animal, mais aussi pour deux animaux qui par ce moyen sont fermement unis l’un à l’autre. Dans plusieurs passages de la Bible, ce mot est employé tout simplement dans le sens d’« une paire » (1 Rois 19 v. 19 à 21). Le joug est souvent la figure de l’assujettissement (Genèse 27 v. 40), de la servitude (1 Rois 12 v. 4 ; Galates 5 v. 1) et du service (1 Timothée 6 v. 1) ; le brisement du joug parle par conséquent de délivrance (Jérémie 28 v. 2).
Le joug de Christ était son obéissance volontaire à Dieu (Matthieu 11 v. 29 et 30). Le joug double est une figure de la communion. En Philippiens 4 v. 3, Paul appelle Épaphrodite son compagnon de travail (cf. 2 v. 25), littéralement son « compagnon de joug ». En 2 Corinthiens 6 v. 14, la communion d’un croyant avec un incrédule est appelée un « joug mal assorti » contre lequel nous sommes sérieusement mis en garde. Cette figure a trait à la défense faite en Deutéronome 22 v. 10, d’atteler ensemble à une charrue un bœuf (une bête pure) et un âne (une bête impure).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• JOUR - Le jour est caractérisé par la clarté et la lumière.
Le jour est la première division de temps mentionnée dans l’Ecriture sainte. Dieu appela Jour la lumière qu’il a créée, et les ténèbres, il les appela Nuit. Il y eut soir et matin, et ainsi il y eut le premier jour ou un jour (Genèse 1 v. 3 à 5). Les « luminaires dans l’étendue des cieux pour séparer le jour d’avec la nuit », c’est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, n’ont été créés que le quatrième jour (Genèse 1 v. 14). Contrairement à l’obscurité de la nuit, le jour est caractérisé par la clarté et la lumière. Sur le plan spirituel, Dieu nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière (1 Pierre 2 v. 9), de sorte que Paul peut écrire : « Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour ; nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres (1 Thessaloniciens 5 v. 5) ». Par le mot jour, il faut comprendre ici un état moral, spirituel, qui déjà maintenant est caractérisé par la lumière de Dieu (cf. Jean 11 v. 9 ; Romains 13 v. 13).
Dans le langage prophétique, le mot « jour » a une autre signification. Il désigne un temps encore futur. À la nuit actuelle des ténèbres spirituelles pendant l’absence du Seigneur succédera, après le lever de l’étoile du matin, la venue du Seigneur Jésus pour l’enlèvement des siens, le « jour » qui commencera avec l’apparition de Christ en gloire et se terminera avec la fin du Millénium. Par contraste avec l’enlèvement que les enfants de Dieu peuvent attendre avec un ardent désir, le « jour du Seigneur » viendra comme un voleur pour les incrédules (1 Thessaloniciens 5 v. 2 à 4 ; 2 Pierre 3 v. 10 ; Apocalypse 3 v. 3 ; 16 v. 15). Déjà dans l’Ancien Testament, le « jour de l’Éternel » (à ne pas confondre avec le dimanche, le jour du Seigneur ou « la journée dominicale », Apocalypse 1 v. 10) est annoncé comme le jour du jugement de Dieu sur le monde (Joël 1 v. 15 ; 2 v. 2 ; Sophonie 2 v. 2). Cependant pour ceux qui craignent le nom de Dieu, le Messie sera « le soleil de justice ; et la guérison sera dans ses ailes (Malachie 4 v. 1 et 2) ». En son jour, le Seigneur Jésus, jusqu’ici méprisé et rejeté, recevra dans ce monde, de tous les hommes, l’honneur dont il est digne.
Le « jour de Dieu » est équivalent au « jour d’éternité (2 Pierre 3 v. 12 à 18) ». Cette expression fait allusion à l’infini, dans le temps, de la nouvelle création, à l’état éternel, dans lequel Dieu sera «tout en tous» (1 Corinthiens 15 v. 28) ; avant son commencement, la création actuelle sera dissoute et fondue par le feu.
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• JOURDAIN - Le joug est souvent la figure de l’assujettissement.
Le peuple d’Israël devait traverser le Jourdain pour entrer en Canaan. Du point de vue typique, ce fleuve ressemble à maints égards à la mer Rouge. Toutefois ici les eaux ne furent pas frappées en jugement, mais l’arche de l’alliance, type du Fils de Dieu devenu Homme, passa devant le peuple d’Israël pour l’introduire dans le pays. Là aussi les eaux se fendirent, de sorte que le peuple put traverser sans obstacle (Josué 3 ; 4). Douze pierres, représentant les douze tribus d’Israël, devaient être posées au fond du fleuve. Le Jourdain également est une figure de la mort et de la résurrection de Christ pour les croyants, mais en même temps de leur résurrection avec lui (cf. Éphésiens 2 v. 6 ; Colossiens 3 v. 1). C’est pourquoi douze pierres furent dressées au bord du Jourdain. Il est aussi une figure du nouvel homme que le croyant est appelé à revêtir (Éphésiens 2 v. 15 ; 4 v. 24 ; Colossiens 3 v. 10). Le nouvel homme, créé selon Dieu, est destiné au ciel.
Le fait que la mer Rouge et le Jourdain forment un tout est remarquablement mis en évidence en ce qu’il est dit en Exode 14 v. 22 : « Et les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer », et en Josué 4 v. 19 : « Et le peuple monta hors du Jourdain ». De plus le jour de la traversée du Jourdain (le dixième jour du premier mois) était identique au jour du choix de l’agneau pascal, ce qui nous montre l’unité et la cohérence de ces types de la rédemption (cf. Josué 4 v. 23 ; Psaume 114 v. 3).
Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.
• Philippe Dehoux
La Bible d'après les textes originaux hébreu
• Georges A. et Christian B.
Enseignement pratique des paraboles
• JUGE (inique) (1) - La double signification de la parabole.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le remarquer, les paraboles ont très souvent une double signification : l’une spirituelle ou pratique, et l’autre prophétique. Cela est particulièrement et clairement mis en relief dans la parabole du juge inique. Mais écoutons d’abord ce qu’elle dit : « Et il leur dit aussi une parabole, pour (montrer) qu’ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, disant : Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes ; et dans cette ville-là il y avait une veuve, et elle alla vers lui, disant : Venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même : Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m’ennuie, je lui ferai justice, de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Et le Seigneur dit : Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d’intervenir pour eux ? Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais le fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? (Luc 18 v. 1 à 8) ».
La première phrase souligne la signification spirituelle et pratique de la parabole. Le Seigneur la dit à Ses disciples pour qu’ils prient toujours et ne se lassent pas. Par contre, les paroles du Seigneur qui terminent cette parabole ne peuvent être comprises que de manière prophétique. Comme beaucoup d’autres paraboles, celle-ci a donc à la fois un sens spirituel et un sens prophétique. C’est intentionnellement que le Seigneur relie ensemble ces deux significations, reliant par là le temps de Son absence avec celui de Son retour. Une telle parabole est déjà une preuve de ce que les paraboles du Seigneur contiennent plus qu’un niveau d’enseignement, et qu’elles ne doivent pas seulement être comprises de manière pratique, mais aussi prophétique.
Le côté pratique de la parabole nous a déjà occupé en relation avec la parabole des trois amis de Luc 11. Elle ne nécessite guère plus d’explication. Ici, nous ne devons garder présent à l’esprit que ce que nous devons apprendre du contraste : Dieu agit sur la base de motivations entièrement différentes de celles du juge inique. Ce juge n’est pas une image de Dieu. La force de la parabole réside justement dans le contraste entre le juge inique et le Dieu juste. Même quand le juge a finalement cédé aux instances de la veuve, c’est sans crainte de Dieu qu’il agissait (18 v. 4) ; il demeurait un « juge inique (18 v. 6) ». Mais par le fait qu’il a finalement quand même fait justice à la veuve, même sans dire ses vrais motifs, le Seigneur veut encourager les Siens à venir à Dieu en tout temps et avec persévérance pour présenter leurs demandes. Même si la réponse peut se faire attendre, et que le mal peut paraître prendre le dessus, Dieu fera justice en son temps à Ses élus, et Il l’exécutera rapidement.
Il y a plusieurs raisons pour se tourner maintenant vers le côté prophétique en détail. L’une est que cette parabole se trouve directement dans un contexte prophétique ; l’autre est que la plupart des détails de cette parabole n’ont de sens que prophétiquement ; enfin et troisièmement, il est extraordinairement important de s’approprier le point de vue prophétique de l’Écriture. Nous devons apprendre à distinguer entre les Juifs, les nations et l’assemblée de Dieu (comparer 1 Corinthiens 10 v. 32). La Bible devient un livre tout nouveau pour nous quand nous apprenons à connaître les différentes voies de Dieu qu’Il adopte avec les uns ou avec les autres, aujourd’hui et dans le futur. D’un autre côté, il n’est guère de pire entrave à la compréhension des pensées et des voies de Dieu que de ne pas voir les différentes dispensations, ou de les mélanger.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• JUGE (inique) (2) - Le résidu Juif dans l’avenir.
Que notre parabole ait une forte empreinte prophétique, cela apparaît tout de suite clairement quand on la considère en rapport avec ce qui précède. Le Seigneur Jésus avait parlé de Lui comme le Fils de l’homme, et d’autre part des jours du Fils de l’homme. Il devait au préalable souffrir beaucoup et être rejeté du peuple Juif. Mais alors en ce jour-là, « Son jour », Il viendrait à eux de manière visible pour tous, pour amener les uns en jugement, et pour introduire les autres dans le royaume. Les uns, les impies, seraient « pris » pour le jugement, tandis que les autres, les Juifs croyants, seraient « laissés » pour entrer dans le royaume terrestre de paix de Christ (17 v. 22 à 35). Le Seigneur ne parle ici ni de la destruction de Jérusalem par les Romains (car il n’y avait pas le choix), ni de l’enlèvement de l’église de Dieu (c’est juste l’inverse qui aurait lieu), mais Il parle de « Son jour », qui serait précédé de la période courte, mais extrêmement dure de la détresse de Jacob. L’aigle (les porteurs du jugement de Dieu) atteindrait le corps mort (Israël dans l’état de mort) sûrement et rapidement (17 v. 37).
On voit dès lors combien est appropriée l’exhortation adressée au Résidu d’Israël opprimé, mais craignant Dieu, de prier en tout temps et de ne pas se lasser (18 v. 1) ! Le Seigneur souligne cette exhortation, mais aussi cet encouragement, par le moyen de la parabole du juge inique.
Il y a donc dans la ville une veuve qui a un adversaire. Selon toute apparence, il a porté atteinte à son bien. Or dans la même ville se trouve aussi un juge, auquel la veuve s’adresse pour demander qu’il lui soit fait justice contre son adversaire. Le juge ne se soucie pas des intérêts de la veuve, et ne fait rien pour elle : il est un juge inique. Ce n’est que parce que la veuve le tourmente par ses interventions et requêtes incessantes, que finalement il l’aide à obtenir justice.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• JUGE (inique) (3) - La veuve est une image d’Israël souffrant sous l’emprise de son adversaire.
La veuve est une image d’Israël souffrant sous l’emprise de son adversaire. Autrefois, le peuple était en relation avec l’Éternel en tant que fiancée, épouse (Jérémie 2 v. 2) ; l’Éternel avait été son mari (Ésaïe 54 v. 5). Mais suite à son infidélité, elle était devenue vis-à-vis de Lui une veuve (Lamentations 1 v. 1). Et maintenant elle crie à Dieu, maintenant même que la nation est encore dans l’incrédulité. Ce fut exactement pareil autrefois quand les fils d’Israël crièrent à l’Éternel de la maison de servitude en Égypte, avant qu’Il se révèle à eux. Il dit donc Lui-même aujourd’hui d’Israël : « Je connais son affliction (Exode 3 v. 7) ». Et quand le temps prédéterminé par Dieu sera venu, Il se tournera de nouveau avec miséricorde vers Jérusalem, cette « ville » nommée deux fois dans la parabole. Il sera irrité contre les nations insouciantes et orgueilleuses, avec une grande colère parce qu’elles ont « aidé au mal (Zacharie 1 v. 14 à 17) ».
Quand la veuve demande qu’il lui soit fait justice, cela vise au premier chef qu’on lui rende sa propriété. Deux histoires de l’Ancien Testament l’illustrent et le confirment. Quand la Sunamite revint au pays de ses pères après avoir fui au pays des Philistins, « elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs (2 Rois 8 v. 3) ». Le roi lui rendit justice, et lui envoya un fonctionnaire de la cour auquel il dit : « Rends-lui tout ce qui lui appartient, et tout le revenu des champs, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu’à maintenant (2 Rois 8 v. 6) ».
La deuxième histoire a à faire avec une autre veuve qui avait besoin d’aide pour récupérer la propriété et l’héritage de son mari, il s’agit de Ruth. Cette veuve aussi est une figure du Résidu Juif croyant des jours futurs. Nous apprenons de son histoire comment elle vint finalement à Boaz, le libérateur / rédempteur (celui qui rachète) et comment cet homme puissant, et proche parent de sa belle-mère, entreprit, avec une grâce éclatante, tout ce qui était nécessaire pour relever le nom du défunt sur son héritage (Ruth 4 v. 1 à 12).
Nous voyons donc comment les élus de Dieu qui crient à Lui nuit et jour, le font selon une triple relation : comme avec leur roi, comme avec leur rédempteur (celui qui rachète) et comme avec leur juge. Leurs cris seront entendus. Mais il y a encore plus à tirer de ces récits.
Disons d’abord que, dans le Nouveau Testament, l’assemblée de Dieu n’est jamais vue comme une veuve. C’est Babylone, la chrétienté apostate, qui se vante dans son cœur de ne pas être veuve et qu’elle ne verra pas le deuil (Apocalypse 18 v. 7). Mais l’assemblée est l’épouse (céleste), la femme de l’Agneau (Apocalypse 19 v. 7 ; 21 v. 2, 9 ; 22 v. 17). Même si elle subit la tribulation dans le monde, elle a quand même la paix dans le Seigneur Jésus (Jean 16 v. 33). Il ne nous a pas laissé orphelins (Jean 14 v. 18), mais il a envoyé l’autre consolateur (ou : agent d’affaires), l’Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité (Jean 14 v. 16, 26 ; 15 v. 26 ; 16 v. 7, 13). Être déjà aujourd’hui enfants de Dieu et fils de Dieu, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ (Romains 8 v. 14 à 17), est-ce là la part d’une veuve ?
Qui faut-il comprendre sous le terme d’adversaire, celui à cause duquel la veuve crie continuellement au juge : « venge-moi de mon adversaire » ? Apocalypse 12 nous donne une information sur ce sujet. Nous y apprenons là que « le grand dragon, le serpent ancien, qui a nom diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée toute entière » sera précipité du ciel sur la terre. Nous entendons le ciel éclater de joie : « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l’accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité (Apocalypse 12 v. 10) ». L’expression nos frères n’a pas trait en premier lieu à nous chrétiens, mais aux Juifs croyants du Résidu. Ce sont eux que le diable accuse continuellement devant Dieu. C’est lui, à proprement parler, l’adversaire, celui qui se tient derrière tous les autres ennemis d’Israël et qui les incite contre ce peuple.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• JUGE (inique) (4) - Nous ne demandons pas la vengeance de Dieu sur nos ennemis, mais nous supplions « Amen, viens Seigneur Jésus ! ».
Pour confirmer que nous n’avons pas l’assemblée dans cette parabole, mais que nous avons à faire avec les Juifs des jours à venir, je reviens encore une fois sur la requête de la veuve. Elle porte un caractère strictement juif. La veuve demande qu’il lui soit fait justice, qu’elle soit vengée de ses ennemis. Le mot grec signifie en effet à la fois « faire justice » et « se venger », « venger ».
Pour nous, rachetés du temps de la grâce, une telle demande serait absolument hors de place. Nous n’avons pas à rechercher nos droits ici-bas (1 Corinthiens 6 v. 7), et au lieu d’appeler la vengeance sur nos ennemis, nous devons bien plutôt les aimer, prier pour ceux qui nous font du tort ou nous persécutent (Matthieu 5 v. 44). Étienne, le premier martyr chrétien, n’en est-il pas le grand exemple pour nous ? Fidèle à l’exemple de son Maître et Sauveur Jésus Christ (Luc 23 v. 34), il priait pour ceux qui le lapidaient : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché (Actes 7 v. 60) ».
Mais pour les Juifs croyants oppressés par leurs ennemis, l’appel à la rétorsion est tout à fait selon la volonté du Seigneur.
En Apocalypse 6 nous entendons les âmes des martyrs Juifs crier à Dieu à haute voix : « Jusques à quand, ô Souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ? (Apocalypse 6 v. 10) ». Une telle demande, venant de bouches juives, exprime la pensée de Dieu pour ce peuple. C’est pourquoi Il satisfera cette demande, et Il viendra en aide au Résidu. Car le peuple d’Israël ne trouvera salut et repos, et ne parviendra à la bénédiction terrestre du royaume, que par le jugement de ses ennemis. Ce n’est aussi que de cette manière que la gloire du Seigneur pourra être obtenue sur cette terre. En harmonie avec cela, nous trouvons à de multiples reprises dans les psaumes la parole prophétique du Résidu, le « jusques à quand ? » poignant d’un peuple souffrant (Psaume 90 v. 13 ; 94 v. 1 à 3 ; 119 v. 84). Il désirera la venue du Seigneur comme juge de la terre.
Pour nous chrétiens, il en est tout autrement. Nos bénédictions se situent dans le ciel, et notre salut n’arrive pas par le Seigneur chassant nos ennemis, mais par le fait qu’Il nous éloignera complètement de cette scène terrestre, et qu’Il nous prendra auprès de Lui dans la gloire. Par quoi le Seigneur va-t-Il donc nous « garder de l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée toute entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre » ? Par le fait qu’Il nous prendra et nous sortira absolument de cette heure ou époque ! Bienheureuse certitude !
« Je viens bientôt ». C’est de cette manière, c’est-à-dire par Sa venue pour nous, par l’enlèvement, que nous ferons l’expérience du salut final et complet (Romains 13 v. 11 ; 1 Thessaloniciens 4 v. 15 à 18 ; Apocalypse 3 v. 10 et 11). C’est aussi pour cela que nous ne demandons pas la vengeance de Dieu sur nos ennemis, mais que nous supplions « Amen, viens Seigneur Jésus ! »
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• JUGE (inique) (5) - Dans la parabole, le Seigneur parle de la veuve dans l’explication de Ses élus.
Rappelons-nous encore une fois les paroles dont le Seigneur se sert à la fin de la parabole, ainsi que Son explication et l’application qu’Il en fait aux élus : « Et le Seigneur dit : Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience [avant d’intervenir] pour eux ? Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais le fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? (Luc 18 v. 6 à 8) ».
À plusieurs reprises nous avons déjà vu ceci, que quand le Seigneur Jésus explique ou applique une parabole, Il ne parle pas nécessairement exactement des mêmes personnes que dans la parabole elle-même. La parabole et son explication ne coïncident pas toujours exactement. C’est le cas ici. Dans la parabole Il parle de la veuve et dans l’explication de Ses élus. La veuve représente Israël, et Ses élus représentent le Résidu d’Israël qui a la crainte de Dieu, ces frères que le diable accuse continuellement devant Dieu. Dans la parabole, la veuve vient avec ses requêtes incessantes auprès du juge qui se révèle être un juge inique. Dans l’explication ce sont les élus de Dieu qui crient à Dieu nuit et jour.
Le prophète Ésaïe parlait déjà de façon si saisissante de ces cris des élus de Dieu : « Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai établi des gardiens ; ils ne se tairont jamais, de tout le jour et de toute la nuit. Vous qui faites se ressouvenir l’Éternel, ne gardez pas le silence, et ne lui laissez pas de repos, jusqu’à ce qu’il établisse Jérusalem, et qu’il en fasse un sujet de louange sur la terre (Ésaïe 62 v. 7) ». Oui, Dieu fera justice à Ses élus qui crient nuit et jour, même si le temps pour y arriver paraît bien long à ceux qui sont dans la détresse. Pour le Seigneur, mille ans ne sont que comme un jour (2 Pierre 3 v. 8). Mais quand le moment d’intervenir sera venu pour Dieu, Il agira rapidement. Il nous a déjà été dit quelque chose de la rapidité et de la précision d’action de l’aigle.
À la fin, le Seigneur pose encore une question qui doit nous faire réfléchir : « Le fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? ». Il ne répond pas Lui-même à cette question, mais la laisse à Ses auditeurs. Or la forme de la question laisse attendre un « non » comme réponse. J’ai déjà fait la remarque au commencement que cette phrase ne peut être comprise qu’au sens prophétique, c’est-à-dire que nous devons la prendre en rapport avec Israël. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour enlever les croyants de la grâce, ce sera alors avec le caractère d’époux, car « l’Esprit et l’épouse disent : viens ! (Apocalypse 22 v. 17) ». Mais sa venue future comme Fils de l’homme a à faire avec Israël et avec le jugement sur toutes les injustices. Comme nous l’avons vu, c’est selon cette dernière manière de venir que le Résidu croyant d’Israël L’attendra.
Il est pourtant étrange que, quand Il viendra, le Seigneur aura pour ainsi dire de la peine à trouver de la foi sur la terre. D’un côté cela peut signifier qu’en ces jours-là, la foi sera rare, aussi rare qu’aux jours de Noé et de Lot (Luc 17 v. 26 et suiv.). Comme dans ce temps-là, on mangera et on boira, on se mariera et on sera donné en mariage, on achètera et on vendra, on plantera et on bâtira. Mais avec tout cela, le jugement de Dieu sur le point de s’abattre sur eux subitement, est suspendu sur eux comme par un fil de soie, et la masse des gens ne s’en rendra pas compte, pas plus qu’aujourd’hui. Peu nombreux sont toujours ceux qui en savent quelque chose, ce sont les élus, et qui conduisent leur vie en conséquence.
Mais d’un autre côté, même la foi des élus dans ces jours difficiles sera bien faible. N’avons-pas aussi vécu cela nous-mêmes, nous avons crié à Dieu dans la détresse, et nous ne comptions même pas sur une intervention si opportune de Sa part ? On peut faire appel à Dieu dans l’amertume de l’âme, et pourtant manquer de la confiance vraie et calme qui résulte de la communion avec Lui. Cette question interpellante du Seigneur est donc aussi importante pour nous.
Finalement nous pouvons encore remarquer que la parabole du juge inique remplit encore deux fonctions. D’un côté c’est une prolongation de ce que le Seigneur avait dit auparavant (Luc 17 v. 22 à 36). D’un autre côté, cette parabole sert d’introduction et de transition pour la parabole suivante du pharisien et du publicain (18 v. 9 à 14). Dans les deux paraboles l’objet de la prière est le même. La prière persévérante sera la ressource du Résidu juif souffrant des jours qui viennent, et c’est aussi déjà la ressource des croyants aujourd’hui, et de fait c’est la ressource des croyants de tous les temps.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• JUGEMENT (discriminatif) - Les brebis héritent du royaume et de la vie éternelle, alors que les chèvres sont jetées dans le feu éternel.
Dans sept paraboles de Matthieu, ceux qui, jusqu’au retour du Seigneur, étaient mêlés, sans qu’on puisse souvent distinguer clairement qui a la vie et qui ne l’a pas, sont alors définitivement séparés. Dans la parabole de l’ivraie, le froment est assemblé « dans mon grenier », tandis que l’ivraie est brûlée. Dans celle de la seine jetée dans la mer, les bons poissons sont mis dans des vaisseaux, les mauvais sont jetés dehors.
Aux noces, à l’entrée du roi, celui qui n’avait pas de robe de noces, est jeté dehors dans les ténèbres, tandis que les autres jouissent avec le roi de la communion et de la joie de la fête. En Matthieu 24, le fidèle esclave est établi sur tous les biens du maître ; le méchant, qui prétendait être un esclave, est coupé en deux ayant sa part avec les hypocrites. Les vierges sages accompagnent l’Époux aux noces ; les folles restent à toujours devant une porte fermée. Ceux qui ont fait fructifier leurs talents, entrent dans la joie de leur maître ; l’esclave inutile est jeté dans les ténèbres de dehors. Enfin les brebis héritent du royaume et de la vie éternelle, alors que les chèvres sont jetées dans le feu éternel.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• JUGEMENT (distributif) - Seule l’appréciation du maître fixe la récompense.
Nous avons déjà considéré à travers d'autres paraboles la question des récompenses : le serviteur fidèle entre dans la joie de son maître ; l’esclave qui a répondu à la responsabilité confiée, reçoit l’autorité sur plusieurs villes. Seule l’appréciation du maître fixe la récompense, non la durée ou la qualité apparentes du service.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• JUGEMENT (rétributif) - Les hommes seront jugés selon leurs œuvres, chacun recevra la rétribution que mérite sa conduite.
Il atteint ceux qui sont encore dans leurs péchés et en ont conservé le fardeau. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont lavés par son sang, ne viennent pas en jugement (Jean 5 v. 24) : l’Éternel a mis sur Lui l’iniquité de nous tous. En Matthieu 22 v. 7, la ville des conviés qui ont refusé l’invitation du roi et persécuté ses esclaves, est détruite ; en Luc 13 v. 9, le figuier définitivement stérile est coupé ; et en Matthieu 21 v. 41, les vignerons qui ont gardé pour eux le fruit de la vigne et ont fait mourir le fils qui leur était envoyé, périssent à leur tour.
« Voici je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre (Apocalypse 22 v. 12) ». Devant le grand trône blanc, quand les hommes seront jugés selon leurs œuvres, chacun recevra la rétribution que mérite sa conduite (Matthieu 11 v. 22 à 24).
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• JUGEMENT (temporel et éternel) - Il ressort clairement combien, dans l’interprétation des paraboles, l’aspect dispensationnel et prophétique est important.
Il me semble nécessaire de faire encore une remarque à propos de l’expression « son iniquité est acquittée » d’Ésaïe 40 v. 2. Car certains disent peut-être : « il est donc quand même possible d’acquitter sa dette devant Dieu, jusqu’à ce que le dernier quadrant soit payé ! Or c’est pourtant ce qui vient d’être contesté ».
Il faut bien faire attention qu’il s’agit ici d’Israël, et d’un jugement de Dieu temporel et national envers ce peuple coupable. Le jugement temporel concerne le peuple dans son ensemble et est en rapport avec les voies de Dieu en gouvernement à l’égard d’Israël ; il a à faire avec la terre. En rapport avec Ses voies en gouvernement à l’égard des hommes, Dieu peut limiter la mesure de punition ; Il peut même « se repentir du mal » qu’Il avait parlé de faire, et ne pas le faire, comme dans le cas des Ninivites (Jonas 3 v. 10). Cela repose sur la souveraineté de Sa grâce. Mais (il vaut la peine de le remarquer) quand Dieu pardonne au peuple d’Israël en tant que nation, les personnes qui profitent de ce pardon sont alors toutes autres que celles qui ont, par le passé, subi cette sentence. Ce sera un pardon national et aussi dispensationnel, c’est-à-dire un pardon rattaché à une dispensation.
C’est cela qui fait ressortir clairement la différence décisive entre ce jugement temporel qui s’applique aux voies de Dieu sur la terre, et le jugement éternel de Dieu. Le jugement éternel est un jugement personnel ; il atteint des individus à cause de leur culpabilité personnelle, « afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu’il aura fait, soit bien, soit mal (2 Corinthiens 5 v. 10) ». En Apocalypse 20 nous voyons les morts se tenir devant le grand trône blanc, « et les morts furent jugés d’après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres (Apocalypse 20 v. 12) ». S’il s’agit de la culpabilité personnelle de l’individu devant Dieu, il n’y a jamais d’acquittement de la dette, mais seulement la possibilité de se réconcilier avec l’« adversaire », aussi longtemps qu’on est « en chemin » avec lui, aussi longtemps qu’il est dit « aujourd’hui ». Et comme le péché de l’individu exige, aux yeux de Dieu, une mesure éternelle de châtiment, ainsi aussi la rédemption en vertu du « sang précieux de Christ comme d’un agneau sans défaut et sans tache » a une portée éternelle (1 Pierre 1 v. 19).
Or il en va tout différemment quand il s’agit d’une question du péché de tout un peuple. Dans ce cas, chaque individu reste encore naturellement entièrement responsable de ses actes devant Dieu. Mais le peuple d’Israël en tant que nation s’est en outre rendu responsable devant Dieu du rejet du Messie. Si en réponse à cela, Dieu a mis le peuple d’Israël de côté, Il peut limiter ce jugement dans le temps, et pardonner à nouveau en son temps au peuple en tant que tel. C’est justement ce qu’Il fera, comme nous venons de le voir ; Il greffera de nouveau les branches naturelles sur leur propre olivier (Romains 11 v. 23 et suiv.). C’est cela qu’on entend par les expressions de pardon national et dispensationnel. Sa portée se borne à la terre, et ne s’étend pas à l’éternité.
De ces considérations, il ressort clairement combien, dans l’interprétation des paraboles, l’aspect dispensationnel et prophétique est important. Notre parabole en est justement un exemple. Nous ne pourrions pas la comprendre sans prendre en compte le côté prophétique.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.
• JUGER (les autres) - Nous devons nous garder de juger les motifs qui ont fait agir autrui.
Le fétu et la poutre (Matthieu 7 v. 1 à 5 ; Luc 6 v. 41). Ne jugez pas, dit le Seigneur. Non qu’il ne faille, lorsque c’est nécessaire, juger les actes et, en particulier, exercer la discipline fraternelle ou celle de l’assemblée. Mais nous devons nous garder de juger les motifs qui ont fait agir autrui. Avant de chercher à corriger les autres et de leur faire la leçon, combien il importe d’ôter d’abord la poutre de son propre œil. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Seul le jugement de soi-même permet de voir clair pour ôter le fétu de l’œil de son frère. Que de fois on critique tel ou tel détail de la vie d’autrui, de sa mise, de sa maison, et l’on n’est pas conscient de son propre égoïsme et de son propre orgueil. En Galates 6 v. 1, après avoir exhorté les frères spirituels à redresser dans un esprit de douceur, celui qui s’est laissé surprendre par quelque faute, l’apôtre ajoute : « Prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté ».
En Jean 13, le Seigneur Jésus nous a donné l’exemple suprême. Lui, le Seigneur et le Maître, n’est pas resté à table, mais s’étant levé du souper, il a mis de côté ses vêtements, symbole de sa gloire, puis, ayant pris un linge et s’en étant ceint, il a versé de l’eau dans le bassin et s’est mis à laver les pieds des disciples. Dans quel but ? Si je ne te lave, tu n’as pas de part avec moi, dit-il à Pierre. Pas de communion avec le Seigneur si nos pieds n’ont pas été lavés par lui ! Comme notre Avocat, il intercède pour nous et nous amène à la confession de nos fautes. Mais le Seigneur ajoute : « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j’ai lavé vos pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Dans l’esprit du Seigneur, imitant son humilité et son amour, avoir à cœur la restauration de nos frères afin de jouir à nouveau de la communion avec eux. Leur rappeler l’amour du Seigneur pour eux, ce qui Lui est dû, dans la conscience de la grâce qui s’est exercée aussi bien envers eux qu’envers nous, les aider à en reprendre conscience.
La vie est faite de détails ; toutes ces paraboles, très courtes pour la plupart, nous montrent quel soin le Seigneur désire que les siens aient de ces détails. Où sont les ressources pour une telle marche ? Elle ne peut se réaliser qu’« en nouveauté de vie » (Romains 6 v. 4), en demeurant en Lui. « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire (Jean 15) ». Mais « celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ». Pas de lumière sans contact avec la source ; pas de marche à la gloire du Seigneur, ni de témoignage, sans communion journalière avec lui.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• JUSTICE (la propre) - Le Seigneur met en évidence divers moyens que l’ennemi emploie pour empêcher les âmes de venir à Lui.
Dans la même parabole (Matthieu 22 v. 11 à 13) Jésus parle d’un homme assis à table sans être revêtu de la robe de noces. Il avait sans doute estimé son propre vêtement meilleur que la robe offerte par son hôte. Mais il suffit d’un regard du roi (v. 11) pour tout mettre en lumière ; un sort terrible attend celui qui avait cru pouvoir s’asseoir à la table divine, drapé dans sa propre justice : il est lié, emporté, jeté dehors, dans les ténèbres, où sont les pleurs et les grincements de dents.
Quel contraste avec le fils prodigue qui, revêtu de haillons, acceptait avec joie la plus belle robe offerte par son père. Tandis que « le fils aîné, dans Luc 15 », nous donne un autre exemple de cette propre justice qui refuse l’invitation de la grâce. Cet homme était conscient de toutes ses vertus : « Voici tant d’années que je te sers, et jamais je n’ai transgressé ton commandement ». Ils sont nombreux ceux qui, comme un autre jeune homme, disent : « J’ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse (Luc 18 v. 21) ». Au début du récit, les deux frères étaient à la maison, élevés dans la même ambiance, par le même père. Au cours de la parabole, l’un s’en va, et l’aîné seul reste au foyer. À la fin, le plus jeune, revenu à la vie, est dedans, alors que son frère est dehors. Pourquoi dehors ? Parce que « il ne voulait pas entrer ». Il aurait préféré s’asseoir avec ses amis et faire bonne chère avec eux, que d’être à table avec son père et son frère ! Malgré l’insistance paternelle, il reste dehors, égaré par sa propre justice, incapable de saisir la grâce.
Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.
• Bible-foi.com
Compilation de commentaires
 Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Remmers Arend - (Images et symboles bibliques).
Philippe Dehoux - (La Bible d'après les textes originaux hébreu).
Georges André et Christian Briem - (L'enseignement pratique des paraboles).
Bible-foi.com - (Compilation de commentaires).