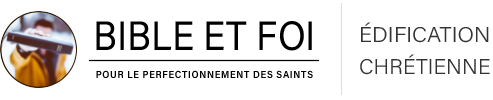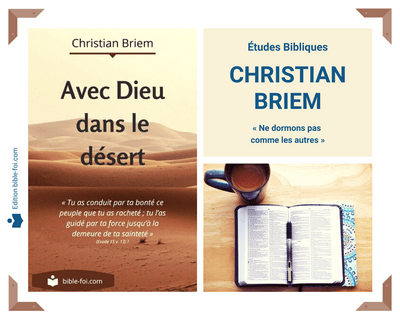
2. La mort, un ennemi vaincu
Chap: 2 - La résurrection du corps 15 v. 35 à 49 - La première partie de 1 Corinthiens 15 nous a montré clairement qu’il y a une relation indissoluble entre la résurrection de Christ et celle de ses rachetés.
Certains croyants à Corinthe n’attachaient pas beaucoup d’importance à la vérité sur la résurrection du corps, étant davantage occupés de la partie supérieure de l’homme, l’esprit ; ils pensaient être de cette manière très spirituels. Mais l’apôtre Paul leur avait enseigné combien la résurrection du corps était quelque chose d’essentiel et fondamental, et en même temps pratique dans ses conséquences.
Quelques détails avaient pourtant encore besoin d’être complétés. Par exemple, ces croyants étaient plus ou moins partis du fait que tous les croyants allaient mourir et qu’ils ressusciteraient lors de la venue de Christ. Mais en est-il vraiment ainsi ? N’y aura-t-il plus de saints vivants lors de la venue du Seigneur Jésus ?
C’est la dernière partie de ce chapitre remarquable qui va nous en apprendre davantage là-dessus et sur bien d’autres questions. Jusqu’ici l’apôtre Paul avait parlé du « fait » de la résurrection. Maintenant, il enchaîne en plaçant devant le croyant le caractère et le processus de cet évènement merveilleux.
À la discussion sur la transformation que subira notre corps lors de la résurrection, se mêle facilement des doutes sur la résurrection elle-même ; c’est le diable qui les alimente.
Dieu connaît les dangers qui guettent ses enfants, et conduit ainsi son serviteur à s’emparer de quelques arguments de l’incrédulité, non seulement pour combattre ainsi l’ennemi, mais aussi pour faire briller d’autant plus clairement le « comment » de la résurrection.
Arguments de l’incrédulité (15 v. 35).
En elle-même, la doctrine de la « résurrection corporelle » avait été présentée de façon suffisamment claire pour tous ceux qui sont réellement prêts à se soumettre à l’enseignement divin. Quand on connaît la toute-puissance et l’omniscience de Dieu, on n’a pas de problème avec la résurrection.
Mais les Corinthiens, malgré leur peu de connaissance de Dieu et de son être, étaient des intellectuels discuteurs, et parmi eux, il y avait des gens qui, sans attaquer ouvertement la vérité, cherchaient à mesurer les faits et vérités divins à l’aune de l’expérience humaine, faisant semblant d’être sincères en se lamentant sur leurs difficultés.
Il semble que les croyants à Corinthe, au moins en partie, s’étaient déjà laissés contaminer par l’esprit des rationalistes. Car l’apôtre avait dû leur lancer un appel qui était un blâme : « Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte » (15 v. 34).
L’apôtre anticipe deux questions des sceptiques incrédules sur la résurrection des saints, qui se ramènent les deux au « comment ? » de la résurrection : « Mais quelqu’un dira : Comment ressuscitent les morts, et avec quel corps viennent-ils ? » (15 v. 35).
On peut dire que la première question a trait au déroulement de la résurrection, la deuxième à son caractère. La réponse à ces deux questions se trouve dans la suite du chapitre, mais l’apôtre commence par répondre à la deuxième question (à partir du v. 42), peut-être parce qu’elle est plus définitive (la réponse à la première figure à partir du v. 50). Si, par la grâce de Dieu, l’apôtre Paul aborde ces questions, ce n’est pas pour revaloriser les arguments incrédules de certains sceptiques, mais pour fortifier la foi des saints en danger ; et il y avait bien de quoi, comme on l’a déjà vu, et nous sommes certains qu’il y en a autant besoin aujourd’hui.
Si nous comprenons le genre de raisonnements qui se trouvent derrière ces questions, il devient clair qu’il s’agit d’objections provenant de l’incrédulité. Les hommes ne peuvent se représenter un corps humain que sous une forme terrestre, comme nous le connaissons d’après la vie ici-bas.
Du fait qu’un corps de ce genre, tiré de la poussière de la mort et ramené à la vie par la puissance de Dieu, ne serait pas adapté au ciel, les sceptiques attaquent le principe lui-même, et en tirent la conclusion : Il n’y a pas du tout de résurrection du corps. Peut-être posent-ils ces questions uniquement pour susciter une réponse des croyants qui puisse leur donner occasion de se moquer d’eux, en disant que ces corps de résurrection ne sont même pas adaptés pour le ciel.
Cela confirme une fois de plus que nous ne saurions absolument rien sur ce qui aura lieu après la mort, si Dieu ne nous l’avait pas révélé. Abandonnés à nous-mêmes, nous n’en saurions pas plus que les philosophes cinq siècles avant Jésus-Christ : Socrate, Platon, Aristote, et bien d’autres, ont beaucoup réfléchi sur la vie, la mort et l’au-delà, mais dans le meilleur des cas, ce n’était que des spéculations.
Or Dieu a parlé, bien-aimés ! Il a donné des révélations sur ce qui va arriver dans l’au-delà, et aussi sur la sorte de corps dont Il nous revêtira lors de la résurrection. C’est maintenant une joie pour nous d’apprendre davantage sur ce sujet par le moyen de sa parole qui ne trompe pas. Le propre du croyant n’est pas de discuter ce que Dieu dit.
De plus, il n’essaie pas d’expliquer par son intelligence ce qui se trouve au-delà de la capacité de compréhension humaine. Bien plutôt, il croit simplement à ce que Dieu a révélé dans sa parole. Il se peut que lui aussi ne comprenne pas beaucoup par son intelligence ce que Dieu communique sur les processus puissants et surnaturels. Mais cela ne l’inquiète guère puisqu’il sait que le Dieu tout-puissant et omniscient veut dire et fera exactement ce qu’Il dit.
Toute vraie connaissance se trouve auprès de Dieu. Lorsque Dieu nous communique quelque chose qui vient de sa connaissance insondable, et quand Il parle de manière très simple et presque évidente sur les événements les plus extraordinaires, cela nous rend heureux et reconnaissants outre mesure.
Exemples de la nature servant de modèles.
Avant que l’auteur inspiré de l’épître entre dans le détail des deux questions, il voit la nécessité de mettre en lumière la folie de ceux qui ont la prétention de pouvoir mettre en doute la toute-puissance de Dieu dans la résurrection.
Mourir : la condition pour une vie nouvelle.
« Insensé ! ce que tu sèmes n’est pas vivifié s’il ne meurt » (15 v. 36). On a fait remarquer à juste titre que le qualificatif d’« insensé » est autant inspiré du Saint-Esprit que la parole précieuse de Jean 3 v. 16. C’est un terme fort, et n’a pas ici le sens habituel de stupide, bête, sot, mais il décrit quelqu’un qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas. Rejeter ce que l’on ne peut pas expliquer n’est pas seulement sot, mais cela témoigne d’un manque de capacité à réellement réfléchir lorsqu’on ne voit même pas les analogies ou similitudes entre la nature et les processus spirituels.
Dieu a donné dans sa création beaucoup d’images de la résurrection. Avant d’entrer davantage dans l’image donnée dans ce verset, j’aimerais attirer l’attention sur une autre image qui m’a toujours particulièrement impressionné.
Je pense à la chenille plus ou moins laide, qui n’arrête pas de faire des trous dans les feuilles qui la portent. On préférerait l’écraser du pied. Mais arrêtons-nous un peu, et observons ce qui arrive au bout de quelque temps à cet insecte rampant, d’apparence peu sympathique.
Une transformation étrange s’accomplit : La chenille commence à s’embobiner complètement dans un cocon. Elle hiberne dans cet état apparemment sans vie. Puis au printemps, elle perce sa prison, et qu’en sort-il ? Une chenille ? Non, un papillon bien coloré et bien dessiné, si l’on peut dire, une créature qui ne va plus ramper par terre, ni sur des feuilles ou des branches, mais qui s’envole dans les airs. C’est une très belle image de ce que sera la résurrection.
Mais l’exemple que l’Écriture sainte donne dans notre verset (15 v. 36), attire l’attention sur une circonstance particulière qui ne ressort pas très clairement de l’exemple de la transformation de l’insecte : Le grain de semence semé en terre doit mourir avant d’amener une vie nouvelle.
Le Seigneur Jésus a lui-aussi utilisé cette image à l’égard de lui-même, de sa mort expiatoire et de sa résurrection : « En vérité, en vérité, je vous dis : À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12 v. 24).
N’est-ce pas manquer de sens que de ne pas remarquer cette analogie à la nature ? Le pain quotidien que mange le sceptique est pourtant un témoin muet de la vérité qu’il nie : Le grain devait mourir avant que la plante puisse vivre.
S’il pensait davantage au processus habituel de la nature, avec un cœur plus sage, s’il réfléchissait davantage à sa propre habitude de faire, il aurait alors moins de difficultés avec la résurrection. L’apôtre se montre presque surpris du manque de réflexion de telles personnes ; ils sont si pesants qu’ils ne saisissent rien de ce qui s’offre à leurs yeux tous les jours, et qu’ils sont incapables d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
Dieu, qui avait initié l’homme dès le début à la bonne pratique de semer et de moissonner : « Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix ! Soyez attentifs, et écoutez ma parole ! Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin ; qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords ?
Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin ; mais on bat la nielle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours ; on y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées ; admirable est son conseil, et grande est sa sagesse » (Ésaïe 28 v. 23 à 29).
Ne doit-Il pas être capable de faire quelque chose de bien plus grand ? En fait, il y a beaucoup de cas où la nature offre à l’œil éduqué par Dieu, des parallèles avec l’action de Dieu dans le domaine spirituel.
Cependant, en appliquant une analogie ou une comparaison, il ne faut pas aller au-delà du point spécifique de la comparaison, qui, dans notre cas est celui-ci : la dissolution de l’ordre de choses existant (= la mort) précède la vie nouvelle. Ce qui vient en premier est nécessaire pour qu’arrive ce qui vient en second, et ce qui vient en second dépend de ce qui vient en premier.
L’analogie ne se trouve pas entre le germe de la semence et quelque chose de semblable qui serait présent dans notre corps mort et enterré ; car dans notre corps mort, il ne se trouve rien qui ne soit en aucune manière comparable à ce germe.
Encore un point qui aide beaucoup à comprendre : La mort ne signifie pas extinction ou anéantissement, soit que nous pensions au grain de semence ou bien à notre corps, mais il s’agit d’une dissolution, d’une séparation.
Lorsqu’un homme meurt, l’ordre existant de l’esprit, de l’âme et du corps, est dissous ; autrement dit : Le lien entre la partie invisible (esprit, âme) et la partie visible (corps) est dissous, d’où il s’ensuit la corruption du corps. Mais à partir de là, il y aura comme résultat le déploiement d’une nouvelle vie. La mort n’est donc pas un obstacle à la résurrection, mais elle en est bien plutôt la condition nécessaire.
Identité malgré la transformation (15 v. 37 et 38).
Les deux versets suivants développent ce qui vient d’être dit. Il ne s’agit pas d’une nouvelle comparaison, mais l’analogie déjà employée est poursuivie et développée. L’écrivain inspiré rattache donc ce verset à ce qui précède par le mot « et ».
« Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain, de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu’une des autres semences ; mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps » (1 Corinthiens 15 v. 37 et 38).
Le verset 36 traitait du fait de la résurrection. Maintenant l’apôtre parle, également sous forme imagée, de l’art et la manière de la transformation. Ce faisant, il prépare ce qu’il va dire plus loin (à partir du verset 42) sur la « résurrection des morts » et son caractère, mais il le dira alors sous forme plus directe.
L’agriculteur qui sème la semence dans son champ sait très bien deux choses : d’abord, s’il sème du blé, il poussera du blé ; ensuite, s’il sème un grain nu, ce qu’il récoltera aura une forme très différente, plus riche.
Cela nous apprend déjà quelque chose de très important : Malgré la transformation merveilleuse qui s’accomplit, une identité absolue subsiste. Chaque semence conduit à sa propre plante ; mais ce qui pousse se différencie fortement de ce qui est semé. Nous reviendrons davantage là-dessus plus loin.
Tout d’abord, faisons attention à la différence entre « Tu » et « Dieu » : « ce que « tu » sèmes… ce que « tu » sèmes » : « mais Dieu ». « Nous » ne pouvons que semer ; c’est tout ; nous ne sommes pas capables de faire plus. Mais Dieu fait le reste, c’est lui qui fait ce qui est vraiment important.
Ce qui est placé dans la terre est un grain nu, et ce qui pousse est une plante magnifique. C’est Dieu qui est responsable de ce miracle, car il est dit : « Dieu lui donne son corps » (1 Corinthiens 15 v. 38). Paul ne fait pas ici un exposé scientifique sur la biologie, et il ne parle pas non plus des lois de la nature. Non, il revient à Dieu lui-même, qui a créé toutes les lois de la nature. Et si nous ne perdons pas de vue la raison pour laquelle il présente cette analogie, il y a une chose qui devient tout de suite très claire : La résurrection de notre corps mort sera également et entièrement l’œuvre de Dieu. C’est Dieu qui nous donne le corps de résurrection.
Et encore autre chose : Dieu fait son œuvre avec le grain nu auquel Il donne un corps comme Il a voulu. Pourquoi le verbe est-il au passé ici ? C’est que lors de la création des plantes, Il a déjà déterminé que chaque herbe devait donner une semence « selon son espèce » (Genèse 1 v. 11 et 12). Dès le début, il y a eu différentes espèces, selon le bon plaisir de Dieu, et cela n’a pas changé depuis ; c’est toujours resté pareil. Chaque sorte de semence génère son propre corps, caractéristique de l’espèce.
Pourtant, les incrédules excluent Dieu et la création de leurs réflexions, et ils introduisent l’évolution à la place. Mais la phrase « à chacune des semences son propre corps », démasque de telles pensées et montre qu’elles sont de la pure spéculation.
Si nous faisons l’application de l’action de notre grand Dieu dans la nature, à son action dans la résurrection des saints (ici, c’est justement l’intention du Saint-Esprit), nous pouvons en tirer des conclusions importantes : La résurrection des croyants amènera, quant au corps, un changement radical. Un « épi » magnifique sortira du « grain nu », et ce corps de résurrection que Dieu nous donnera sera entièrement selon sa volonté.
Malgré ce grand changement, l’identité personnelle sera néanmoins absolument conservée. Cela veut dire que la personnalité du croyant que Dieu a créée, restera entièrement intacte, malgré tout le grand changement du corps. Cela inclut que les enfants de Dieu pourront se reconnaître mutuellement dans la résurrection, une pensée très heureuse.
Job reste Job, David reste David, Paul reste Paul, et toi, tu restes toi-même. N’y a-t-il pas là de quoi nous réjouir dès aujourd’hui du jour de la résurrection, d’autant plus que non seulement nous nous verrons et nous nous reconnaîtrons l’un l’autre, mais en premier lieu, nous verrons et reconnaîtrons celui qui a donné sa vie pour nous, et qui est ainsi la cause de tout notre bonheur ?
La scène merveilleuse sur la montagne de la transfiguration confirme ce qui vient d’être dit. Les disciples du Seigneur n’avaient naturellement jamais vu Moïse et Élie. Mais quand ces deux hommes « apparurent en gloire » avec le Seigneur, les disciples purent les reconnaître tout de suite. Mais malgré tout, c’est le Seigneur qui était la personne centrale ; c’est à lui que furent adressées les paroles du Père depuis la nue, et c’est vers lui que furent tournés les cœurs des disciples : « Écoutez-le ! » (Luc 9).
Diversité (15 v. 39 à 41).
Nous avons vu jusqu’ici quelle erreur c’est d’admettre que l’état de notre corps dans la résurrection soit semblable à celui que nous possédons actuellement. Les versets 39 à 41 en développent des preuves en faisant appel aux différences importantes qu’on trouve dans le règne animal et dans le domaine matériel. Il nous est parlé d’abord du règne animal :
« Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons » (1 Corinthiens 15 v. 39).
Il n’y a pas de monotonie dans la création de Dieu, son œuvre est caractérisée par une variété extraordinaire dans tous les domaines. Où que nous regardions, nous en voyons la preuve. C’est déjà une raison pour laquelle l’idée que notre corps devrait avoir la même forme apparente en résurrection que dans notre vie actuelle, ne tient pas. Dieu est capable de refaire vivre notre corps mort sous une forme entièrement différente de celle d’aujourd’hui.
Ensuite, l’apôtre parle de quatre sortes de chair, et il est effectivement étonnant à quel point sont différentes la chair des hommes, celle du bétail, celle des oiseaux et celle des poissons : en structure, en qualité, en fonction, etc. Le chiffre quatre parle d’universalité, de sorte que les quatre sortes nommées incluent toutes les autres. Au reste, l’apôtre semble avoir eu en vue le récit de la création selon la Genèse (Genèse 1 v. 20 à 27), mais il inverse l’ordre, et qu’il élimine les grands monstres marins.
En tout cas, lors de création, Dieu ne s’est pas limité à une seule variété de chair. Ne pouvons-nous donc pas nous attendre à ce qu’il en soit pareil dans la résurrection ? Le corps humain que nous ensevelissons sera revivifié ; mais, bien qu’à cet égard il sera le même, il sera d’une sorte complètement différente dans la résurrection. Nous le voyons aussi dans l’exemple de notre Seigneur et Sauveur. Le corps qui avait été mis au tombeau était le même que celui qui a été revivifié.
Pourtant, le corps de résurrection du Seigneur était d’une autre nature, un corps qui n’était plus assujetti aux lois régulant ce monde : avec ce corps, Il a pu par exemple franchir des portes fermées. Pourtant, dans sa personne, le Seigneur Jésus est resté absolument le même, de sorte qu’il a pu demander à ses disciples étonnés : « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai » (Luc 24 v. 39).
Nous nous sommes malheureusement tellement habitués aux miracles de Dieu dans la création, que nous ne les percevons guère. Mais le fait qu’ils se déroulent journellement sous nos yeux ne diminue en rien leur grandeur. La multiplicité et la variété de la chair sont également tellement miraculeux.
Regardons simplement de plus près la chair des poissons. À l’inverse de l’homme, le poisson est construit par le Créateur tout-puissant, de façon qu’il ne puisse pas vivre hors de l’eau. L’eau est son élément vital, même sous les pressions énormes pesant sur son corps dans les profondeurs. Hors de l’eau, dans l’air, il meurt. Pour nous les hommes, c’est exactement l’inverse : Ce qui représente la ruine pour le poisson, est pour nous la condition de vie la plus importante : l’air.
Rappelons ici ce qu’un grand penseur disait une fois : « Si les poissons étaient des philosophes, s’ils étaient capables de réfléchir, je suis absolument sûr que tous les poissons philosophes jugeraient impossible pour une créature quelconque de pouvoir vivre hors de l’eau ! »
Ces philosophes ne ressemblent-ils pas beaucoup aux insensés dont nous avons déjà parlé, qui ne peuvent pas s’imaginer une vie en dehors de l’espace vital où nous vivons ? Mais s’il y a déjà sur cette terre de telles variétés, ne serait-ce que dans la chair des différents êtres vivants, est-il alors trop extraordinaire de croire qu’il y aura aussi de grandes différences entre les corps que Dieu a destinés pour le ciel, et ceux qu’Il a créés pour cette terre ?
« Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles ; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile » (15 v. 40 et 41).
Paul prend une cible plus lointaine en parlant de corps célestes et terrestres. L’analogie peut ne pas sauter autant aux yeux ici, et il ne l’approfondit pas. Néanmoins, il est remarquable comment il prend ses exemples de trois domaines qu’il dispose selon une ligne croissante.
D’abord, il ne parle que d’un grain nu (règne végétal). Ensuite, il passe aux différentes sortes de chair (règne animal). Enfin, il compare les corps célestes aux corps terrestres (domaine matériel).
Le terme « corps » doit être compris au sens général, désignant tout ce qui a une forme extérieure définie. Comme il y a des « corps célestes », ainsi, il y a aussi d’innombrables « corps terrestres ». L’expression « corps terrestres » ne désigne pas des corps humains, car ceux-ci relèvent du second domaine, celui du règne animal, mais elle désigne des corps matériels sur la terre, par exemple une montagne ou une chaîne montagneuse.
Si on garde à l’esprit cette division en trois domaines par Paul, on sera gardé de la fausse pensée que les « corps célestes » représentent les anges. Cette signification a souvent été soutenue, autrefois comme récemment. Or Paul ne compare absolument pas les corps les uns par rapport aux autres, car l’une de ces classes (les corps célestes) et la « gloire » qui s’y rattache, ne peuvent absolument pas être vues, ni même imaginées par nous ; tandis que l’autre classe, c’est-à-dire les corps terrestres et la gloire qui leur a été attribuée, peuvent être perçus par chacun de nous.
Non, les corps célestes sont le soleil, la lune et les étoiles. Ils ont leur propre gloire, comme les corps terrestres portent la gloire qui leur a été conférée par le Créateur. Cependant, les corps célestes brillent d’un éclat lumineux qui manque complètement aux corps terrestres. Ces derniers se distinguent plutôt par leur couleur et leur forme.
La gloire des corps célestes ne se différencie pas seulement fortement de celle des corps terrestres, mais entre eux, les corps célestes comme le soleil, la lune et les étoiles, sont aussi différents les uns des autres en gloire. Chaque étoile à une gloire différente d’une autre étoile.
Beaucoup ont cru ou croient que les différents degrés de gloire sont indiqués en vue des rachetés au ciel. Or il y aura de telles différences dans le royaume, comme l’Écriture sainte le montre par exemple dans la parabole des « dix mines » : « aie autorité sur dix villes… » : « Et toi, sois établi sur cinq villes » (Luc 19 v. 17 et 19).
Mais ce n’est pas ce dont notre verset parle ; il parle plutôt de la diversité qui caractérise toute la création de Dieu ; et il parle aussi du fait que Dieu confère la gloire comme Il veut, en pleine et libre souveraineté.
Ainsi, Dieu sait depuis longtemps ce qu’Il fera de nos corps, lorsqu’Il les appellera à sortir de leur tombe ; Il sait de quelle beauté et de quelle gloire Il les munira, selon son bon plaisir. Comme nous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, c’est justement là l’intention du Saint-Esprit dans notre passage : mettre en évidence le contraste entre l’état naturel de l’homme et l’état dans la résurrection.
La prochaine section (à partir du v. 42) qui est introduite par l’expression : « ainsi aussi est la résurrection des morts » le confirme.
Les livres de Christian Briem en Pdf
CSS Boutons Partager
➲ Articles à découvrir...

2. Un coup d'éclat de Dieu dans nos vies

1. Sanctification totale

51. La vie nouvelle
➲ REUNION SUR ZOOM
« Jésus-Christ est ce qu'il nous faut. Il a ce qu'il nous faut. Il sait ce que nous avons besoin de savoir, ce qu'il peut faire en nous, produisant en nous ce qui est agréable à ses yeux... »
- Aiden W.Tozer
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés