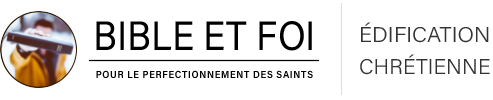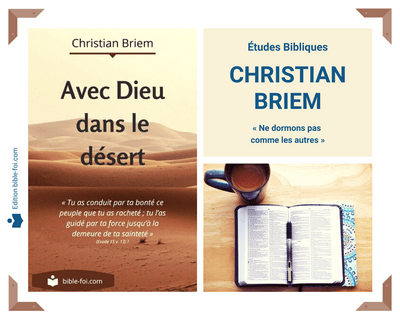
8. Chrétien et heureux ?
Chap: 7 - « Ces choses » - Le Seigneur ne veut pas nous décourager. Au contraire, dans les versets qui suivent, il nous donne quelques encouragements clairs et nous sentons bien que nous en avons besoin.
Comme nous l’avons vu, dans les versets 2 à 5 du chapitre 1, l’apôtre présente les caractères d’une vie de foi. Sept traits doivent résulter de la foi en Christ ou être « joints à notre foi » : la vertu (ou : détermination spirituelle), la connaissance, la tempérance (ou : maîtrise de soi), la patience, la piété, l’affection fraternelle et l’amour. Telles sont les choses pour la réalisation desquelles nous sommes exhortés à « apporter tout empressement ».
Au fur et à mesure que ces sept fruits de la vie divine ont été ainsi placés devant nous, nous avons certainement baissé plus d’une fois la tête avec confusion devant le Seigneur, reconnaissant combien peu nous les manifestons. En effet, ces versets nous offrent de nombreux motifs de nous examiner et de nous juger nous-mêmes. Prenons le temps de le faire, bien-aimés. Mais le Seigneur ne veut pas nous décourager. Au contraire, dans les versets qui suivent, il nous donne quelques encouragements clairs et nous sentons bien que nous en avons besoin.
Les caractères mentionnés revêtent une telle importance pour l’écrivain sacré que, depuis le verset 8, il ne revient pas moins de cinq fois sur ce qu’il appelle « ces choses » (v. 8, 9, 10, 12 et 15). Nous pouvons donc difficilement surestimer leur valeur. Nous ne serons pas non plus surpris que l’apôtre montre maintenant quels résultats produit le fait de posséder ou non ces choses. Dans les deux cas, il y a des résultats ou des conséquences, et tel est le point qui va être considéré maintenant.
Si « ces choses » sont en vous.
L’apôtre poursuit le cours de la pensée en l’introduisant par un « car » : « Car, si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ » (v. 8).
Nous aurons remarqué qu’ici, de nouveau, l’apôtre parle de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les déclarations de ce verset sont donc en relation avec la connaissance de notre Seigneur, c’est-à-dire avec le discernement de sa personne. Tout en découle.
Au verset 2, Pierre a commencé par cela : la grâce et la paix sont multipliées « dans la connaissance ». Elle est aussi le moyen dont Dieu se sert pour nous donner tout ce qui regarde la vie et la piété : « par la connaissance » (v. 3). Puis la connaissance fait encore partie des fruits de la nouvelle vie (v. 5). Et maintenant, au verset 8, tout aboutit de nouveau à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ : « pour ce qui regarde la connaissance », ou « en vue de la connaissance ».
Cette dernière traduction semble mieux correspondre à la pensée du passage : il s’agit de ne pas être oisifs ni stériles, en vue de la connaissance, ou pour la connaissance. Ainsi la connaissance du Seigneur Jésus est le commencement, la continuation et le but de la vie chrétienne. Paul parle de ce but en ces termes : « … Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances » (Philippiens 3 v. 10). Tout le bonheur du chrétien, chacune de ses bénédictions, sont liés à la connaissance de son Seigneur. Sans elle, il n’y a ni croissance ni fruit pour Dieu.
Il convient ici de considérer deux points. Le premier est le suivant : seulement si ces choses sont en nous, et dans une mesure croissante, nous pourrons traverser intact un monde dont Satan est le dieu et le chef, dans lequel les convoitises d’une part, et, d’autre part, l’opposition ouverte s’unissent afin de nous rendre oisifs et stériles pour ce qui regarde la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ensuite, et c’est le second aspect, il nous faut garder constamment le Seigneur Jésus devant les yeux et marcher dans la communion avec lui. Si nous apprenons jour après jour de lui, dans sa communion, nous ne pourrons pas être oisifs ni stériles pour ce qui concerne le discernement de sa personne bénie.
D’un côté, comme nous l’avons vu, dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur, nous trouvons la force pratique (v. 2 et 3). Mais, d’un autre côté, si ces choses sont en nous, nous entrerons aussi plus profondément dans la connaissance de Christ. Aussi lisons-nous ici : « pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde (ou : pour, en vue de) la connaissance de notre Seigneur ». Nous trouvons aussi cet aspect en Colossiens 3, où il est dit du nouvel homme qu’il est renouvelé en connaissance selon l’image de celui qui l’a créé (v. 10).
Le but de toutes les interventions de Dieu à notre égard est de nous amener à mieux connaître Christ. Pierre savait que tout ce qui ne conduit pas à une connaissance plus profonde du Seigneur Jésus, signifie une perte pour le croyant. Nous sommes rendus moralement capables de traverser ce monde dans la mesure selon laquelle nous connaissons Christ.
Arrêtons-nous encore un moment sur les mots oisifs et stériles ! Dieu ne veut pas d’ouvriers oisifs : « Va vers la fourmi, paresseux… » (Proverbes 6 v. 6) ; et s’il a fait de nous des sarments demeurant dans le cep, c’est afin que nous portions du fruit. Le Seigneur a dit : « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit » (Jean 15 v. 8).
Mais à lui seul appartient de juger si quelqu’un porte du fruit ou est oisif et stérile. Quelle pensée réconfortante. Quand les Égyptiens privaient les Israélites de la paille nécessaire pour faire les briques, leur imposant un service encore plus dur afin de leur faire abandonner la pensée de célébrer une fête au Dieu d’Israël dans le désert, les Fils d’Israël durent entendre de la bouche du Pharaon ces paroles :
« Vous êtes paresseux, paresseux ; c’est pourquoi vous dites : Allons et sacrifions à l’Éternel » (Exode 5 v. 17). Lorsque Marie répandit le parfum de grand prix sur son Seigneur, il se trouva même parmi les disciples de Jésus certains qui qualifièrent son acte de « gaspillage » (Matthieu 26 v. 8).
Le monde ne comprend rien à la valeur de la vraie adoration, et il est humiliant que des chrétiens non spirituels n’en aient en général pas non plus l’intelligence. Ils considèrent le fait de s’occuper de la personne de Christ comme secondaire, comme une perte de temps. En tout cas, leur attitude conduit à cette conclusion. Mais le croyant qui progresse dans le chemin et dans la connaissance du Seigneur n’est ni oisif ni stérile aux yeux de Dieu. Et au jour de Christ, le dépouillement, non pas le succès, sera récompensée (2 Timothée 2 v. 5 ; Luc 19 v. 17).
Si « ces choses » font défaut.
« Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d’autrefois » (v. 9).
Lorsqu’il a parlé de l’aspect positif (« ces choses » sont présentes), l’apôtre s’est servi du pluriel : « en vous ». Mais maintenant, en relation avec le côté négatif (« ces choses » ne se trouvent pas), il utilise le singulier : « celui en qui ». Il passe également du « vous » personnel au « celui » impersonnel. Nous pouvons en déduire qu’il illustre maintenant un état anormal pour un croyant, qui peut néanmoins très bien se rencontrer dans des cas individuels.
À cet égard, les expressions employées dans l’Écriture sont très encourageantes ; car d’une manière générale, on y trouve la description de ce qui est normal pour un chrétien. Concernant le verset 14 de Romains 8 : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu », quelqu’un a posé une fois à l’auteur de ces lignes la question suivante : « Qu’en est-il donc de ceux qui ne se laissent pas conduire par l’Esprit : Dieu ne les considère-t-il alors pas comme ses Fils ? »
La réponse a consisté dans le principe qui vient d’être mentionné : Dieu montre ce qui est typique et normal pour ses enfants. Mais il se voit parfois contraint, pour nous avertir, de présenter ce qui est maladif et anormal. Tel est précisément le cas dans notre verset.
Il est donc possible qu’un enfant de Dieu ne vive pas dans ces choses. Qu’en résulte-t-il ? Avant d’aborder cette question, soulignons encore le fort contraste entre les versets 8 et 9. L’auteur ne connaît que ces deux états : « Ces choses » sont présentes ou elles ne le sont pas. Nous pouvons nous demander : Dans la pratique, n’existe-t-il pas de degrés ? Évidemment, il s’en trouve. Mais l’Écriture ne place pas devant nous la « gamme des gris », avec tous les états intermédiaires possibles.
Nous devons apprendre, et tel est bien le sens de cette manière de présenter, que dans les choses de Dieu, il n’y a pas d’arrêt : ne pas avancer signifie reculer. Ne pas croître, c’est régresser. À cet égard, nous sommes comme la lune : soit nous croissons, soit nous diminuons. Il n’existe pas de milieu. En fait, il est impossible de vivre dans ces choses sans manifester les fruits correspondants, de même qu’il n’est pas possible de se tenir au soleil sans réfléchir ses rayons. Si nous ne les reflétons pas, c’est que nous avons quitté le soleil.
L’aveuglement spirituel.
Ne pas marcher dans la communion avec le Seigneur conduit à l’aveuglement spirituel. Placez devant un tel chrétien les vérités glorieuses de la parole de Dieu, il ne les voit pas. De ce fait, son cœur reste froid et insensible. Il est déjà bien assez triste que le dieu de ce siècle ait aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l’Évangile de la gloire du Christ qui est l’image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux (2 Corinthiens 4 v. 4).
Mais il est encore infiniment plus triste qu’un enfant de Dieu, un croyant qui, par principe, peut « voir » (v. 6), ignore la gloire de la personne du Seigneur et la vérité de Dieu.
Peut-être trouve-t-on encore, dans une certaine mesure, une compréhension rationnelle des vérités divines, mais le cœur ne saisit pas véritablement leur beauté et leur valeur.
Or, pour pouvoir comprendre les bénédictions infinies du christianisme, il est absolument nécessaire d’avoir les yeux de notre cœur éclairés par l’Esprit de Dieu (Éphésiens 1 v. 18). Cela demeure toujours vrai et cela vaut pour tout enfant de Dieu. Mais, dans notre verset, il est question d’un aveuglement résultant de pensées mondaines. Nous avons déjà relevé précédemment que Dieu n’accorde pas de lumière à celui qui n’est pas disposé à marcher en elle.
L’Ancien Testament nous donne plus d’un exemple sérieux en relation avec notre sujet. Après son péché avec Bath-Shéba, David n’a-t-il pas été aveugle quant à lui-même et à la vérité de Dieu ? Il ne comprit, ne « vit » qu’il était personnellement concerné qu’au moment où le prophète Nathan lui dit sans détours : « Tu es cet homme ! » (2 Samuel 12 v. 7).
Balaam ne demeura-t-il pas aussi aveugle à toute sa folie ? Il voyait moins que l’ânesse qu’il montait (Nombres 22 v. 23). Samson se laissa aller à la convoitise de la chair et perdit non seulement sa force, mais aussi la vue. Les Philistins lui crevèrent les yeux. Il ne savait pas que l’Éternel s’était retiré de lui (Juges 16 v. 20 et 21). Plus tard dans l’histoire d’Israël, Dieu doit constater à l’égard de son peuple apostat : « Éphraïm s’est mêlé avec les peuples ; Éphraïm est un gâteau qu’on n’a pas retourné. Des étrangers ont consumé sa force, et il ne le sait pas. Des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui, et il ne le sait pas » (Osée 7 v. 8 et 9). Une telle ignorance est de l’aveuglement spirituel.
Après le qualificatif « aveugle », Pierre ajoute « et ne voit pas loin ».
Pense-t-il à une sorte de premier degré de cécité, comme cela peut se rencontrer dans le domaine naturel ? Il ne semble pas. L’aveuglement de celui en qui « ces choses » ne se trouvent pas a plutôt son origine dans sa vue limitée : parce qu’il ne voit pas loin, il est aveugle.
Deux faits viennent appuyer cette interprétation. Premièrement, l’ordre des expressions : aveugle, il ne voit pas loin. Si l’apôtre avait voulu montrer une évolution logique ou dans le temps, il aurait dû dire d’abord : « il ne voit pas loin ». Deuxièmement, traduit littéralement, le texte original de notre verset se présente de la manière suivante : « celui-ci… est aveugle, ne voyant pas loin ». Un état permanent de myopie constitue l’aveuglement. Nous en verrons la confirmation plus bas.
Si un enfant de Dieu néglige la communion avec Dieu, celle-ci est remplacée par l’amour du monde dans le cœur (comp. 1 Jean 2 v. 15 et 16). Mais cet amour du monde agit comme un poison insidieux et trouble inévitablement la perception spirituelle. La capacité de voir « loin » disparaît. Au lieu d’être fixé en haut, le regard s’abaisse, il se détourne des choses célestes lointaines, pour se poser sur ce qui est proche, terrestre, mondain. Arrivé à ce point, on est effectivement aveugle pour les choses célestes. On ne les voit plus, parce que le regard ne se porte « pas loin ».
Quelle évolution bouleversante. En général, elle se manifeste d’abord par le fait qu’on trouve toujours moins de temps pour la prière et la lecture de la parole de Dieu. La fréquentation des réunions perd aussi de son importance. Lorsque Christ n’est plus l’objet du cœur, des prétendus devoirs, même les occupations nécessaires liées aux intérêts terrestres, remplacent petit à petit la vie spirituelle, jusqu’au moment où la pauvreté remplit l’âme.
Ah ! posons-nous tous la question : nos propres regards ne sont-ils pas trop souvent dirigés en bas, attirés par ce qui est proche, par la sphère terrestre ? Nous pouvons être assurés d’une chose : une telle direction du regard ne nous conduira jamais au vrai bonheur.
Assurément, nous devons nous acquitter de nos devoirs terrestres. Il ne s’agit pas de cela ici. C’est exclusivement une question de cœur : Où sont dirigés les regards de notre cœur ? Même lorsque les exigences des devoirs terrestres sont très fortes, le regard peut être fixé avec foi en haut sur le Seigneur. Il ne le laissera pas sans réponse et remplira le cœur d’un bonheur profond. Et n’est-ce pas un privilège inappréciable de pouvoir regarder « loin » ? Seule la parole de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, nous permet d’avoir ce regard, soit dit en passant.
Les livres de Christian Briem en Pdf
➲ Articles à découvrir...
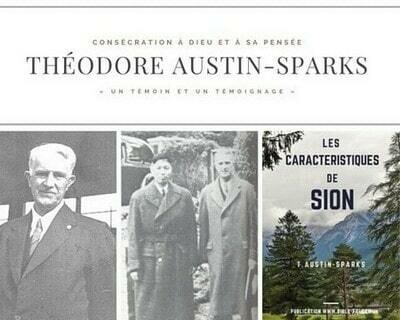
L'importance d'être dans l'Esprit

9. L’Esprit du Christ

4. Éthique chrétienne
➲ REUNION SUR ZOOM
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés