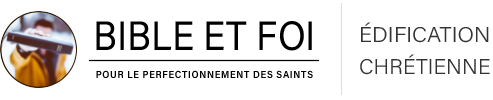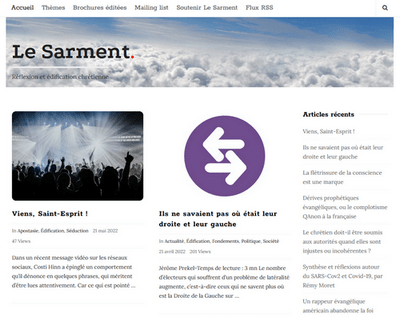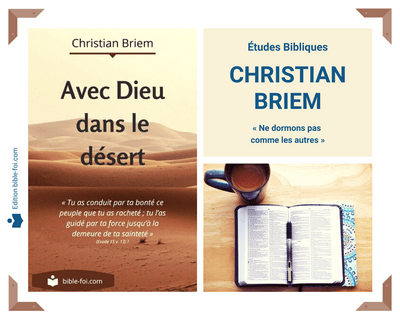
15.Je vis le ciel ouvert
Chap: 6 - L’état éternel - Que de fois, j’ai médité sur la vérité de cette courte expression. La pensée de l’éternité est effectivement si prodigieuse qu’elle pourrait faire éclater notre faible cœur.
Avec les huit premiers versets du ch. 21 de l’Apocalypse, nous arrivons à une section qui dépeint l’éternité. Il existe un vieux cantique qui commence avec ces paroles fortes et impressionnantes : « Ô éternité, mot qui éclate comme le tonnerre ! » Ce que l’« éternité » exprime réellement n’est pas concevable pour l’esprit humain. Qu’est-ce que renferment la « perdition éternelle », la « félicité éternelle » ?
Les nouveaux cieux et la nouvelle terre.
La portée et les transformations que ce mot d’« éternité » impliquent, sont si incommensurables qu’aucun mortel ne peut s’en faire la moindre idée. C’est bien la raison pour laquelle l’Écriture Sainte ne nous en révèle que très peu de chose. Des indications directes sur l’état éternel figurent en 1 Corinthiens 15 v. 24 à 28 ; Éphésiens 3 v. 21, et dans le passage déjà cité de 2 Pierre 3 v. 13. L’expression « son repos » dans sa pleine signification, le repos de Dieu d’Hébreux 3 et 4, se rapporte indiscutablement à l’état éternel.
La description la plus étendue et la plus détaillée de ce que nous appelons l’« état éternel », figure dans les huit premiers versets d’Apocalypse 21. Ces versets constituent la dernière partie de cette section du livre, elle trace chronologiquement les événements des temps de la fin, de manière concise et forte.
Nous nous rappelons que cette section commence au ch. 19 v.11, avec la descente de Christ depuis les cieux ouverts. Finalement, après le règne millénaire, nous avons été occupés de la dernière bataille autour de la « cité bien-aimée », du sort final du diable jeté dans l’étang de feu, de la résurrection des morts et du jugement définitif de ceux-ci devant le grand trône blanc.
La résurrection de tous les impies fait encore partie de ce qui est « dans le temps », de sorte que leur jugement devant le grand trône blanc a lieu déjà au seuil de l’éternité. Ce qui nous est présenté dans les huit premiers versets du ch. 21 se rattache donc directement à la fin du ch. 20.
Ainsi donc, la présente division en chapitres est plutôt malheureuse et induit en erreur. Si le ch. 21 avait commencé au v. 9, la structure du texte apparaitrait bien mieux. Tout au début de cet ouvrage, j’ai déjà indiqué qu’après la description de l’état éternel des huit premiers versets du ch. 21, il nous est donné une sorte de rétrospective sur le temps du royaume qui a précédé.
Cette section continue jusqu’au ch. 22 v.5, et décrit l’assemblée dans la gloire, dans ses relations avec la terre pendant le règne millénaire. Nous allons voir qu’il en est bien ainsi en considérant les détails, et en examinant avec l’aide de Dieu les raisons d’une telle rétrospective. Mais, pour le moment, il est important de retenir au moins ceci : tout ce qui est rapporté à partir du ch. 21 v.9, concerne des affaires antérieures à ce qui est décrit dans les versets 1 à 8.
Si nous désirons maintenant nous faire une idée de ce que l’Écriture Sainte présente dans ce passage, au sujet de l’état éternel, nous ne pouvons que demander à Dieu la grâce qu’Il veuille nous accorder le respect et la sobriété nécessaires, mais aussi un cœur large. Que d’un côté, Il veuille nous préserver d’aller au-delà de ce qui est révélé ; mais que d’un autre côté, Il veuille nous aider à sonder avec zèle et à comprendre ce qu’il lui a plu de révéler sur ce sujet si élevé.
Dans quelle mesure le ciel et la terre sont-ils nouveaux ?
C’est un huitième « Et je vis », qui introduit la dernière scène de cette série de visions : « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés ; et la mer n’est plus » (21 v. 1).
Nous avons vu au chapitre précédent, comment la terre et le ciel s’étaient « enfuis » de devant la face de celui qui était assis sur le trône. C’est ce à quoi il est fait allusion ici, quand il est dit que le premier ciel et la première terre « s’en étaient allés ». On a déjà remarqué que cela ne signifie pas leur « anéantissement ». Lorsqu’en Hébreux 1 v. 11 et 12, Dieu parle de la terre et des cieux visibles qui périront, (il ne s’agit que de ceux-ci, et non pas du lieu d’habitation éternelle de Dieu), Il les compare à un vieil habit que le Fils, le Seigneur Jésus, pliera comme un vêtement.
Or « plier » n’est pas anéantir. Et c’est pourquoi il est aussi ajouté : « Et ils seront changés ». En accord avec cela, l’apôtre Paul écrit aux Corinthiens : « Car la figure* de ce monde passe » (1 Corinthiens 7 v. 31), c’est-à-dire la forme sous laquelle nous le voyons aujourd’hui.
* Le mot utilisé ici pour « figure » (en grec « schéma ») exprime la forme apparente « extérieure », spécifique d’une chose ou d’une personne, plus précisément son aspect extérieur. Pour ce qui concerne le nouveau ciel et la nouvelle terre : de même que notre corps de résurrection sera formé à partir de l’ancien (1 Corinthiens 15 v. 51), et de même qu’un vase d’argile gâté est utilisé pour en faire un nouveau (Jérémie 18 v. 4), de la même manière, le nouveau ciel et la nouvelle terre seront formés à partir des éléments de l’ancienne création.
À ce propos, nous ne devons pas penser au « ciel » comme étant le « firmament », l’univers tout entier. Bien des choses font penser qu’il ne s’agit que du ciel atmosphérique, le ciel qui est en relation spéciale avec la terre en tant que résultat du second jour de la création (Genèse 1 v. 6 à 8). Selon les pensées de Dieu, il constitue un système lié à la terre.
Dans ce système, Satan, le « chef de l’autorité de l’air » (Éphésiens 2 v. 2), a accès depuis toujours (Job 1 v. 7 ; 2 v. 2) et jusqu’à aujourd’hui (Éphésiens 6 v. 12). C’est sa sphère d’influence.
Dieu fera toutes choses nouvelles. Tout sortira à neuf de la main de celui qui est assis sur le trône (21 v. 5). Pour cela, il faut qu’à côté de changements moraux, interviennent aussi des transformations sous la forme de bouleversements physiques d’une ampleur inimaginable. Ils amèneront à neuf la terre et le ciel qui s’y rattache, mais ils ne seront pas nouveaux dans le sens d’une terre entièrement autre, et d’un ciel entièrement autre. « Nouveau », ou « à neuf », désignent manifestement un autre état de la terre et du ciel. Cela est souligné par le terme que le Saint-Esprit utilise pour « nouveau ».
La langue grecque possède plusieurs mots qui expriment l’idée de quelque chose de nouveau. Or ici, c’est le mot « kainos » qui est utilisé ; il signifie « nouveau » dans le sens de « jeune, frais, non encore utilisé, inconnu, inhabituel », non pas nouveau chronologiquement, mais nouveau dans son aspect extérieur, sa qualité, son caractère. Or c’est justement ce qui semble être ici la pensée, quand il est parlé d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre. Il y a lieu aussi de remarquer que le contraste est entre le « nouveau » et « premier » ciel, entre « nouvelle » et la « première » terre.
Le prophète Ésaïe avait été le premier à parler sous la direction de Dieu, d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre, en donnant au mot « nouveau » le même sens qu’ici en Apocalypse : « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur » (Ésaïe 65 v. 17). La version des Septante, traduction grecque de l’Ancien Testament, utilise donc ici aussi le mot « kainos » (et en Ésaïe 66 v. 22).
Retenons toutefois que ces passages ne décrivent pas encore l’état éternel. Bien que les mêmes expressions « nouveau ciel » et « nouvelle terre » soient utilisées, cependant ces expressions ne peuvent guère signifier davantage qu’un renouveau du ciel et de la terre sur le plan moral lors du règne millénaire. Non seulement le ciel sera délivré de la présence et de la puissance de Satan (Apocalypse 12 v. 10 et suiv. ; Éphésiens 6 v. 12), mais la terre aussi, et même toute la création, sera affranchie de la servitude de la corruption, et libérée des conséquences de la malédiction (Romains 8 v. 21 ; Psaume 67 et 72).
Ce sera, en vérité, un état béni et merveilleux pour le ciel et pour la terre. Cependant, ce n’est pas encore l’état éternel. Car, malgré toute la bénédiction de ce temps de règne de paix de Christ, la mort subsistera (Ésaïe 65 v. 20). Il y aura aussi des « îles » et des « bateaux » dans ce temps du royaume (Ésaïe 60 v. 9), ce qui présuppose indiscutablement l’existence de la mer. En Apocalypse 21, en revanche, il est expressément établi que « la mer n’est plus » (Apocalypse 21 v. 1).
Cette déclaration peut sans doute être interprétée de différentes manières. Souvenons-nous tout d’abord de la signification symbolique de la « mer ». Elle préfigure les masses des peuples en tumulte, qui se soustraient au contrôle du gouvernement de Dieu (Apocalypse 13 v. 1 ; Daniel 7 v. 2 et 3 ; Ésaïe 57 v. 20). La « mer » comporte l’idée de ce qui, en soi, est vague, incertain, instable, indocile, quelque chose qui ne se soumet à aucun ordre divin ou humain.
Si nous ne perdons pas de vue ces différents points de vue, combien ces mots apparaissent lourds de sens : « Et la mer n’est plus » ! Sur la nouvelle terre, et en contraste complet avec le jour actuel, il n’y aura plus rien de vague ou d’incertain, d’instable ou d’incontrôlé, plus rien qui n’échappe au contrôle de Dieu. Tout sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec sa volonté.
Ce n’est qu’alors, me semble-t-il, que sera pleinement accomplie la prière de si vaste portée qu’on appelle le « Notre Père » : « Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre » (Matthieu 6 v. 10).
Parmi la multitude des habitants du ciel et de la terre, il n’y en aura pas un seul qui ne sera pas conforme en tout à la volonté de Dieu. « Temps béni ! » voudrait-on proclamer, si tant est que l’on puisse encore l’appeler « temps », car il s’agit de l’éternité. Le temps sera déjà changé en l’éternel jour de Dieu (2 Pierre 3 v. 12).
Mais la mer était aussi l’élément de séparation entre les continents. Nous apprenons donc ici qu’il n’y aura plus rien de ce qui pourrait séparer les hommes les uns des autres. Quelle heureuse pensée. Rien n’empêchera plus les habitants de la terre d’avoir des relations paisibles entre eux et d’avoir communion les uns avec les autres. Dieu ôtera pour cela toute barrière.
Mais il me semble que la « mer », ici, peut être aussi comprise de façon tout à fait littérale. Cette façon de voir est aussi étayée par le fait que, dans la section qui nous occupe (19 v. 11 à 21 v. 8), le langage symbolique passe à l’arrière-plan, et que le mot « mer » est utilisé, en fait, dans son sens matériel : « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle » (20 v. 13).
Or si la mer, et à cause d’elle l’atmosphère que nous connaissons, ne subsistent pas, alors aucune vie organique ne peut exister. Après des changements physiques considérables, il y aura une nouvelle vie sur la nouvelle terre, une autre vie, une vie d’un ordre plus élevé. Les hommes rachetés et transmués vivront sur cette terre, comme nous allons encore le voir tout de suite.
« La mer n’est plus », bienheureuse pensée. Cet état d’imperfection caractérisé par la mer, aura sa fin pour toujours. Ce qui séparait les hommes, ce par quoi l’ordre (symbolisé par la terre) était dévasté, gaspillé et dévoré, n’existera plus. Au lieu de cela, tout sera interconnecté, certain et stable, éternellement assuré. Sur la nouvelle terre, les hommes habiteront dans la paix et le bonheur. Tout sera parfait et subsistera ainsi éternellement à la gloire de Dieu. Merveilleuse perspective !
La nouvelle Jérusalem (21 v. 2).
Maintenant un nouvel objet capte le regard du voyant : « Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari » (Apocalypse 21 v. 2).
Lorsqu’il s’agit du nouveau ciel et de la nouvelle terre, il n’est donné aucune description de leur grandeur, de leur aspect ou de leur constitution. Il suffit qu’il nous soit communiqué qu’ils sont entièrement nouveaux et qu’ils forment la plate-forme appropriée et immuable pour le déploiement éternel de la gloire de Dieu. Mais quant à ce que Jean voit maintenant, il en va autrement. Il voit une ville descendant du ciel, et d’elle il nous est rapporté cinq points qui nous en délivrent une image globale :
- Elle est sainte.
- Dans son caractère en tant que Jérusalem, elle est nouvelle.
- Sa provenance et son caractère sont célestes.
- Son origine est divine.
- Elle est préparée comme une épouse ornée pour son mari.
Il suffit d’un coup d’œil rapide sur ces cinq caractères de la ville, pour nous donner l’impression que, derrière l’image de la ville, se cache l’assemblée de Dieu (l’Église), la vraie Église dans la gloire. En allant plus avant dans la considération de la ville, cette impression devient une certitude, qui se renforce encore quand nous saisissons ce qui nous est dit de la ville dans le paragraphe suivant. Là, on revient en arrière et on se situe à l’époque du règne de mille ans, et il est alors significatif que la « sainte cité, Jérusalem » soit mise comme l’égale de « l’épouse, la femme de l’Agneau ».
Babylone, la fausse église du temps de la fin est appelée « la grande ville » (18 v. 10, 16 et 18). Or la vraie Église forme la « sainte cité ». Tout en elle est en harmonie avec la nature de Dieu (Éphésiens 1 v. 4) et avec toute la scène où elle se meut. La désignation de « sainte cité » apparaît trois fois dans l’Apocalypse (11 v. 2 ; 21 v. 2 ; 22 v. 19).
Tandis que le premier passage se rapporte littéralement à la Jérusalem terrestre, les deux autres passages montrent le caractère saint de l’Église glorifiée. Il reste à remarquer que l’image d’une ville (= cité), parle d’un système bien ordonné, et dans ce cas créé par Dieu, à l’intérieur duquel il y a une communion et on jouit de relations, et où il y a de la place pour habiter et de la place pour rester. Combien cette pensée aussi nous réjouit. Dans le Nouveau Testament, l’Assemblée n’est jamais auparavant comparée à une ville : on ne trouve cela qu’à la fin du livre de l’Apocalypse.
Mais cette ville, l’Assemblée glorifiée, est aussi appelée la nouvelle Jérusalem. Déjà dans ses promesses au vainqueur de Philadelphie, le Seigneur montre cette scène de l’éternité, et parle de « la cité de mon Dieu », la « nouvelle Jérusalem qui descend d’auprès de mon Dieu » (3 v. 12). Cette désignation de « nouvelle Jérusalem » souligne certainement le contraste avec l’ancienne Jérusalem, la ville au sens littéral, liée au peuple de Dieu.
Au chapitre 20, nous trouvons en dernier le titre gracieux de « la cité bien-aimée » (v. 9). Cette ville terrestre de Jérusalem, a cependant à ce moment-là rempli son rôle et a cessé d’exister. La « Jérusalem d’en haut, qui est notre mère » (Galates 4 v. 26), elle qui porte alors le nom de « nouvelle Jérusalem », demeure éternellement. Il vaut la peine de remarquer, alors, que l’Assemblée au temps du règne de Christ de mille ans, est décrite comme « la cité sainte, Jérusalem » (21 v. 10) ; elle ne porte le qualificatif de nouveau qu’en rapport avec l’état éternel. « Voici, je fais toutes choses nouvelles » est la parole de celui qui est assis sur le trône (v. 5). Le fait que la ville descende du ciel montre que le lieu d’origine, le lieu qui lui est propre est le ciel.
Là où Dieu habite, c’est là qu’elle est chez elle. Elle porte ainsi un caractère absolument céleste. En principe, c’est déjà vrai pour les rachetés du temps de la grâce. Dieu les a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes (Éphésiens 1 v. 3). Et Il les a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes (Éphésiens 2 v. 6). Combien peu nous réalisons et nous goûtons que c’est là notre position.
« Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes » (1 Corinthiens 15 v. 48). Cependant, quel changement ce sera pour nous, quand nous pourrons jouir de manière parfaite, des bénédictions qui nous ont été accordées en Christ, dans la gloire du ciel et dans la présence immédiate de Dieu.
Le qualificatif « de Dieu » montre que l’assemblée qui est alors dans la gloire est d’origine divine. C’est dans son cœur que l’on trouve tout ce que l’Assemblée est et tout ce dont elle jouit. Tout provient de Christ. L’Assemblée est l’œuvre de ses mains, sa création la plus élevée. Cela ne nous touche-t-il pas profondément quand nous pensons au prix d’achat, infiniment élevé, qu’Il a dû payer pour elle : « Il l’a acquise au prix du sang de son propre Fils » (Actes 20 v. 28).
Mais voilà que soudain, l’image de la ville se change en celui d’une épouse : « préparée comme une épouse ornée pour son mari ». Le symbole d’une ville ne suffit plus quand il s’agit de représenter l’affection du Seigneur pour son Assemblée. Mille ans se sont écoulés depuis les noces de l’Agneau (19 v. 7 et 8), et il est dit pourtant « sa femme s’est préparée ».
Entre temps, le ciel et la terre auront été dissous, le temps et le caractère passager des choses auront fait place à l’éternité et à la stabilité absolue. Mais les affections entre l’époux et l’épouse et réciproquement, sont aussi fraîches et lumineuses qu’au commencement. Après mille ans de gloire et de bénédiction inimaginables, l’assemblée sera encore vue comme une épouse ornée pour son mari. Elle n’a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté pour le Seigneur Jésus.
Dès le début, Il a vu l’assemblée dans sa beauté, et à cause d’elle Il a tout abandonné, tout ce qu’Il avait, pour posséder cette perle (Matthieu 13 v. 45 et 46). Oui, Il a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle. Cela a été l’expression la plus haute de son amour pour elle. Après qu’Il l’a acquise pour lui, Il l’a soignée et purifiée dans son amour infatigable pendant tout le temps de son existence sur la terre.
Elle doit lui correspondre moralement déjà sur la terre le plus largement possible. Mais une troisième preuve merveilleuse de son amour a été qu’Il l’a prise auprès de lui et qu’Il se l’est présentée, glorieuse, « afin qu’elle n’ait plus ni tache, ni ride ni rien de semblable, mais qu’elle fut sainte et irréprochable » (Éphésiens 5 v. 25 à 27). Depuis lors, elle séjourne auprès de lui dans la gloire, et Il se rassasie de contempler son épouse glorifiée, pour laquelle Il a été en agonie autrefois sur la croix, environné de ténèbres.
Oui, son amour est aussi incompréhensible que lui-même. Il l’était hier, il l’est aujourd’hui, et il le restera le même dans toute l’éternité. Les relations intimes entre Christ et l’Assemblée (l’Église), représentées par la relation entre l’époux et l’épouse, seront immuables éternellement, et garderont toujours toute leur fraîcheur.
Bien que l’assemblée soit la femme de l’Agneau, elle est et demeure l’épouse, terme spécifique pour le jour du mariage. Ce sera déjà visible durant le règne de mille ans (21 v. 9), et il en sera et restera ainsi dans l’état éternel. L’expression « préparée comme une épouse ornée pour son mari », en est une preuve supplémentaire.
Qui peut mesurer l’amour de Christ et la grâce de Dieu qui nous seront donnés éternellement ? Certainement, Dieu montrera dans les siècles à venir (c’est-à-dire dans l’éternité) les richesses insondables de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus (Éphésiens 2 v. 7).
Le tabernacle de Dieu avec les hommes (21 v. 3).
Une grande voix venant du ciel attire maintenant l’attention du voyant : « Et j’ouïs une grande voix venant du ciel, disant : Voici, l’habitation (litt. : le tabernacle) de Dieu est avec les hommes, et Il habitera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu » (21 v. 3). Nous désirons considérer la richesse des pensées contenues dans ce verset sous cinq aspects, que l’on peut à peu près ramener aux questions suivantes :
- Que faut-il comprendre par l’image de l’« habitation (ou : le tabernacle) de Dieu » ?
- Qui sont les « hommes » sur la nouvelle terre ?
- Pourquoi n’est-il plus fait mention de l’« Agneau » ?
- Pourquoi est-il parlé de l’« habitation » ou « tabernacle », et non d’un « temple » ?
- En quoi consistent les relations des rachetés avec Dieu, dans la nouvelle création ?
Bien sûr, toutes ces questions complexes se recouvrent partiellement. Nous désirons cependant les distinguer autant que possible, et les considérer successivement. Le premier aspect concerne l’« habitation ou tabernacle » de Dieu.
Qui constitue l’habitation (ou : tabernacle) de Dieu ?
Beaucoup de pensées ont été émises et écrites sur ce qu’il faut comprendre par l’image du « tabernacle de Dieu ». Il faut dire que des conséquences d’une vaste portée dépendent de la réponse apportée. Cependant, la réponse à cette question ne présente guère de difficulté, si nous considérons le lien qui relie le v. 3 au verset précédent.
Le voyant voit la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Dieu. Et tandis qu’il suit ce phénomène, il entend une grande voix venant du ciel et parlant du tabernacle de Dieu. Le plus naturel n’est-il pas de considérer que la voix parle de la même chose que ce que le voyant a regardé ? Il n’y a pas de doute que le tabernacle ou habitation de Dieu est la même chose que la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, c’est-à-dire l’Assemblée de Dieu dans la gloire.
Le « tabernacle de Dieu » est un symbole de l’habitation de Dieu. Plusieurs passages des épîtres du Nouveau Testament parlent de l’Assemblée durant la dispensation de la grâce comme étant la « maison » et le « temple de Dieu ». Prenons l’un des passages les plus importants et les plus complets sur le sujet, spécialement important pour nous, du fait que sont décrites les bénédictions de ceux, qui, dans le temps de la grâce, sont devenus des croyants d’entre les nations et qui ont été ajoutés à l’Assemblée :
« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit » (Éphésiens 2 v. 19 à 22).
Voilà donc ce qu’avait été son Assemblée, lorsqu’elle était encore sur la terre : une habitation de Dieu par l’Esprit. Et cette habitation croissait continuellement, et elle croissait pour être un temple saint dans le Seigneur. Cependant, la croissance de l’édifice s’était achevée avec l’enlèvement des croyants, et dans l’état éternel cet édifice se présente maintenant comme le tabernacle (ou : l’habitation) de Dieu, qui descend du ciel sur la terre nouvelle. Combien cela est magnifique !
Dieu demeurait ainsi, par son Esprit, dans cette habitation quand elle avait encore sa place sur la terre. Et dans l’état éternel, rien n’est changé en principe à cet égard : elle est éternellement le lieu direct d’habitation de Dieu.
Le fait que l’habitation de Dieu vienne alors sur la terre va encore nous occuper. Pour le moment, il suffit de reconnaître que cela forme un contraste certain avec le temps du règne millénaire. Car alors, en effet, la sainte cité, Jérusalem, descendra aussi du ciel d’auprès de Dieu, mais elle ne parait pas arriver directement sur la terre ; elle paraît rester au-dessus de la terre (Apocalypse 21 v. 9 et suivants).
Les livres de Christian Briem en Pdf
➲ Articles à découvrir...

18. Les deux Alliances

8.Je vis le ciel ouvert
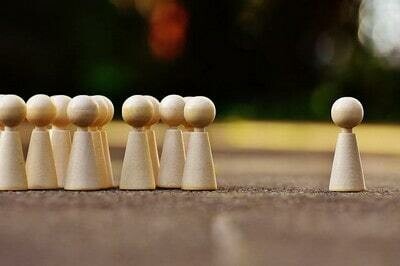
Le caractère central de la croix.1
➲ REUNION SUR ZOOM
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés