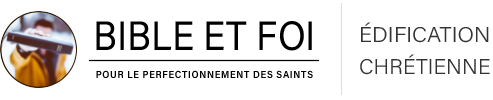L’idole de l’homme rationnel.1
Le chrétien a parfois tendance à fustiger la raison. Assimilée à la présomption intellectuelle, voire à l’orgueil, cette faculté lui apparaît comme l’alliée du péché et du malheur.
« …ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées… (Romains, 1 v. 21) ».
Chrétien ou non, mon lecteur s’attend pourtant à ce que l’article qu’il entame soit substantiel, clairement structuré et logique. Dans sa vie privée, ce même lecteur s’efforce sûrement de donner aux diverses entreprises dont il se sent responsable le même caractère d’ordre, de maîtrise et de clarté.
La raison serait donc tantôt nécessaire, et tantôt haïssable. Tout dépend, comme on dit, du « contexte ». Mais alors, comment cerner le contexte qui permet l’épanouissement de la raison, et définir celui qui la rend délinquante ? Le chrétien évangélique, se fondant sur une déclaration biblique comme celle qui figure en exergue, répondra fort justement que la raison de l’homme « naturel » est dépravée, marquée par la Chute, incapable de conduire l’homme vers le bonheur et de lui ouvrir les portes du salut. Il ajoutera que le chrétien authentique échappe à cette fatalité, car Jésus-Christ habite en lui, la Bible lui sert de boussole, et le Saint-Esprit illumine sa raison défaillante.
Pratiquement, les choses ne sont pourtant pas vécues ainsi en permanence. Un grand nombre de non-croyants parviennent à faire fonctionner leurs facultés mentales pour le bien commun de l’humanité, et les chrétiens n’ont pas toujours brillé par leur sagesse, ni par leur profondeur intellectuelle, ni même par leur bon sens.
La réalité de la vie quotidienne (qu’elle soit rébarbative ou motivante) impose que tous, croyants, athées, sceptiques, ou agnostiques, se comportent de manière aussi « raisonnable » que possible, sous peine d’être vite disqualifiés. Par ailleurs, il arrive à tous de se trouver pris en flagrant délit de déraison, ou d’inconséquence, comme si le Raisonnable (la « sagesse ») ne mûrissait qu’en contrepartie d’un certains nombre d’égarements. Alors, est-ce la raison qui engendre la folie, ou la folie qui finit par imposer la raison? Et au râtelier des dons de la Providence, quelle place assigner à la raison ?
Il m’apparaît qu’une réponse rationnelle à ces questions est singulièrement ardue – je veux parler d’une réponse qui soit à la fois acceptable par des chrétiens convaincus, et utile à des non-croyants. Je crois pouvoir résumer cette difficulté en quelques mots : l’Occident a pris l’habitude de croire en la souveraineté de la raison, et en même temps de la nier. Il ne sait au juste ce qu’elle est, mais il la vénère, parfois en maugréant. Malgré les « leçons de l’histoire », il ne peut s’empêcher de la brandir comme la marque de son génie propre. Il espère en elle, mais s’en méfie.
Si nous parvenons à rappeler quelques-uns des épisodes déconcertants des relations de l’Occident avec sa fille préférée, la raison, nous serons mieux disposés à entendre les paroles catégoriques de l’apôtre lorsqu’il évoque une humanité « égarée dans ses pensées ». Et mieux préparés à rechercher ensemble à quelles conditions l’esprit humain retrouvera sa santé, son équilibre, sa vraie noblesse – et la raison sa place.
Au berceau de la fée
Commençons par une évidence : la raison est une faculté universellement distribuée. Selon Descartes, le « bon sens » ( ou « puissance de bien juger ») est même la chose du monde la mieux partagée. De ce fait, ni l’ingéniosité, ni l’esprit d’analyse, ni celui de synthèse, ni la capacité de déduction, ou de formalisation, ni aucune autre opération de l’esprit ne peut se présenter comme une spécialité du bastion occidental. Le rationalisme est indissolublement lié à l’histoire européenne, mais l’exercice de la « raison », en tant que faculté de juger et d’agir par raisonnement, et non par simples évocations associatives et par instinct, n’est sûrement pas l’apanage des seuls penseurs grecs et de leurs successeurs. Les mathématiques, l’astronomie et les sciences appliquées (architecture, navigation, urbanisme, science militaire, etc.) leur furent bien antérieures. Et à la lecture des recueils de littérature sapientiale de l’Antiquité égyptienne, akkadienne, hébraïque, et des autres peuples du Croissant fertile, on retrouvera tous les types de raisonnements mentionnés ci-dessus.
Toutefois, on ne peut avancer que les sciences et les sagesses pré-helléniques étaient rationalistes dans leur essence. En effet, elles reposaient toutes sur des présupposés de nature religieuse, sur des idées reçues et sur des représentations arbitraires. Ce ne fut que très progressivement que les philosophes grecs eux-mêmes apprirent à se dégager de ces supports hérités des vieilles cosmologies et des traditions. On peut discerner, dans l’apparition de nouvelles religions, le prélude à cette forme d’émancipation spirituelle. Citons pour mémoire le zoroastrisme, ou mazdéisme (du nom du dieu perse Ahura Mazda), qui enseignait dès le 6e siècle avant J.-C. l’opposition radicale entre le Bien et le Mal. Il préconisait la lutte contre les puissances mauvaises (emmenées par le dieu Ahriman), et croyait l’être humain capable d’en triompher, pourvu que ce dernier se laissât conduire par les forces divines de la Lumière et du Bien (gouvernées par Ahura Mazda). Ce manichéisme primitif n’ouvre-t-il pas la porte à une pensée rationaliste embryonnaire ? A tout le moins, ce mouvement traduit une exigence croissante de clarté (clarté dont, en Grèce, Zeus, Apollon, Athéna seront les représentants mythologiques favoris), et une détermination à se débarrasser de tout ce qui maintient l’homme dans l’ignorance et dans l’esclavage moral.
Alors que le polythéisme tend vers un nivellement des notions de vrai et de faux, de bien et de mal, de spirituel et de matériel, de transcendance et d’immanence la recherche de clarté va tendre vers la distinction des opposés (même lorsqu’ils sont perçus comme complémentaires, comme chez Héraclite), vers la séparation, vers la différenciation, et vers le rejet de l’arbitraire. L’outil de cette recherche sera le discours dialectique (selon Platon, l’art « de demander et rendre raison », La République, 533 c). Bientôt, le rationalisme élaboré des philosophes antiques va devenir leur dénominateur commun. Platon comme Aristote, les épicuriens comme les stoïciens, les pyrrhoniens comme les sceptiques, tous parviennent à leurs positions particulières (et parfois contradictoires!) en passant leurs présupposés au crible du « logos », du discours organisé autour de symboles médiateurs. But de l’opération: comprendre l’expérience humaine (la nature des sensations, des traditions, des institutions, des structures sociales, etc.) et le monde en général (les événements, la nature) pour vivre le mieux possible, et le plus justement, le plus sensément.
Il vaut la peine de noter ici que l’aspiration à la clarté ne se développe pas seulement dans le cadre des écoles philosophiques. Cet idéal connaît également la voie mystique, exprimée par les religions à mystères, spécialement par les cultes orphiques. C’est peut-être là le creuset des tendances gnostiques, si vivaces au début du christianisme et de nos jours.
Mais que la connaissance du monde soit l’aboutissement d’un processus dialectique concerté, ou d’une expérience mystique d’illumination de l’oil intérieur., les partisans des deux tendances se rejoignent dans la même croyance implicite en la supériorité de l’esprit (et de la forme) sur la matière, de l’âme sur le corps. Il est du ressort d’un homme « éclairé » de décrire la nature du réel, ou à défaut, de décrire les obstacles qui nous en séparent. La raison est à même de situer l’homme dans le monde, et suffit à l’élaboration d’une morale comme d’une métaphysique (certains philosophes sceptiques font exception).
Dans la joie et l’exaltation de cette espérance, l’Occident salue alors la naissance de la bonne fée qui l’élève au-dessus des ténèbres de la barbarie. On peut sourire des premiers balbutiements de l’enfant prodige, et des vestiges de superstition qui encombrent son berceau, mais cette « venue au monde » n’est-elle pas aussi le témoignage d’une exigence radicale de plénitude spirituelle?
Même prévenu à l’encontre de l’attitude rationaliste, on ne peut nier la grandeur d’un Socrate (pour ne citer que cet exemple) qui, au moment où son ami Criton lui propose de le faire échapper au supplice et à une mort injuste, répond en substance: « Tu sais que je n’obéis jamais qu’à la raison. Or, que dit-elle? Qu’entre les opinions des hommes, il ne faut avoir égard qu’àagrave; celle des hommes sensés, et non à celles de la foule. Cela est surtout nécessaire quand il s’agit des choses les plus importantes, du juste et de l’injuste, du bien et du mal. Or la raison démontre qu’il ne faut jamais être injuste ni faire le mal. C’est de ce principe que notre discussion doit partir, pour décider si je peux sortir d’ici sans l’assentiment des Athéniens » (voir Le Criton, de Platon). Une telle rigueur éthique assortie d’une telle démonstration pratique de sérénité face à la mort méritent l’estime. On ne peut s’empêcher de rapprocher le prince des philosophes de ceux dont parle l’apôtre Paul lorsqu’il écrit :
« Quand les païens qui n’ont point la loi [révélée dans l’Ecriture], font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; ils montrent que l’ouvre de la loi est écrite dans leur cour, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’ accusant ou se défendant tour à tour » (Romains 2 v. 14 et 15) » ; quant à cette manière de « dialogue juridique intérieur », voir le texte de Platon, Le Théétète, 189 e). Mais quoi qu’il en soit des hautes exigences morales et des actes admirables d’un Socrate, de tels exemples ne sauraient être produits pour défendre la puissance salvatrice de la raison. Tout au plus peuvent-ils démontrer que l’homme, être moral autant qu’intellectuel et religieux, trouve un certain apaisement à l’idée de sa propre justice. Il y a pourtant un monde d’opposition entre l’auto-satisfaction morale et la possession réelle de la parfaite justice. C’est ce que feront éclater au grand jour la vie et le message de ]Jésus-Christ.
Servante de la Théologie.
D’un point de vue strictement rationaliste, l’irruption du christianisme dans l’histoire constitue une catastrophe majeure. Alors que le philosophe se flatte de pouvoir évoluer bien au-dessus des miasmes de la crédulité et de la superficialité populaires, le christianisme naissant va proclamer la faillite du processus dialectique et humilier la raison. La nouvelle « secte », violemment combattue et persécutée, propage des thèses autant inacceptables pour les chefs religieux et politiques que pour les philosophes eux-mêmes. Surtout, elle prétend que son fondateur, un certain Juif nommé Jésus de Nazareth, a vécu en homme parfaitement sage et irréprochable, sans avoir été disciple d’aucun des grands maîtres de la philosophie. Plus énorme encore: on affirme que cet homme était Fils de Dieu, Dieu incarné, Dieu en personne, venu sur terre dans le but exprès de sauver l’humanité, et tout cela sans le recours à la philosophie.
On attribue à cet être extraordinaire des pouvoirs surnaturels, et l’on rappelle sans cesse que le point culminant de sa mission a été sa crucifixion, parce que, expliquent ses partisans, cette mort injuste du seul juste de l’histoire a valeur de sacrifice expiatoire pour toutes les mauvaises actions des hommes, et qu’elle nous garantit une paix éternelle avec Dieu. On s’empresse d’ajouter que ce Jésus est revenu à la vie plusieurs jours après sa mise au tombeau, qu’il est monté au ciel et qu’il règne désormais de manière invisible sur tous ceux qui croient en lui, et qui attendent sa réapparition.
Le philosophe se voit donc dépouillé de son principal titre d’honneur: la connaissance du « logos », de la raison incarnée dans le langage, et assimilée par certains penseurs (les stoïciens par exemple) à la divinité suprême. On lui demande désormais de reconnaître en cet obscur Galiléen le Logos lui-même, la Sagesse éternelle, le seul Médiateur entre Dieu et les hommes, le Seul salut imaginable. Et si le philosophe se rebiffe, et demande pourquoi il faut en passer par là, on lui réplique que les philosophes comme les mystiques ont amplement prouvé la faillite de leurs systèmes respectifs. Non seulement ils se contredisent, et leurs manières de vivre sont rarement convaincantes, mais encore des chefs religieux et des hommes ouverts à un discours rationnel (Hérode, en Luc 23 v. 9 ; Pilate, en Jean 18 v. 33 à 38) comptent parmi ceux qui ont crucifié Jésus-Christ.
Pour mesurer l’onde de choc d’un tel message, considérons que l’enseignement de Christ condamne par avance toute forme d’illusion quant au potentiel de la raison humaine. Ce n’est pas la sagesse qui sort du cour humain, de son être profond, mais ce sont « les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, ta folie (Marc 8 v. 21 à 23) ». Aussi fortes que soient les aspirations à la clarté, aussi profondes et ordonnées les réflexions pour comprendre et soi-même et le monde, aussi énergiques les efforts pour se dominer, le cour reste ce qu’il est, et l’esprit comme les sens penchent vers la nuit (cf. Jean 1 v. 5, 10, 11 ; 3 v. 19). Un tel message est philosophiquement irrecevable. Or, comme le dit l’apôtre Paul, si « Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde », et si la sagesse de Dieu (contenue dans la double Révélation de l’Ecriture sainte et de la personne de Christ) n’a été reconnue par aucune des sommités de l’époque (cf. 1 Corinthiens 1 v. 21 ; 2 v. 8 ; Colossiens 2 v. 3, 8 à 10), il n’est pas possible d’embrasser la foi chrétienne sans condamner la nature dégénérée et pervertie de l’être humain tout entier, raison comprise (cf. Romains 3 v. 9 à 20 ).
Pour autant, le christianisme ne va pas exclure la raison, pas plus qu’il ne va déprécier le corps ou ignorer les sentiments. La foi entraîne le croyant dans un processus de complète régénération: devenu « une nouvelle créature » par la venue en lui du Saint Esprit, et sous son contrôle, le chrétien est invité à mettre toutes ses facultés au service de son Seigneur divin (cf. 2 Corinthiens 5 v. 17 ; 1 Thessaloniciens 5 v. 23). La raison retrouve donc sa place, et prend part au grand renouveau. Elle devient capable de saisir l’essentiel et de s’y conformer, tout en rejetant les pseudo-sagesses. D’où des recommandations comme celle-ci : « Je vous exhorte /… / à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable (grec: tèn logikèn latreian). Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait (Romains 12 v. 1 et 2 ) ». N’est-ce pas, d’une certaine manière, la sublimation du rêve rationaliste ?
Lorsqu’au 4e siècle le christianisme devient la religion officielle de l’Empire romain, les beaux jours de la philosophie autonome semblent compromis. L’exercice de la raison n’est plus soutenable que dans le cadre d’une réflexion modelée par la pensée biblique, les anciens moules de la religion polythéiste ont été supplantés par le paradigme trinitaire, et toutes les institutions subissent peu ou prou la marque du consensus chrétien. Dans la mesure où, selon Augustin, la philosophie demeure l’ancilla theologiae, la servante de la théologie, on tolère qu’elle fournisse un certain bagage conceptuel et un support logique.
On pourrait craindre, d’un point de vue rationaliste, que la pensée philosophique «indépendante» ne soit en train de s’acheminer vers une période de stagnation, voire de régression. Pourtant, c’est de cette première période de l’ère chrétienne que date une vision du monde qui a fertilisé toute l’histoire de la pensée occidentale, et dont nous sommes encore tributaires. Celle-ci comprend une recherche de l’absolu centrée sur la Révélation du Dieu unique, l’abandon de la notion de destin (le fatum latin), la désacralisation de la nature (c’est à dire le rejet de l’animisme et du panthéisme), la conviction que l’univers obéit à des lois stables et intelligibles. Le corps est revalorisé (quoique non idolâtré). L’individu prime sur le collectif. L’histoire a désormais un début, une fin, et un sens. L’égalité des êtres humains est posée.
Enfin, un dernier facteur contribue à perpétuer une certaine tradition philosophique: la bataille contre les hérésies, à laquelle l’Eglise est contrainte. De conciles en traités d’apologétique, de défenses en réfutations, les Pères de l’Eglise auront à faire à forte partie, et trouveront tout naturellement l’occasion d’affûter leurs armes dialectiques et rhétoriques. Sans forcément tomber dans un discours purement philosophique, ils seront entraînés dans des controverses où les influences platoniciennes, aristotéliciennes, gnostiques ou païennes les amèneront à utiliser par moments une terminologie proche de celle des pollueurs du message évangélique.
 Un message de Claude-Alain Pfenniger
Un message de Claude-Alain Pfenniger
© Source: Promesses n° 130, Octobre-décembre 1999 - promesses.org.
➲ Articles à découvrir...
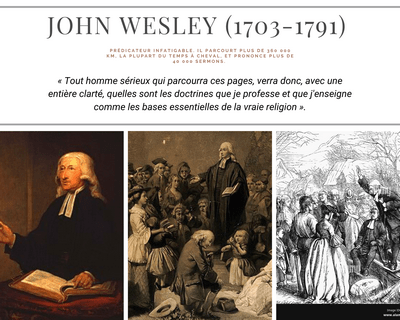
Le salut par la foi.2

43. La vie nouvelle
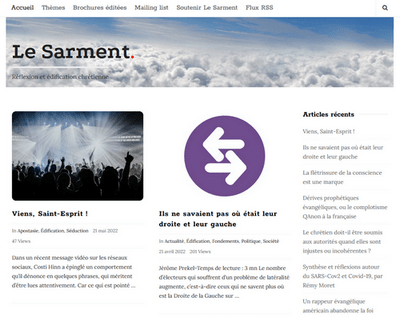
Soumission aux autorités injustes
➲ REUNION SUR ZOOM
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés