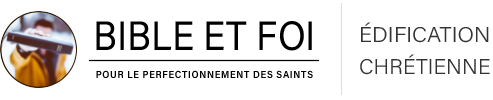22.Je vis le ciel ouvert
Chap: 7 - Les deux scènes de gloire (suite) - Cette dernière partie présente une sorte de rétrospective, une description de l’Église dans la gloire dans ses relations avec la terre durant le règne de mille ans.
Une nouvelle scène s’ouvre au regard du voyant. La description de la première scène a commencé à 21 v. 9. L’ange lui avait dit qu’il voulait lui montrer l’épouse, la femme de l’Agneau. Il l’avait alors conduit en esprit sur une grande et haute montagne, et lui avait montré la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Dieu. Il recommence à montrer une scène au chapitre 22.
Le paradis de Dieu.
Le voyant rapporte donc une seconde vision, si l’on veut. Cette seconde vision s’occupe davantage de ce qui est trouvé à l’intérieur de la sainte cité, avec les bénédictions personnelles des rachetés, bien que les relations avec l’extérieur ne soient pas complètement absentes. Au vu de la promesse au vainqueur à Éphèse (2 v. 7), on peut quand même dire : dans cette seconde vision, il ne nous est présenté rien moins que le « paradis de Dieu ».
Le fleuve de l’eau de la vie (22 v. 1).
« Et il me montra un fleuve d’eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l’Agneau » (Apocalypse 22 v. 1).
Dans les deux premiers versets du chapitre 22, deux nouveaux symboles apparaissent pour décrire la sainte cité ou paradis de Dieu : le fleuve de l’eau de la vie, et l’arbre de vie. Les deux symboles ramènent aux premiers chapitres de la Bible, et je peux renvoyer à ce que nous avons dit sous le titre « Une rétrospective remarquable », au début du chapitre précédent, sur la relation entre la première et la nouvelle création.
À la suite de cela, et pour tirer un plein parti de ces symboles, nous ne devons pas perdre de vue la profonde harmonie entre la cité terrestre et la cité céleste de Dieu. Il y aura une relation continuelle entre la cité sainte dans le ciel et la Jérusalem terrestre. C’est pourquoi elles se correspondent l’une l’autre.
De même que le sanctuaire « fait de main » était une copie du vrai (Hébreux 9 v. 24), et comme Moïse lors de la confection du tabernacle, devait tout faire selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne (Hébreux 8 v. 5), ainsi aussi la Jérusalem terrestre sera en ce temps-là largement une copie de la Jérusalem céleste. Les différences de principe quant au genre de bénédictions ne sont cependant ni touchées ni soulevées.
Dieu, la source de toute bénédiction.
Jean voit un fleuve d’eau de vie, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l’Agneau et coulant dans la cité. Sans entrer davantage pour le moment dans l’expression « trône de Dieu et de l’Agneau », nous apprenons ici, que Dieu est le point de départ et la source proprement dit de toute bénédiction. L’Écriture sainte se sert régulièrement de l’image d’un fleuve d’eau, pour présenter la grâce de Dieu dans sa force qui donne la vie et qui maintient la vie.
C’est ce que nous voyons déjà dans le jardin d’Eden : « Et un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre rivières » (Genèse 2 v. 10).
Naturellement, il s’agissait dans le jardin d’Éden de fleuves au sens littéral. Malgré tout, il y a un sens figuré : comme le fleuve, en quittant le jardin, se partageait en quatre rivières, ainsi Dieu dans sa grâce, s’est occupé de l’homme tombé dans le péché, et d’une manière universelle, ce dont nous parle le chiffre quatre. Mais comment l’homme a-t-il répondu à la grâce de Dieu, aux voies de sa grâce envers lui ?
Deux des fleuves sont encore connus, l’Euphrate et le Tigre. Ils nous donnent une certaine réponse à cette question. Les deux fleuves sont en relation avec l’histoire du peuple d’Israël. Nous pouvons voir là, d’après l’exemple de ce peuple, ce qu’est l’homme en tant que tel.
Parce que le peuple de Dieu d’autrefois, que Dieu avait choisi d’entre tous les peuples de la terre, abandonna son Dieu et se tourna vers les idoles, Dieu dut finalement le mener en captivité : le royaume des dix tribus d’Israël alla en captivité assyrienne, et un certain temps plus tard, le royaume des deux tribus de Juda alla en captivité babylonienne.
Mais la capitale de l’Assyrie, Ninive, est au bord du Tigre, et Babel, la capitale babylonienne a été construite au bord de l’Euphrate. Nous apprenons la leçon bien sérieuse que l’homme est mauvais et inaméliorable, qu’il a rejeté les voies de grâce de Dieu, et qu’à la suite de cela, il ne restait rien d’autre à faire pour Dieu que de l’amener en jugement. Ceci est aussi vrai en rapport avec le temps présent dans lequel Dieu s’est révélé de manière encore plus glorieuse dans la chrétienté.
Les desseins de la grâce de Dieu ont-ils dès lors échoué ? A-t-Il fait naufrage dans ses buts ? A-t-Il échoué dans ses voies envers l’homme ? A-t-Il cessé d’être la source de bénédiction pour les hommes ? La scène de la Jérusalem céleste nous donne la réponse finale : pas du tout !
Cependant, avant d’examiner de plus près cette scène, nous voudrions souligner le principe général suivant : Dans chacune des époques des six mille ans d’histoire humaine jusqu’à maintenant, Dieu a été et est le point de départ de la bénédiction et de l’origine de la vie, de la vie terrestre et avant toutes choses de la vie spirituelle. Dans cette mesure « le ruisseau de Dieu est (toujours) plein d’eau » (Psaume 65 v. 9) ; pour celui qui sait s’en servir par la foi.
C’est ce dont les croyants de tous les temps ont pu faire l’expérience, y compris dans notre temps : « Il boira du torrent dans le chemin, c’est pourquoi il lèvera haut la tête » (Psaume 110 v. 7). Cela n’a-t-il pas été vrai d’une manière parfaite de notre Seigneur et Sauveur, quand Il allait comme homme ici-bas son chemin sur cette terre, dans la dépendance de Dieu ?
Malgré cela, Il était aussi le Fils de Dieu, qui pouvait donner l’eau vive, comme Il disait à la femme samaritaine (Jean 4 v. 10). Celui qui boit de son eau, non seulement n’aurait plus soif pour lui-même, mais l’eau qu’Il lui donnera deviendra en lui une source d’eau jaillissant en vie éternelle (v. 14). Celui qui croit en lui, des fleuves d’eau vive couleront de son ventre : « Or il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui » (Jean 7 v. 37 à 39).
Nous apprenons deux choses importantes des paroles du Seigneur. D’abord la vérité déjà mentionnée, à savoir que Dieu (et cela inclut le Fils de Dieu) est le Donateur de la vie éternelle et le Donateur du Saint-Esprit qui est la force de cette vie. Mais il y a alors le deuxième côté : par le fait que le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 6 v. 19), l’Esprit de Dieu dans le croyant, devient lui-même une source de bénédiction pour d’autres.
Cela devient réalité dans la mesure où le croyant, individuellement, a le Seigneur Jésus devant lui comme objet de la foi. Sommes-nous conscients de la grandeur de la bénédiction et aussi de la responsabilité qui réside dans ce que Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous comme source de bénédiction et de vie pour d’autres ? « Or que le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit Saint » (Romains 15 v. 13).
Or, ce qui est vrai du croyant individuellement, est vrai de l’Assemblée (Église) comme un tout ; car elle aussi est le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 3 v. 16 et 17). Le Dieu-Sauveur l’a établie pour être un canal de bénédiction pour le monde, « dans un pays aride, altéré et sans eau » (Psaume 63 v. 1).
Voilà le point de vue sous lequel est vue l’Assemblée, spécialement dans la première épître à Timothée : une direction de nos regards que malheureusement, nous négligeons trop souvent.
Certes, le fleuve de la grâce et le fleuve de la bénédiction qui donne la vie, réjouissent d’abord la ville de Dieu elle-même, comme les fils de Coré l’exprimaient de façon si belle : « Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-haut » (Psaume 46 v. 4). Mais quand Dieu bénit quelqu’un, alors Il le fait en vue de ce que la bénédiction et la vie se propagent.
Le fleuve de Dieu dans le règne de mille ans.
Nous revenons au temps du règne de mille ans. Jetons un coup d’œil d’abord sur la scène terrestre de ce temps-là. Le prophète Ézéchiel le décrit, et il montre comment l’eau coulera de dessous le seuil de la maison de Dieu en direction de l’Est, et deviendra un fleuve profond. Dieu est de nouveau le point de départ de la bénédiction, qui se montre comme donnant la vie, où qu’elle arrive : « car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines ; et tout vivra, là où parviendra la rivière » (Ézéchiel 47 v. 9).
Les nations aussi, qui sont figurées par l’eau de la mer, recevront la jouissance de la vie divine ; car sans être né de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ni le voir (Jean 3 v. 3 et 5). Quelle que soit la forme extérieure de ce royaume, la nouvelle naissance est la condition pour y avoir part.
Il y aura quand même sur la terre des marais et des étangs qui ne seront pas assainis et resteront salés (Ézéchiel 47 v. 11). Même à l’époque où la justice régnera, tout ne sera pas parfait. La chair reste la même chair, et il y aura beaucoup de gens qui ne se soumettront au Seigneur qu’extérieurement. Voilà l’homme, même en face de la grâce, de la puissance et de la gloire du Seigneur !
Il est intéressant de voir qu’à côté de ce fleuve, il y aura également une double rivière (Ézéchiel 47 v. 9), ce que Zacharie 14 confirme : « Et il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale (la mer morte), et la moitié vers la mer d’occident (la méditerranée) » (Zacharie 14 v. 8). Ce sera une vaste bénédiction.
À côté de toutes ces similitudes, il y aura aussi des différences d’avec la cité céleste Jérusalem. En elle tout sera parfait ; la cité céleste ne connaîtra ni marais ni étang ni lieu stérile. Le fleuve lui-même, comme tout ce qui relève de la sphère céleste, sera pur et éclatant comme du cristal. Il n’est parlé que d’un seul fleuve de la vie. Il n’est pas parlé de division en plusieurs rivières. Manifestement, la pensée principale ici n’est pas celle d’une bénédiction universelle de l’homme sur la terre.
Le fait qu’il y ait un seul fleuve doit plutôt représenter la bénédiction et la joie communes des habitants de la cité. C’est pourquoi le fleuve ne porte pas directement le caractère de donner la vie, mais plutôt de rafraîchir et de stimuler. Les habitants de la cité se réjouissent par grâce depuis longtemps de la possession de la vie éternelle. Mais la vie éternelle a besoin, comme la vie naturelle, de soutien et de renforcement par le moyen de sa source. Mais nous nous arrêterons sur ces pensées seulement au verset suivant à propos de l’arbre de vie.
Le trône de Dieu et de l’Agneau.
Le voyant voit le fleuve sortant du trône de Dieu et de l’Agneau. C’est pour la première fois qu’il est parlé ici du trône de l’Agneau. Au chapitre 4 et 5 on avait déjà vu le trône de Dieu, et l’Agneau se tenait au milieu du trône. Le trône de Dieu est donc distinct du trône de l’Agneau. Les éclairs, les voix et les tonnerres sortent du trône, et sept torches brûlent devant le trône. La courte période située entre l’enlèvement de l’assemblée et l’apparition de Christ en puissance sera caractérisée par un mot : le jugement.
Ici, cependant, une nouvelle forme de gouvernement du monde est visible. C’est le trône de Dieu et le trône de l’Agneau. Dieu et l’Agneau sont liés ensemble, mis sur le même pied* ; ce n’est qu’un seul trône. Durant le règne de mille ans Dieu gouvernera, les cieux gouverneront, comme Daniel l’a prédit. Cela constituera sa bénédiction particulière. Mais ce sera Dieu tel qu’Il s’est révélé dans sa parfaite grâce dans le Christ Jésus, l’Agneau de Dieu. La majesté et la puissance de l’un s’uniront, si l’on a le droit de parler ainsi, à la grâce et la douceur de l’autre, pour conférer au gouvernement de Dieu dans ce temps-là son caractère propre. Ce seront effectivement des jours et des années bénis.
* Nous avons ici un nouvel exemple de ce que, dans les écrits de Jean, Dieu et Christ sont nommés en un seul et même temps et mis sur le même pied. Dans son épître, cela va même parfois jusqu’à ne plus pouvoir distinguer précisément qui ou quelle personne de la Déité est particulièrement en vue. On ne peut pas se méprendre sur l’intention de l’Esprit de Dieu dans cette manière de s’exprimer : il s’agit de montrer que Christ est Dieu. Un bel exemple supplémentaire de cette fusion-union se trouve au v. 3 de notre chapitre 22.
Du fait que le fleuve de l’eau de la vie « sort du trône de Dieu et de l’Agneau », nous en déduisons deux choses :
- Le gouvernement éternel de Dieu sur le terrain d’une rédemption accomplie, formera la source de ce fleuve intarissable, qui nous présente la plénitude de l’Esprit et de la vie.
- Le trône de Dieu et de l’Agneau, offrira la sécurité pour que le fleuve coule éternellement. Il ne tarira jamais.
Quel bonheur inexprimable cela sera pour les rachetés dans le ciel. Pendant l’éternité, ils se réjouiront de la grâce de Dieu révélée dans le Christ Jésus, et ils seront rafraîchis en elle. Les bénédictions de la grâce de Dieu qui se renouvelleront éternellement, se déverseront dans leur cœur et les rendront parfaitement heureux. Et une adoration jamais achevée montera de leurs cœurs vers celui qui est la source de tout : « Ô notre Dieu, que sera-ce »
L’arbre de la vie (22 v. 2).
Une particularité importante est encore ajoutée en relation avec la rue de la cité et le fleuve de vie : « Au milieu de sa rue, et du fleuve, de çà et de là, était l’arbre de vie, portant douze fruits, rendant son fruit chaque mois ; et les feuilles de l’arbre sont pour la guérison des nations » (Apocalypse 22 v. 2).
Au milieu.
En dehors de la rue large* de la cité et du fleuve comme du cristal, Jean voit encore un arbre, l’arbre de vie**. La situation « géographique » de la rue et de l’arbre n’est absolument pas précisée. Il est vrai que si l’on rapporte les mots introductifs « au milieu de sa rue » au verset précédent, alors le fleuve coulerait au milieu de la rue large de la cité.
Bien des traducteurs sont de cet avis. Inversement, si on rapporte ces mots à ce qui suit, alors la rue et le fleuve courent l’un à côté de l’autre avec l’arbre entre eux deux. En fait, plusieurs commentateurs vont jusqu’à dire qu’entre le fleuve et la rue de la ville il y a une sorte de parc rempli de « bois de vie ». Si l’on se trouve « de ce côté » (par exemple sur la rue) et qu’on regarde vers le fleuve, ou si l’on se trouve de l’autre côté (sur le fleuve) et qu’on regarde vers la rue ; dans les deux cas, on regarde toujours le bois ou arbre de vie entre les deux.
C’est une pensée réjouissante quand on sait de qui parle le bois.
* Le mot grec pour rue « plateia », désigne une rue publique large où beaucoup circulent.
** Dans l’expression « l’arbre de vie », les articles manquent en grec, à la fois devant « arbre » et devant « vie ». Par ailleurs, pour « arbre », ce n’est pas le mot normal « dendron » qui est utilisé, mais le mot « xylon = bois » qui est si souvent utilisé et au sens figuré exclusivement pour la croix du Seigneur (Actes 5 v. 30 ; 10 v. 39 ; 13 v. 29 ; Galates 3 v. 13 ; 1 Pierre 2 v. 24).
On pourrait traduire « le bois de vie ». Mais le mot collectif « bois » est souvent utilisé en un sens marquant l’élément isolé, de sorte que la traduction « arbre de vie » est absolument correcte. En tout cas, il s’agit de bois, ou d’un arbre qui est caractérisé par la vie. Il faut noter que la traduction grecque de l’Ancien Testament des Septante utilise toujours le mot « bois = xylon » pour arbre en Genèse 2.
L’accès à l’arbre de la vie.
Même si nous ne pouvons pas préciser la situation géographique avec certitude, cela n’a aucun effet sur la compréhension de ce qui nous est communiqué symboliquement dans ce verset.
D’abord, nous pensons certainement au fait qu’il y a déjà eu un arbre de vie au commencement de l’histoire de l’humanité. Mais Dieu avait dû interdire aux hommes l’accès à cet arbre, dans le jardin d’Éden, par le moyen de chérubins et de la flamme de l’épée qui tournait (Genèse 3 v. 24). Pourquoi ? Ah ! C’est que le premier couple avait mangé d’un autre arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu lui avait commandé de ne pas manger (Genèse 2 v. 17).
Même si Dieu avait dû chasser l’homme du jardin, cet acte de jugement comprenait quand même une part de miséricorde : si l’homme avait alors mangé de l’arbre de vie, alors qu’il était tombé dans le péché (manifestement il ne l’avait pas fait auparavant), cela aurait signifié pour lui une vie perpétuelle dans la misère et le tourment sur la terre.
L’arbre de la connaissance du bien et du mal a été nommé à juste titre l’arbre de la responsabilité. Effectivement, l’homme avait été placé sous une responsabilité en rapport avec cet arbre et le commandement de ne pas en manger : c’était la responsabilité d’obéir à Dieu le Créateur. L’homme a failli, il a fait davantage confiance au serpent qu’à son Créateur. Le résultat en a été que l’accès à l’arbre de vie lui a été défendu. L’effet désolant du péché du premier homme se voit jusqu’à aujourd’hui en ce que la mort a passé à tous les hommes (Romains 5 v. 12).
Maintenant, ces deux arbres du jardin d’Éden renvoient à notre Seigneur Jésus-Christ, à lui qui autrefois a été pendu au bois. Là sur la croix, il a pris la place du pécheur et a réglé parfaitement la question de la responsabilité de l’homme devant Dieu ; comme mort et ressuscité, Il est devenu l’arbre de vie pour tous ceux qui croient en lui. C’est pour cette raison que dans le paradis de Dieu, il n’y a plus qu’un seul arbre, l’arbre de vie. C’est une image de Christ dans la gloire comme vie des rachetés.
L’autre arbre, celui de la responsabilité, n’est plus là. Pareillement, il n’y aura plus quatre fleuves ou rivières, mais un seul, celui de l’eau de la vie, comme il n’y aura plus qu’un arbre. Le ciel n’est plus la scène de la mise à l’épreuve de l’homme. La terre l’était selon la pensée de Dieu ; mais dans le ciel, il n’y aura plus rien ni personne à mettre à l’épreuve. N’est-ce pas une pensée réjouissante ? Tout ce qui rappelle la responsabilité, la discipline, la mise à l’épreuve et choses semblables, n’aura plus aucune place au ciel.
La position de l’arbre de vie, au milieu, montre aussi quelque chose de clair : Christ sera au ciel le centre de tous ceux qui suivent l’Agneau ; tous les rachetés auront accès à lui, un accès qui demeurera ouvert et sans entrave. Il sera absolument accessible à chacun des siens, pas seulement en principe, mais aussi en pratique.
Aucun chérubin ne pourra jamais interdire l’accès auprès de lui. Nous le verrons comme Il est, et nous nous délecterons en lui sans entrave. Cela nous amène à un autre point important.
Les livres de Christian Briem en Pdf
➲ Articles à découvrir...
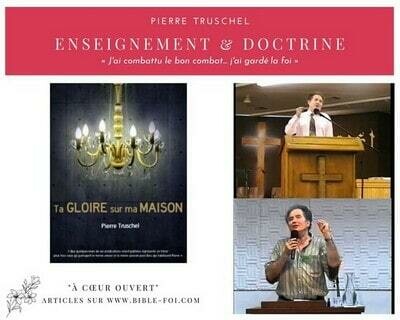
Le chrétien et les œuvres sociales
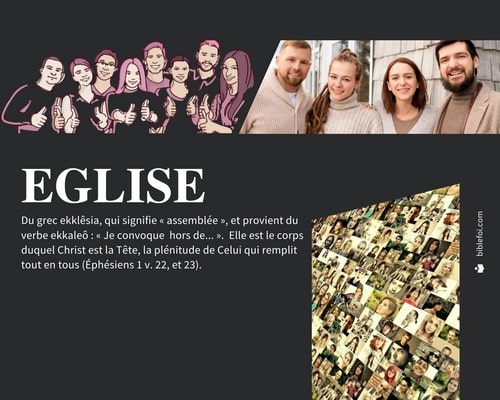
Comment rendre un culte agréable à Dieu.2

2. Le sang de la croix
➲ REUNION SUR ZOOM
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés