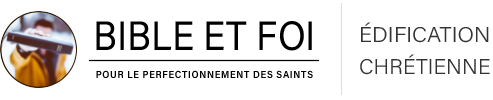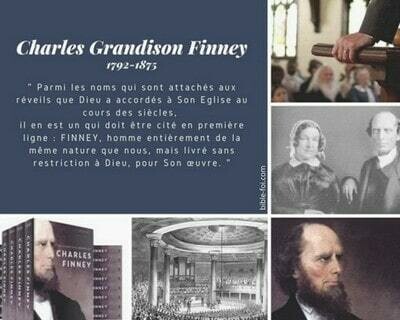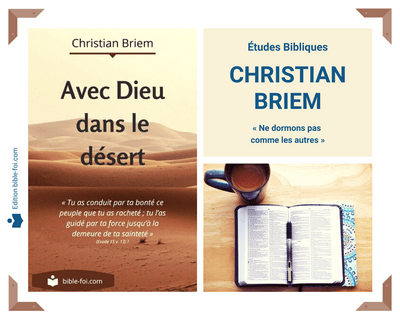
10. Chrétien et heureux ?
Chap: 8 - Réveil de la mémoire par le souvenir - En oubliant, nous perdons énormément. Aussi, le rappel des choses est-il de toute importance. Comme le montrent clairement les passages cités, il est produit par les paroles prononcées initialement.
Au début de sa seconde épître, l’apôtre Pierre insiste beaucoup sur l’expression « ces choses ». Il l’utilise cinq fois en tout dans les quinze premiers versets. Aux versets 5 à 7, il indique ce qu’il entend par ces mots. Il s’agit des sept éléments dont nous nous sommes occupés plus haut et qui constituent la vie de foi chrétienne en tant que telle. Après avoir présenté « ces choses », l’apôtre y revient déjà trois fois dans les versets qui suivent immédiatement, 8, 9 et 10. Et nous avons vu que si nous voulons vivre heureux comme chrétiens, elles doivent « être en nous » et y « abonder », nous devons les « faire ».
L’auteur poursuit maintenant cette pensée et en vient à parler une quatrième fois de « ces choses » : « C’est pourquoi je m’appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente » (v. 12).
L’apôtre tient beaucoup à rappeler les grandes vérités chrétiennes aux croyants, bien qu’ils les connaissent. Dans ces versets, il ne parle pas moins de trois fois de ce rappel : « vous faire souvenir » : « vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire » : « vous rappeler ces choses ».
Plus loin, il caractérise même ses deux épîtres de cette manière : « Dans l’une et dans l’autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire » (3 v. 1). Pierre n’a pas du tout l’intention de leur présenter quelque chose de nouveau. Il veut leur rappeler ce qu’ils savaient déjà, en quoi ils étaient affermis comme l’ayant reçu de Dieu. En général, le rappel répété de choses connues ne nous paraît pas particulièrement important ni souhaitable.
Mais nous nous trompons. S’adressant aux Philippiens, Paul remarque : « Vous écrire les mêmes choses n’est pas pénible pour moi, et c’est votre sûreté » (Philippiens 3 v. 1). Cela signifie que le fait de se répéter dans ce qu’il leur écrivait contribuait à leur sûreté. Après la résurrection, les disciples cherchaient le Seigneur Jésus au mauvais endroit : parmi les morts. Comment était-ce possible ?
Les femmes venues au sépulcre avaient oublié les paroles de leur Seigneur et les deux anges doivent leur dire : « Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée… » (Luc 24 v. 6). Puis il est ajouté : « Et elles se souvinrent de ses paroles ». Plus tard le Seigneur lui-même rappelle à ses disciples ce qu’il leur avait dit précédemment : « Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j’étais encore avec vous… » (v. 44).
En oubliant, nous perdons énormément. Aussi, le rappel de choses connues une fois est-il de toute importance. Comme le montrent clairement les passages cités, il est produit par les paroles prononcées initialement. Nous pouvons aussi dire d’une manière générale : par la parole de Dieu.
La Parole par laquelle nous avons reçu la vérité, est aussi le moyen par lequel celle-ci nous est rappelée toujours à nouveau. Il n’existe aucune autre autorité divine. C’est pourquoi l’apôtre Pierre avait tellement à cœur de ne pas leur écrire quelque chose de nouveau, mais de leur rappeler la parole de la vérité qu’ils avaient déjà reçue.
Quand nous parlons d’oubli, il ne faut pas penser simplement à une mauvaise mémoire. L’oubli de vérités que l’on a connues une fois, a des causes plus profondes et morales. Nous l’avons déjà vu dans notre chapitre, quand l’apôtre a parlé d’un oubli de la purification des péchés d’autrefois (v. 9). Les Hébreux croyants aussi se voient reprocher d’avoir oublié l’exhortation qui s’adressait à eux comme à des Fils (Hébreux 12 v. 5).
Concernant les croyants de Galatie, l’apôtre Paul pouvait seulement s’étonner qu’ils se montrent si vite prêts à abandonner des principes fondamentaux de l’évangile (Galates 1 v. 6). On oublie rapidement ce qui ne nous paraît pas particulièrement précieux. Voilà ce dont il s’agit. Nous apprenons ainsi, combien nous avons besoin d’être toujours à nouveau réveillés par le rappel de la vérité à notre mémoire, afin qu’elle reste précieuse ou le redevienne pour nous.
Pierre parle de la « vérité présente ». Qu’entend- il ? Il parle certainement de la vérité chrétienne en contraste avec ce qui était révélé autrefois sous l’ancienne alliance. Il est évident que la Bible entière est la parole de Dieu, et aussi que « toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction » (Romains 15 v. 4).
Pourrions-nous, par exemple, nous passer des instructions morales de l’Ancien Testament ? Ou des types ? Ou des prophéties ? Chaque temps ou époque a eu une « vérité présente », et nous devons l’estimer et en tirer du profit pour nous. Mais le danger existait, et existe toujours, de perdre de vue les bénédictions typiquement chrétiennes qui caractérisent la période actuelle.
Il ne pouvait pas y avoir de révélation parfaite de Dieu avant que Christ soit venu dans le monde et qu’il ait glorifié Dieu ici-bas dans sa vie et dans sa mort. Christ est cette révélation, et nous la trouvons dans le Nouveau Testament.
L’apôtre pourrait-il dire de nous aussi que nous sommes affermis dans la vérité présente ? En tout cas, Dieu veut que nous connaissions les choses qui nous sont données par lui (1 Corinthiens 2 v. 12). Nous ne pourrions pas être heureux autrement. Pourtant, il y a quelqu’un qui s’y oppose constamment. Certes, le diable ne peut pas nous ravir les bénédictions elles-mêmes, mais il peut très bien nous en ôter la jouissance.
C’est ce que l’apôtre a devant les yeux lorsqu’il poursuit : « Mais j’estime qu’il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire » (v. 13).
Tant qu’il était en vie, il estimait juste, comme étant son devoir, de réveiller les croyants en leur rappelant ces choses. La manière de s’exprimer de l’apôtre est intéressante. Après l’image de l’oubli, il prend maintenant celle du sommeil.
Par le rappel nous devons être réveillés de la léthargie spirituelle (la somnolence, l’inertie, l’apathie) dans laquelle nous tombons si facilement sous l’influence de Satan et du monde dont il est le chef. Le mot employé est fort ; il est utilisé en Jean 6 pour décrire la mer qui « s’élevait » par un grand vent (v. 18). Nous avons parfois nous aussi besoin d’un bouleversement.
Dieu peut se servir d’un « grand vent » pour rappeler à notre mémoire nos bénédictions propres. Acceptons-le ! Nous serons plus riches après que nous ne l’étions avant (comp. Hébreux 12 v. 11).
Le moment de déposer sa « tente ».
Pierre ne voit pas seulement les dangers auxquels se trouvent exposés les enfants de Dieu ; il est également conscient de ne disposer plus que de très peu de temps pour son service. Tout cela confère à ses paroles une solennité pressante : « Sachant que le moment de déposer ma tente s’approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l’a montré » (v. 14).
Je suis toujours impressionné par l’expression « déposer ma tente ». Suivant le terme scripturaire dans un autre passage (2 Corinthiens 5 v. 1 à 4), Pierre considère son corps comme une « tente » seulement, comme un domicile provisoire pour cette courte vie.
Il sait qu’il est en chemin vers la patrie céleste, éternelle ; et quand la mort approche, elle n’est pour lui que le moment de déposer sa tente.
Le croyant n’a plus besoin de craindre la mort. Pour lui, elle signifie uniquement l’abandon de ce qui est mortel. Que peut faire la mort, sinon nous ouvrir la porte de ce domaine où elle n’a plus aucun pouvoir ? Ainsi, nous pouvons maintenant déjà nous écrier triomphalement : « Où est, ô mort, ton aiguillon ? où est, ô mort, ta victoire ? » (1 Corinthiens 15 v. 55). Enlever un vêtement, être « dépouillé », quitter une tente délabrée, telle est la mort pour un enfant de Dieu.
Même les circonstances accompagnant sa mort n’angoissent pas l’apôtre. Il est parfaitement au clair sur ce qui l’attend. Quand, encore confiant en ses propres forces, il s’était déclaré prêt à laisser sa vie pour son Maître, celui-ci lui avait dit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard » (Jean 13 v. 36), à savoir dans la mort.
Ensuite, à la mer de Tibérias, le Seigneur ressuscité lui avait indiqué quel genre de mort il connaîtrait : « Quand tu étais jeune, tu te ceignais, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te conduira où tu ne veux pas » (Jean 21 v. 18). N’était-ce pas une allusion claire à une mort violente, au martyre ?
Maintenant Pierre est vieux, et il sait que le moment de déposer sa tente va arriver bientôt ou subitement. « Notre Seigneur Jésus-Christ », remarquons le titre complet qu’il emploie pour le Seigneur, le lui a montré.
La question de savoir si cela se rapporte aux paroles du Seigneur à la mer de Tibérias ou à une autre révélation, plus tardive, qui ne nous est pas communiquée, dépend de la manière selon laquelle on traduit le mot grec « tachinós » au verset 14. En fait, il signifie à la fois : « bientôt, proche, imminent » et « rapide, prompt, subit ». Ce terme ne revient que deux fois dans le Nouveau Testament, et la seconde occasion se trouve dans notre épître aussi, au premier verset du chapitre 2. Là, il a clairement le sens de « rapide, subit » : « une prompte destruction ».
Ne pouvons-nous pas en déduire que, dans le verset qui nous occupe également, Pierre parle non seulement de sa mort prochaine, mais de sa mort subite, rapide, et qu’il se réfère donc aux paroles du Seigneur qui nous sont rapportées en Jean 21 ? Son service parmi les saints connaîtrait une fin subite. Comprenons-nous le sérieux de ces mots ? Les destinataires de son épître ne pourraient tout à coup plus entendre la voix de ce berger soucieux du bien du troupeau. Quel appel à leurs cœurs, mais aussi aux nôtres !
D’un autre côté, nous voyons également ici la grâce merveilleuse du Seigneur Jésus. Lorsque son serviteur était plus jeune, il pensait pouvoir suivre son Maître dans la mort par ses propres forces. Mais cela s’est terminé par un échec total, par le terrible reniement de celui qu’il aimait pourtant tellement.
Il avait manqué la meilleure occasion de glorifier son Seigneur face à la mort. Était-ce perdu pour toujours ? Tel paraissait bien être le cas après la crucifixion et l’ensevelissement du Seigneur. Mais ensuite, par les paroles citées plus haut, le Seigneur ressuscité, dans sa bonté, donna à son serviteur une nouvelle chance pour le temps où il serait devenu vieux. Il lui dit en quelque sorte : « Quand ce jour sera venu, Simon, je t’accorderai la grâce de me glorifier en cela même où tu as manqué autrefois. Suis-moi ! »
Cet homme était devenu vieux maintenant, il avait suivi fidèlement son Seigneur pendant des décennies. Pour cette dernière grande épreuve, il s’appuie sur la délité et la grâce de celui qui lui accorderait encore une fois cette occasion de mourir pour lui.
Toutefois, une différence essentielle existe entre Pierre et nous, quand bien même nous avons beaucoup à apprendre de l’apôtre et de sa foi. Ce serviteur du Seigneur avait une déclaration claire du Seigneur à son sujet et concernant la fin de sa vie : non seulement il atteindrait un âge avancé, mais ensuite il glorifierait aussi le Seigneur par une mort particulière (Jean 21 v. 19).
Ainsi, pendant toutes les années de son service, Pierre attendit sa mort (violente) avec confiance en la parole de son Seigneur, dans une paix profonde.
Quant à nous, par principe, nous n’attendons pas la mort. Notre espérance est beaucoup plutôt déterminée par la venue du Seigneur pour l’enlèvement des saints. Le Seigneur ne nous a pas parlé de notre mort, mais nous a annoncé son retour. Naturellement il peut aujourd’hui aussi, donner à l’un des siens, qu’il va prendre auprès de lui par la mort la certitude que dans son cas particulier tel sera le chemin. Paul également a eu cette certitude vers la fin de sa vie (comp. Actes 20 v. 29 ; Philippiens 2 v. 17 ; 2 Timothée 4 v. 6). Mais c’est différent de ce que nous voyons chez Pierre.
« Après mon départ ».
L’apôtre va parler une cinquième et dernière fois de « ces choses », soulignant encore par là leur importance : « Mais je m’étudierai à ce qu’après mon départ vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses » (v. 15).
Au verset 13, l’apôtre parle de la période où il est encore en vie ; au verset 14, de sa mort prochaine ou subite ; et maintenant, au verset 15, il indique le temps qui suivra sa mort. En vue de ce temps précisément, il prend des dispositions pour mettre les croyants en état de se rappeler ces choses alors aussi. De quelle manière le fait-il ?
Relevons d’abord ce qu’il ne fait pas ou comment il ne procède pas. Il ne les confie pas à un successeur. La pensée d’une succession apostolique humaine lui est aussi étrangère qu’à l’apôtre Paul (comp. Actes 20 v. 29). Il ne désigne personne qui poursuivrait son œuvre après sa mort. Il ne recommande pas non plus les croyants à l’assemblée de Dieu, comme si elle pouvait remplacer les apôtres.
Non, les dispositions qu’il prend consistent à écrire ces lettres, afin qu’après son départ, les saints trouvent quelque chose venant de lui, qui leur rappelle les enseignements qu’il leur avait donnés. En d’autres termes : en vue de sa mort, il fonde la foi des saints sur la Parole inspirée de Dieu. Nous avons là un fait d’une très grande importance. Le fondement de notre foi et la règle de notre vie ne se trouvent que dans la Parole écrite de Dieu. Comme Pierre, Paul voyait aussi la fin de son service arriver et était conscient de la progression du mal.
À qui recommande-t-il les saints ? « Et maintenant je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d’édifier… » (Actes 20 v. 32). Et, peu avant son martyre, dans sa dernière épître inspirée, ce même apôtre attire l’attention de son enfant bien-aimé, Timothée, sur les saintes lettres qui seules peuvent rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus (2 Timothée 3 v. 15).
Il est aussi très révélateur, que, dans leur dernière épître respective, les deux apôtres insistent sur l’inspiration des Saintes Écritures : « Toute écriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3 v. 16). Voilà comment s’exprime Paul face à des docteurs qui voulaient détourner les hommes de la vérité et les entraîner vers des fables.
Pierre voit aussi des faux docteurs se lever parmi les saints (2 Pierre 2 v. 1) ; de sorte qu’à la fin du premier chapitre, il dit : « Car la prophétie n’est jamais venue par la volonté de l’homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint » (v. 21).
Notons à propos que chacun des mots aussi sont inspirés de Dieu, et non pas seulement les pensées. Le verset 13 de 1 Corinthiens 2 l’établit clairement : « … Desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l’Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels ». Nous avons ici la définition fournie par le Nouveau Testament de ce que nous appelons « l’inspiration verbale des Saintes Écritures ».
Quand Pierre, faisant allusion à sa mort, parle de son « départ », il emploie un mot très intéressant : « exodos ». Le lecteur aura sans doute observé, ici et là, sur les portes ou les sorties, le mot « EXIT» (sortie). L’évangéliste Luc se sert de ce mot dans la description qu’il donne de la scène sur la montagne de la transfiguration (Luc 9 v. 31). Une scène à laquelle Pierre aussi fait allusion plus loin.
Moïse et Élie « parlaient de sa mort qu’il allait accomplir à Jérusalem ». Et quelle sortie fut celle du Seigneur ! Moïse n’avait certes pas « accompli sa sortie » de manière parfaite : il était mort dans le désert, parce qu’il avait parlé légèrement de ses lèvres (Psaume 106 v. 33) ; il ne put pas entrer dans le pays. Élie n’avait pas non plus accompli sa course d’une manière irréprochable : il avait osé accuser le peuple de Dieu (1 Rois 19 v. 10 à 14 ; Romains 11 v. 24) ; il dut oindre son successeur sur-le-champ.
Mais le Seigneur Jésus a « achevé » l’œuvre que le Père lui avait donnée à faire (Jean 17 v. 3). Il n’y a pas eu de défaillance chez lui, pas d’ombre. Son « départ » correspondait parfaitement à la pensée de Dieu. Et Pierre aussi attend la fin sans crainte. Pour lui, il s’agissait uniquement de déposer sa tente, pour être absent du corps et présent avec le Seigneur (2 Corinthiens 5 v. 8).
D’une manière ou d’une autre, nous connaîtrons nous aussi un jour le « départ ». Puissions-nous alors dire avec l’apôtre Paul : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Timothée 4 v. 7) ! Tout le reste sera sans importance.
Les livres de Christian Briem en Pdf
CSS Boutons Partager
➲ Articles à découvrir...

5. La révélation de la croix
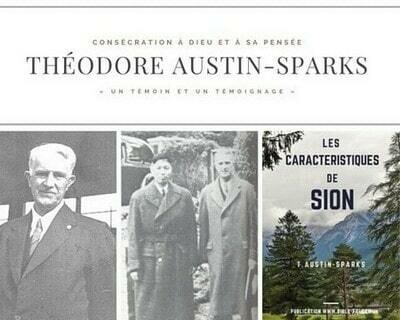
6. Christ réssucité
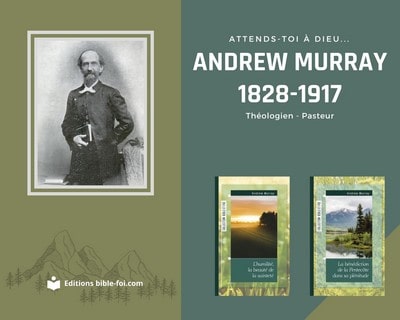
1. Demeurez en Christ
➲ REUNION SUR ZOOM
« Le Seigneur n'est pas satisfait par un peuple qui ne serait que sauvé. Le Seigneur a fixé Son objectif : La pleine connaissance de Lui-même. »
- Théodore Austin-Sparks
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés