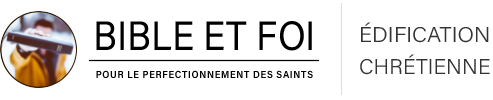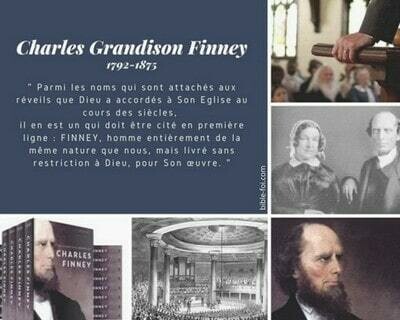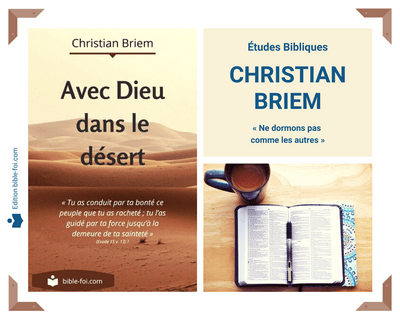
11. Chrétien et heureux ?
Chap: 9 - Pas de fables, mais une révélation divine - La venue de Christ, son règne ici-bas en puissance et en gloire, avec ses saints, ne sont pas des fables. Au contraire, il s’agit de réalités importantes.
L’apôtre fait tout pour montrer aux saints les sûrs fondements divins de leur foi. Celle-ci repose non pas sur des fables ingénieusement imaginées, par lesquelles autrefois déjà les faux docteurs causaient de grands dommages (2 v. 1), mais sur la révélation divine. Pour étayer sa déclaration, Pierre va parler maintenant de ce qu’il a vécu avec Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration, de faits qui pouvaient être attestés par la bouche de plusieurs témoins. C’est sans doute la raison pour laquelle il ne s’exprime dès lors plus au singulier, mais au pluriel.
Sur la sainte montagne.
« Car ce n’est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu’une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir ». Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne » (v. 16 à 18).
La venue de Christ, son règne ici-bas en puissance et en gloire, avec ses saints, ne sont pas des fables. Au contraire, il s’agit de réalités importantes, dont la lumière, l’éclat est propre à encourager notre cœur dans le chemin, souvent difficile, sur lequel nous sommes engagés. En effet, avant de prendre autrefois les trois disciples avec lui sur la sainte montagne, le Seigneur Jésus leur avait dit en quelque sorte :
« Je vais souffrir et être rejeté, et celui qui veut me suivre doit s’attendre à connaître la même chose » (comp. Luc 9 v. 23 à 26). Mais ensuite, il leur fit entrevoir la fin : « De ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à ce qu’ils aient vu le royaume de Dieu » (v. 27). Et ainsi, sur la montagne de la transfiguration, il leur montra une image du royaume « en miniature ».
Ce que ces trois hommes ont vu et entendu sur la montagne n’était pas seulement la révélation de la gloire suprême accordée au Christ rejeté ; c’était aussi une image très instructive de sa gloire dans le royaume à venir, lorsque toutes les souffrances et tout le mépris auront pris n pour toujours. Aussi l’apôtre exprime-t-il la différence avec la première venue du Seigneur (quand il souffrit et mourut) par les mots : « la puissance et la venue (ou : présence) de notre Seigneur Jésus-Christ ».
La mention de la « puissance » à côté de la « venue » montre clairement qu’il ne s’agit pas ici de la venue du Seigneur pour l’enlèvement. En revanche, quand la « venue » est nommée seule et n’est pas limitée par des adjonctions, indiquant la puissance ou la manifestation, en règle générale, il est question de l’enlèvement (par exemple, 1 Corinthiens 15 v. 23, à la différence de 1 Jean 2 v. 28).
La scène sur la montagne de la transfiguration ne doit pas non plus être prise pour une allusion à l’éternité, car alors Christ aura remis le royaume à son Dieu et Père (1 Corinthiens 15 v. 24), mais elle donne une image du Millénium, elle constitue une prophétie, tant pour les yeux que pour les oreilles de Pierre et de ceux qui étaient là avec lui.
Elle montre le Fils de l’homme dans sa gloire, entouré de ses saints célestes. Les uns (représentés par Moïse) ont passé par la mort et ont été ressuscités. Les autres (représentés par Élie) ont été enlevés sans voir la mort. Avec Jésus, ils entrent tous les deux dans la « nuée », dans la proximité immédiate de Dieu, le Père.
Ses saints terrestres (représentés par Pierre, Jacques et Jean), seront sous le rayonnement de sa gloire, dans des corps naturels sur la terre. Ils se trouveront à portée de cette gloire, ils pourront en voir et en entendre quelque chose, mais ils n’y auront pas eux-mêmes de part. Le fait que les trois disciples eurent peur quand Moïse et Élie entraient dans la nuée avec le Seigneur (Luc 9 v. 34), montre aussi clairement qu’il n’est pas possible de supporter la gloire céleste dans un corps naturel.
De la « gloire magnifique », la voix du Père se fait entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir ». Dieu réunira toutes choses sous une tête dans le Christ (Éphésiens 1 v. 10), dans la Personne en qui il a trouvé un tel plaisir.
Mais posons-nous ici la question : Le Seigneur ne suffit-il pas pour remplir nos cœurs aussi d’une joie profonde, d’un bonheur inexprimable ? Quelqu’un d’autre peut-il y revendiquer une place ? Son amour et sa gloire nous appartiennent. N’est-ce pas assez pour nous rendre parfaitement heureux ?
La parole prophétique.
De la scène glorieuse sur la sainte montagne, de ce coup d’œil sur le royaume à venir, l’apôtre passe assez brusquement à la parole prophétique : « Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, (à laquelle vous faites bien d’être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur), jusqu’à ce que le jour ait commencé à luire et que l’étoile du matin se soit levée dans vos cœurs » (v. 19).
Pourquoi ce passage rapide à un nouveau sujet ? Il semble y avoir deux motifs. D’abord, la transfiguration sur la sainte montagne attestait les prophéties de l’Ancien Testament.
Les prophètes avaient parlé de cette gloire et du royaume, et la scène merveilleuse donnait à leurs paroles une confirmation fiable. Il est clair que les prédictions étaient absolument sûres en elles-mêmes. Mais, étant donné la mort ignominieuse de Christ, il a paru bon à Dieu, dans sa sagesse, de confirmer la vérité de la seconde venue du Seigneur et de son royaume par la transfiguration. Dans ce sens, nous avons la parole prophétique rendue « plus ferme ».
La lumière de la « lampe ».
Mais, second motif, la parole prophétique est aussi une « lampe », dont on ne néglige pas impunément la lumière. Et que voyons-nous d’abord à cette lumière ? Que le Fils bien-aimé, le Roi du royaume, serait rejeté dans l’intervalle. Le monde a refusé de le reconnaître, et les prophéties de l’Ancien et du Nouveau Testament parlent également de ce rejet. Nous allons considérer dans un instant de plus près cet aspect et ses conséquences.
Mais en tout cela, il convient d’être conduit par la Parole écrite et non par les opinions des hommes. Aussi est-il ajouté : « … à laquelle vous faites bien d’être attentifs ». Ne nous contentons pas de lire de telles paroles, mais attachons-nous à leur accorder notre attention et à nous y tenir. Telle est la signification complète du mot grec. Dieu désire que la parole prophétique atteigne notre conscience et ait des effets sur notre vie.
Nous le comprenons mieux si nous nous rappelons, encore une fois, le double contenu de cette parole. Un verset de la première épître de Pierre nous apportera une aide précieuse à cet égard. Il y est parlé de l’Esprit de Christ, l’Esprit prophétique, par lequel les prophètes de l’Ancien Testament ont rendu témoignage de Christ. De quoi témoignaient-ils ? « Des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient » (1 v. 11).
Tels sont les deux pivots de la prophétie. Ils ressemblent à deux pics qui, vus de loin, semblent être tout proches l’un de l’autre. Mais, en s’approchant, on découvre qu’une large vallée les sépare. Cette « vallée » est la période actuelle de la grâce. Elle ne fait pas l’objet de la prophétie de l’Ancien Testament. Regardant en quelque sorte de loin, les prophètes ne pouvaient pas la discerner. En revanche, nous vivons dans ce temps et nous regardons rétrospectivement un des pics et par anticipation l’autre.
La parole prophétique montre donc non seulement la gloire future de Christ dans le royaume, mais aussi ses souffrances et son rejet sur la terre. Elle manifeste l’état du monde, dénonce sa fausse religion et indique son cours et sa fin. Elle ressemble à une lampe, et celle-ci est d’une grande valeur pendant la nuit qui a commencé avec la réjection de Christ. Elle éclaire la scène sombre ; et nous faisons bien d’y être attentifs nous aussi. Car on ne peut pas mépriser sans perte la lumière qu’elle jette sur le monde qui va bientôt être jugé.
La « lampe » est pour la nuit, pour éclairer les ténèbres spirituelles de ce monde conduit par Satan, son chef (Éphésiens 6 v. 12 ; Jean 12 v. 31). Notre appréciation de ce qu’est le monde devrait se fonder sur la lumière que la « lampe » de la parole de Dieu nous accorde à son sujet, et non pas sur les hautes professions de ceux qui croient au progrès dans le monde.
Ainsi, cette lumière nous donnera aussi un motif pour nous séparer de ce système impie : « toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété » (3 v. 11).
La lumière du « jour ».
La prophétie s’occupe principalement de la terre, des Juifs, des nations, de tout le mal ici-bas, de la venue du Seigneur pour le jugement. Mais tout cela n’est pas l’objet propre de notre cœur, ne constitue pas l’espérance typiquement chrétienne.
Même la restauration d’Israël et l’établissement du royaume n’en forment pas le sujet. Il y a une lumière plus élevée, une meilleure espérance, et Pierre en parle aussi : « … Jusqu’à ce que le jour ait commencé à luire et que l’étoile du matin se soit levée dans vos cœurs ».
Ne pensons pas que Pierre entende par là : « Jusqu’à ce que Christ se lève comme soleil de justice, avec la guérison dans ses ailes », selon les expressions du dernier prophète de l’Ancien Testament (Malachie 4 v. 2). Il s’agira alors à vrai dire du « jour de l’Éternel », mais celui-ci n’est pas encore venu.
Remarquons encore que dans notre verset l’article devant « jour » est entre crochets (qu’il n’y a donc pas d’article dans l’original). Ainsi, Pierre ne dit pas : « jusqu’à ce que le jour soit arrivé », mais : « jusqu’à ce que jour ait commencé à luire ». Il parle de l’aube, du lever du jour dans le cœur. Les enfants de Dieu sont « du jour », ils sont « des Fils de la lumière et des Fils du jour » (1 Tessaloniciens 5 v. 4 à 8).
De ce fait, pour ce qui concerne leur espérance, la lumière du jour (ou : le jour) les remplit déjà, avant la venue du jour lui-même. De même que la lumière naissante du matin éclaire d’abord les sommets des montagnes avant de briller dans la vallée, nous aussi, dans la communion avec Dieu et la séparation du monde, nous serons remplis de la lumière et de la gloire du matin, avant qu’il se lève pour cette pauvre terre. Quelle joie n’éprouvons-nous pas maintenant déjà, une joie et un bonheur dont le monde aveugle ne connaît rien.
La lumière de « l’étoile du matin ».
Mais ensuite, nous trouvons encore la lumière de « l’étoile du matin » (littéralement : du dispensateur de lumière, du chandelier). Pierre fait ici brièvement allusion à la venue du Seigneur Jésus pour l’enlèvement. Il dit en quelque sorte : « La prophétie est bonne, mais il y a encore mieux : Le Seigneur Jésus lui-même viendra ! »
Il est lui l’objet de nos cœurs et sa venue est notre espérance. Comme il est « la racine et la postérité de David » pour Israël, il est aussi « l’étoile brillante du matin » pour nos cœurs (Apocalypse 22 v. 16).
Quelle lumière allume en nous l’espérance de son retour. Avant que le jour se lève, il viendra comme l’étoile du matin. Nous lui appartenons déjà, alors qu’il fait encore nuit, et nous serons enlevés auprès de lui avant que le monde le voie.
Celui-ci dort encore, tandis que nous jouissons déjà de lui, nous le connaissons avant de l’avoir vu. Lorsqu’il se lèvera comme le soleil, nous le verrons dans sa gloire, nous partagerons même celle-ci avec lui ; mais nous le connaissons maintenant déjà, derrière les nuées.
Nous savons que notre part est en haut avec Christ. Et nous savons aussi qu’avant de venir pour juger le monde, il viendra pour nous, afin de nous prendre auprès de lui dans la gloire. Nous n’attendons aucun autre événement qui doive intervenir auparavant. Nous n’attendons rien d’autre que la venue de notre Seigneur. Si nous réalisons cela par la foi, l’étoile du matin s’est alors effectivement levée dans nos cœurs.
Existe-t-il une seule chose qui puisse nous rendre plus heureux que l’espérance de le voir comme il est ? Oh ! lire dans son visage, qui un jour a été « défait plus que celui d’aucun homme », y lire combien il nous a aimés ! « Seigneur Jésus, viens aujourd’hui encore ! »
Fin
Les livres de Christian Briem en Pdf
➲ Articles à découvrir...
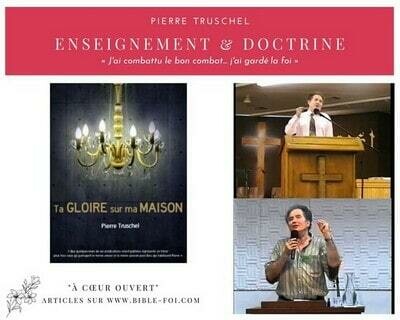
La théologie de l’évangélisation
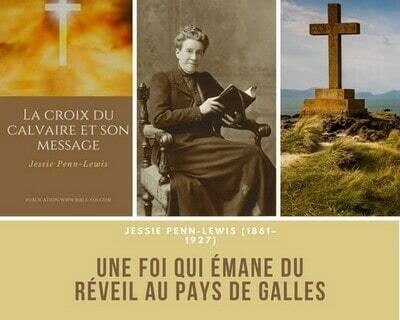
Le caractère central de la croix.10

2. Puissance par la prière
➲ REUNION SUR ZOOM
« La valeur de la réussite d'un prédicateur ne dépend pas de ses dons mais du nombre de successeurs qu'il a engendré ! »
- Pierre truschel
Edification
Enseignements
➲ NOUVEAUX EBOOKS
PDF Révisés